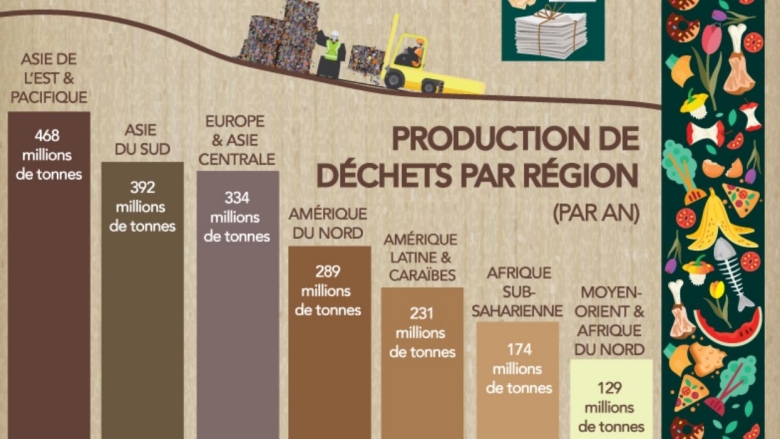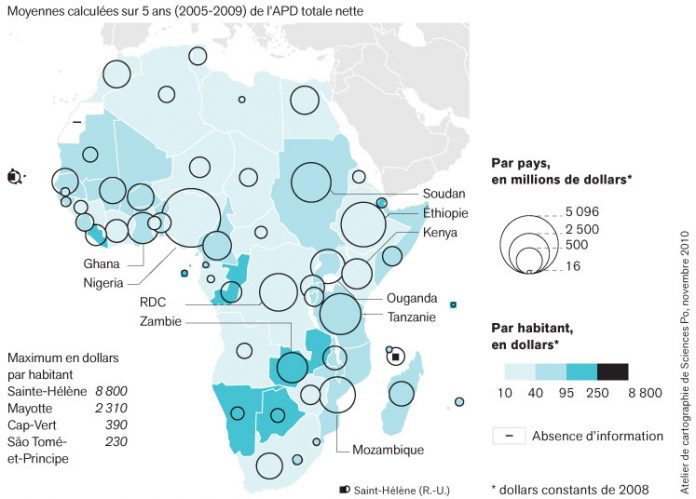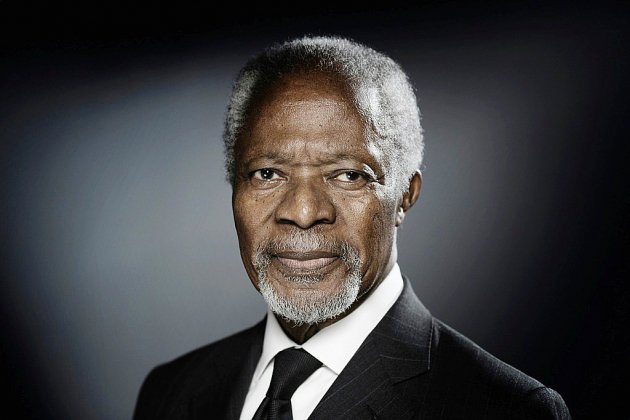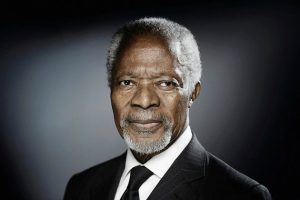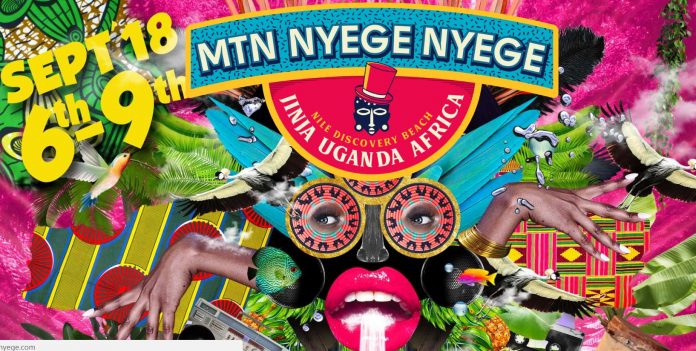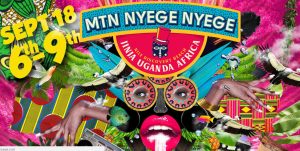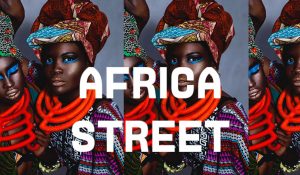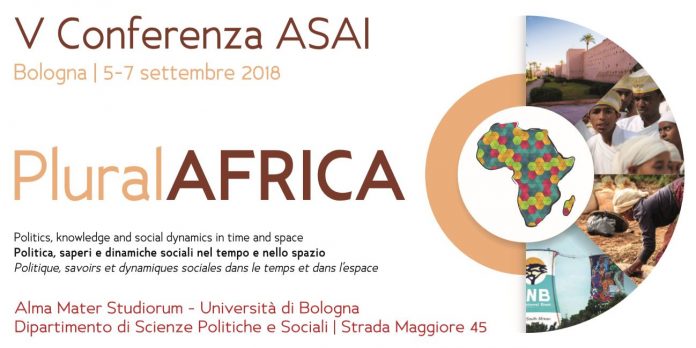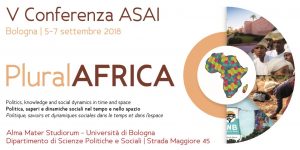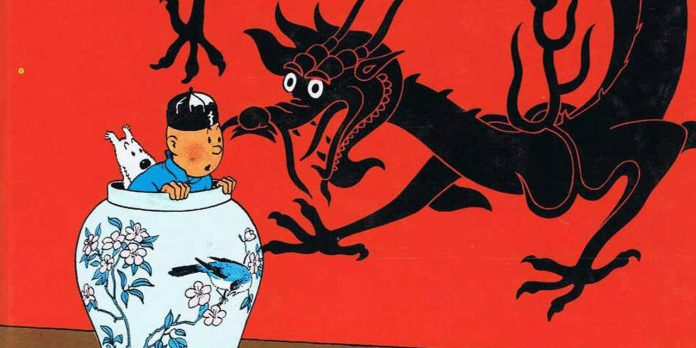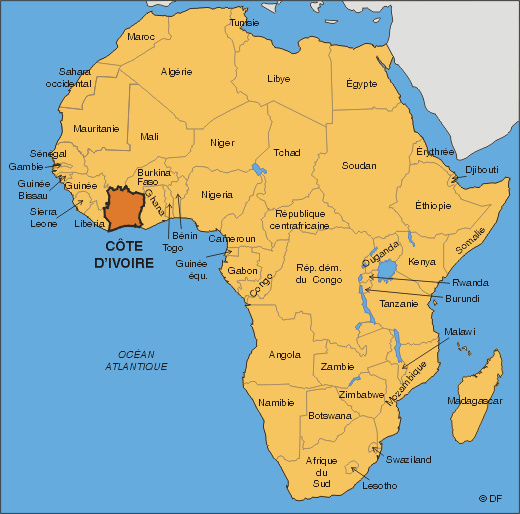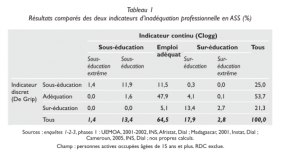Fille d’un diplomate sénégalais, Penda Cissé a voyagé aux quatre coins du globe durant son enfance. Une ouverture au monde dans laquelle elle puise son inépuisable inspiration. Après une expérience à l’international, elle a fondé, en Afrique, Piment bleu, une agence de communication globale, doublée de Co-Lab, un espace de co-working.
« J’ai passé la première partie de ma vie entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient. Ces déménagements successifs, liés à la carrière diplomatique de mon père, n’ont jamais été un problème. J’aime bouger, et faire bouger les choses. J’aime le challenge » analyse Penda Cissé.
Pour preuve, après de brillantes études en France, elle aurait pu se satisfaire d’une carrière toute tracée dans une grande entreprise. Mais la jeune femme a préféré partir pour de nouvelles aventures. Elle s’expatrie alors au Canada, puis à New York, où elle intègre l’univers du luxe made in France.
Son goût du changement la ramène sur le continent. « Pour moi, le retour en Afrique était conditionné à l’entrepreneuriat », souligne-t-elle. « Dans la mesure où, formée dans de grandes écoles, avec une expérience en management dans plusieurs multinationales pendant dix ans, je souhaitais rentrer en Afrique pour exprimer ma créativité. Il me semblait avoir acquis toutes les bases pour monter une entreprise viable ».

« Manager des équipes en Afrique, un véritable challenge »
La créativité est son principal leitmotiv. Mais avant de l’exprimer dans sa totalité, à travers l’agence de communication globale, Piment bleu, elle a dû s’adapter à son environnement et trouver ses marques. « Quand je suis arrivée en Côte d’Ivoire en 2011, un espoir immense marquait ce pays, considéré comme une terre d’opportunités. Le pays reprenait sa place de moteur dans la sous-région ouest-africaine, après des années de crise. Je pensais que cela serait un bon point de départ pour monter un business », se souvient Penda, avant de nuancer. « Mais je dois reconnaître avoir connu des difficultés d’adaptation au début. Car manager des équipes en Afrique s’est révélé un véritable challenge quand on a été comme moi formée à l’étranger. En Europe ou en Amérique du Nord, la liberté de parole prime. Alors qu’en Afrique, il faut avoir un management paternaliste, avec plusieurs niveaux de validation… Cela m’a effrayée à l’époque. Il fallait prendre en compte un environnement qui m’était étranger ».
Pourtant, Penda s’adapte rapidement et s’affirme. Avec un objectif : « mettre en place une chaîne de valeur fonctionnelle, un vrai défi. » Pour cela, elle innove. « Piment bleu se veut une agence de communication pluri-média, basée sur l’innovation, d’où le nom. L’idée consiste à proposer une perspective nouvelle et ouverte sur le monde, tout en restant fidèle aux codes de la culture africaine. » Cette idée constitue sa recette pour développer une entreprise en Afrique. « Nous sommes aujourd’hui précurseur sur les programmés télévisés dédiés à la bourse en Afrique. Nous avons lancé la première émission télévisée sur la chaîne publique ivoirienne, la RTI, « Flash bourse », une émission quotidienne qui donne les tendances du marché. » Ce programme porte une forte dimension pédagogique. Une tonalité que l’on retrouve dans un autre chantier de Penda : Le Co-Lab, un espace de co-working d’un nouveau genre. « La création de l’agence s’est accompagnée par celle de Co-Lab Abidjan, un lieu d’innovation, avec des espaces de travail en collaboration connectés que nos clients, les co-labeurs, peuvent utiliser de manière très flexible ».

Accompagner les jeunes entrepreneurs
Surtout, l’intégration de l’agence de communication Piment Bleu à cet espace de co-working crée sa particularité : « L’originalité de Co-Lab est d’appartenir à un grand groupe. Nous sommes à la fois un média pour nos entrepreneurs en herbe et un lieu d’innovation. Le concept ne se résume pas à un espace de travail. Même si l’environnement est conçu avec tous les éléments nécessaires, notre valeur ajoutée réside dans la mixité avec l’agence. L’idée est de permettre aux jeunes entrepreneurs de faire connaitre leur société, à travers un espace partagé avec l’agence et un réseau fourni. Co-Lab se veut une plateforme qui permet aux entrepreneurs d’être au cœur du système».
Et la stimulation semble réciproque : « Notre agence est elle aussi parfaitement intégrée dans la ville, dans son environnement, entourée de jeunes. Je reste convaincue que la communication doit se faire par des jeunes et pour des jeunes.» Cette proximité lui permet de mieux identifier les besoins de ces jeunes entrepreneurs. « Apprendre à pitcher (NDLR : résumer et présenter son projet à des investisseurs potentiels) notamment. Ils ont beaucoup d’idées. Mais, sans doute en raison de la faiblesse du système éducatif, ils peinent à expliquer leur projet. » Les femmes davantage encore, selon elle. « Les femmes africaines, en raison de leur culture, demeurent encore trop réservées, elles manifestent moins de confiance en elle. C’est leur talon d’Achille. Il faut par conséquent leur donner des outils pour gagner en assurance. Grâce à Co-Lab, elles peuvent bénéficier d’un accompagnement. ».

« La créativité permettra à la jeunesse africaine de se distinguer »
Car si Penda Cissé préconise une solide formation, comme composante majeure de tout projet entrepreneurial, sa recette comporte d’autres ingrédients tout aussi importants. « Incontestablement, il faut en premier lieu pousser les études le plus loin possible pour acquérir des qualifications, et ensuite s’enrichir d’une expérience professionnelle de qualité. Très souvent, les femmes évoluent dans l’informel. Il faut les convaincre de rejoindre le secteur formel, quitte à perdre quelques années de revenus. » Dernier conseil : adopter les outils du futur grâce à une expérience professionnelle dans une grande entreprise. « Cela me paraît indispensable pour la suite, qu’il s’agisse d’être employé ou de se lancer dans l’entrepreneuriat. Mais quelque soit l’option choisie, avoir un moral d’acier est primordial ! » Elle ajoute en guise de conclusion : « Il faut sortir des sentiers battus et innover pour avoir de l’avance sur les autres. La créativité permettra à la jeunesse africaine de se distinguer. L’innovation dans nos pays doit être stimulée chaque jour ».