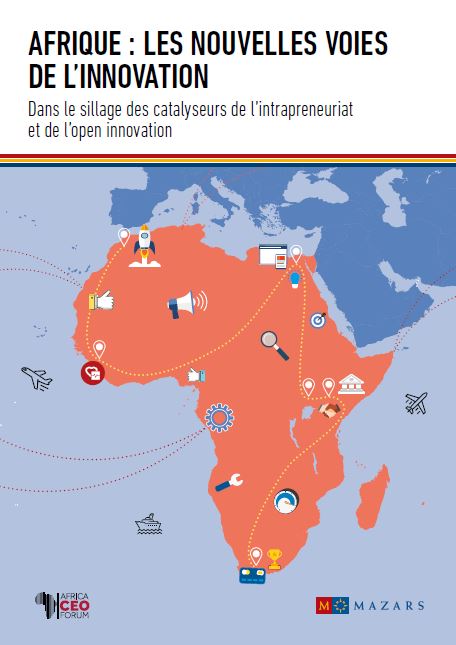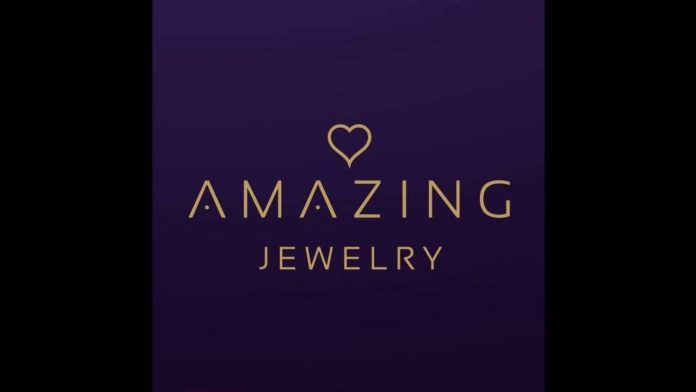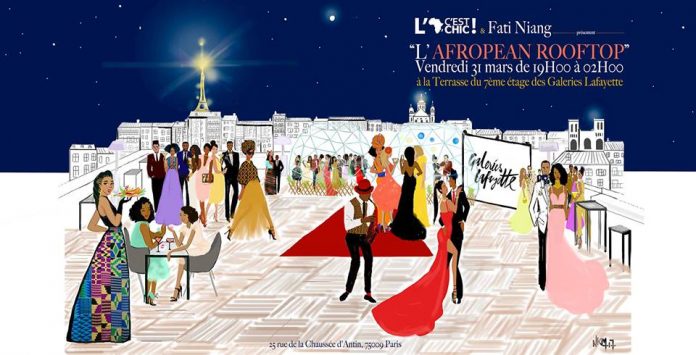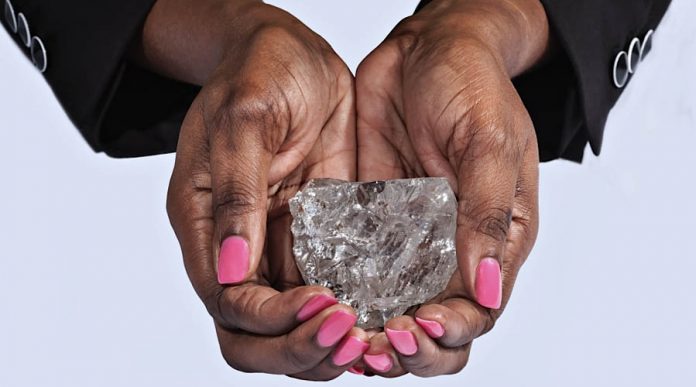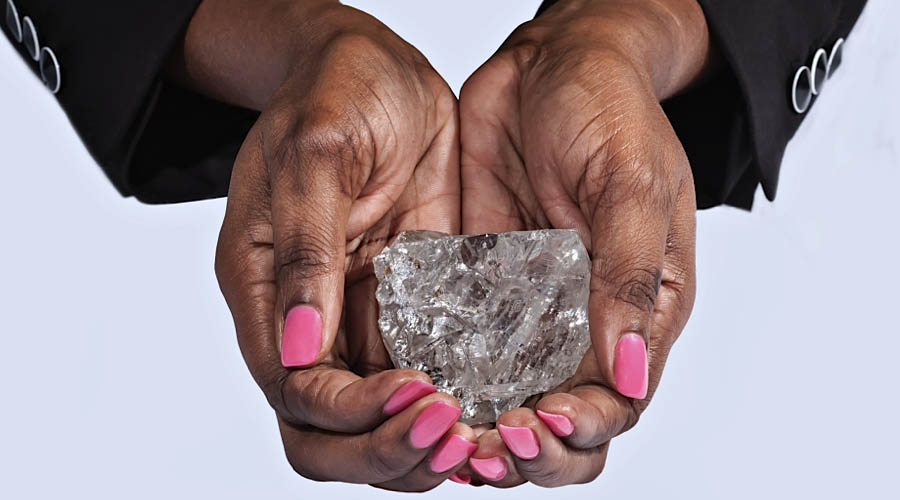Les Gouvernements africains doivent accorder la priorité à l’agriculture pour impulser la croissance économique et le développement inclusif
La Côte d’Ivoire abritera l’édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique (AGRA)
- Volonté politique plus forte et augmentation des dépenses consacrées à l’agriculture pour la transformation économique de l’Afrique.
- La Côte d’Ivoire abritera l’édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique (AGRA), une rencontre continentale de haut niveau. Les petits exploitants agricoles, véritables agents de changement au niveau de l’agroalimentaire prendront part aux discussions.
Les Gouvernements africains, les représentants du secteur privé, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement ont été invités aujourd’hui à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à redoubler d’efforts pour accélérer la marche de l’Afrique vers la prospérité, la croissance inclusive et la création d’emplois décents en traduisant les divers engagements agricoles en actions concrètes.
L’appel a été lancé lors de la cérémonie visant à désigner officiellement la Côte d’Ivoire comme hôte de l’édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique (AGRF) – principale rencontre continentale consacrée à l’agriculture – qui se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre 2017. Puissance agricole et pôle d’expertise en matière de petites exploitations agricoles, ce pays ouest-africain sera le premier pays africain francophone à abriter le forum annuel.
Choisie pour avoir su positionner l’agriculture au cœur de la transformation économique, la Côte d’Ivoire compte parmi le peu de pays africains ayant réalisé les plus importants investissements dans le secteur agricole, qui ont débouché sur d’importantes avancées dans le domaine de la productivité agricole et de la performance économique globale. Ces pays donnent un brillant exemple de la capacité du potentiel agricole africain à améliorer les conditions économiques sur le continent.
L’agriculture est de retour au sommet de l’agenda de développement de l’Afrique en tant que moteur économique de développement inclusif et durable
Sous le haut patronage de Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, l’AGRF édition 2017 aura pour thème «Accélérer la marche de l’Afrique vers la prospérité: contribuer à la croissance des économies et à la création d’emplois en Afrique à travers l’agriculture.»
Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre de l’Agriculture et du développement rural de la Côte d’Ivoire, a mis l’accent sur l’engagement de son pays à poursuivre l’amélioration du secteur agricole qui constitue la clé du développement économique.
« Cinq années d’importants investissements à travers le Plan national d’investissement agricole (PNIA) ont permis au pays d’autonomiser les agriculteurs et de les positionner au cœur de la transformation économique de la Côte d’Ivoire. La première phase du PNIA a contribué à une avancée significative de notre production agricole, avec plus de 17 millions de tonnes de produits vivriers en 2015 par rapport à 11.886 tonnes en 2012.
Nous sommes ainsi encouragés de voir nos efforts reconnus au niveau international. Nous sommes confiants que la phase 2 du PNIA, basée sur une approche plus intégrée et qui englobe la gestion des ressources hydrauliques, la santé, l’électricité et l’éducation, permettra davantage de faire sortir le paysan d’une situation de pauvreté et de stimuler notre économie. La Côte d’Ivoire s’est résolument engagée vers un développement de son économie agricole qui mérite d’être consolidé. »
L’agriculture constitue l’épine dorsale de l’économie ivoirienne
La croissance solide du pays est axée sur des investissements soutenus dans l’agriculture et les petites exploitations agricoles. Le secteur agricole représente 26% du PIB, 40% de toutes les recettes d’exportation, près de 75% des recettes d’exportation non pétrolière et une source d’emploi pour près de 60% de la population. Le Plan national de développement (PND) pour la période 2016-2020, qui vise à orienter le pays vers le statut de nation émergente d’ici à 2020, considère l’agriculture comme un pilier clé et en appelle surtout à une augmentation de la production agricole.
Lors de la cérémonie de lancement, Agnes Kalibata, Présidente de l’Alliance pour une Révolution verte en Afrique (AGRA), a déclaré ce qui suit : « L’agriculture est de retour au sommet de l’agenda de développement de l’Afrique en tant que moteur économique de développement inclusif et durable. Après l’édition 2016 de la campagne de l’AGRF, Saisir le Moment, et après avoir obtenu des engagements politiques, stratégiques et financiers de plus de 30 milliards de dollars américains, nous devons désormais mettre à profit cet élan de soutien en faveur de l’agriculture et nous assurer qu’elle contribue à la création d’emplois décents et constitue le moteur de la croissance économique sur tout le continent. »
Le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a abondé dans le même sens. Faisant référence à la priorité accordée au secteur agricole à travers la stratégie « Nourrir l’Afrique », Adesina a annoncé que « l’AGRF 2017 réunira des acteurs du secteur agricole africain en vue d’échanger des expériences sur les voies et moyens de relever les défis auxquels fait face l’agriculture en Afrique.
Le forum, qui accueillera des Chefs d’Etat ainsi que des ministres africains, des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires privées, des institutions financières, des chercheurs, des partenaires au développement et des organisations chargées de la mise en œuvre de projets agricoles, servira de plateforme permettant aux délégués de discuter et de promouvoir des politiques, des programmes, et des investissements innovants visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire.
Grâce à sa stratégie « Nourrir l’Afrique », la Banque africaine de développement augmentera ses investissements dans le domaine de l’agriculture à plus de 24 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. »