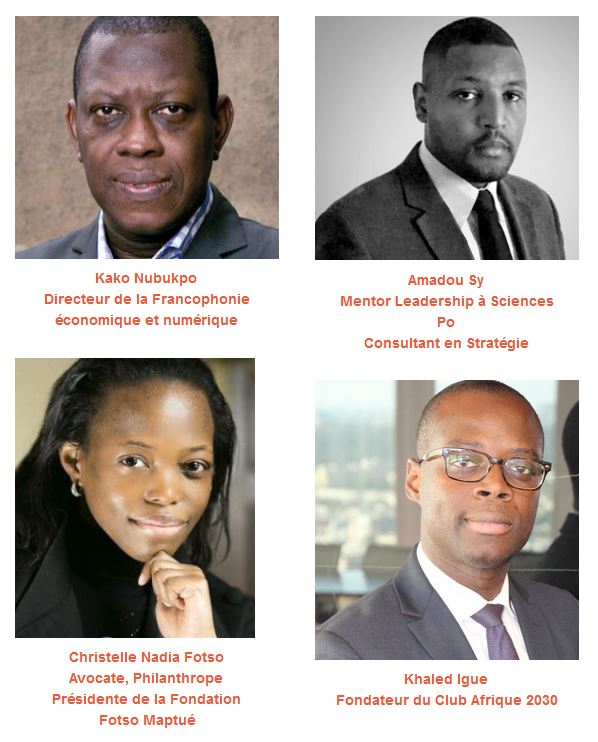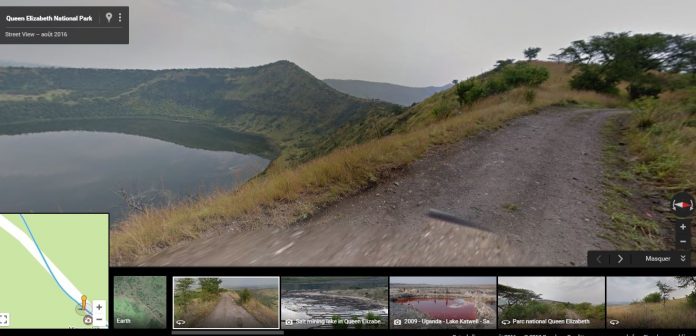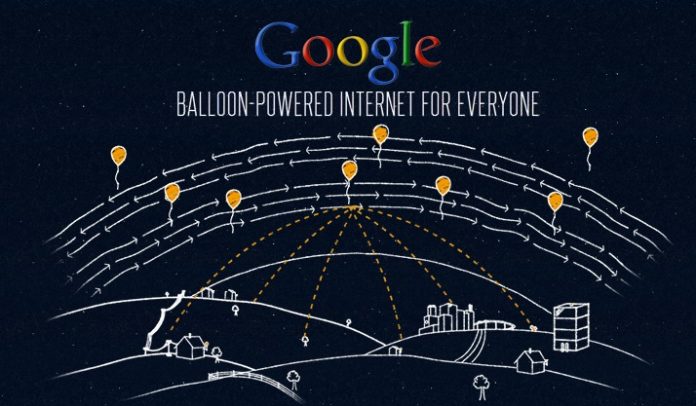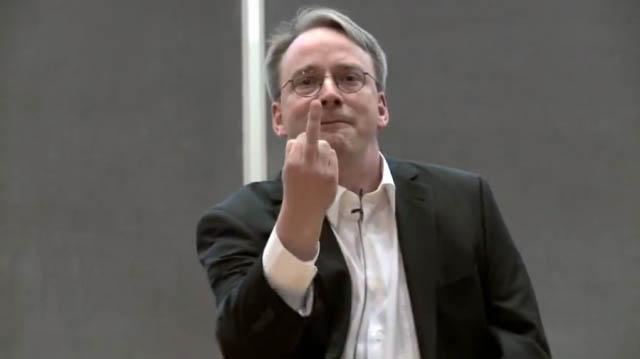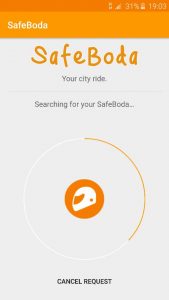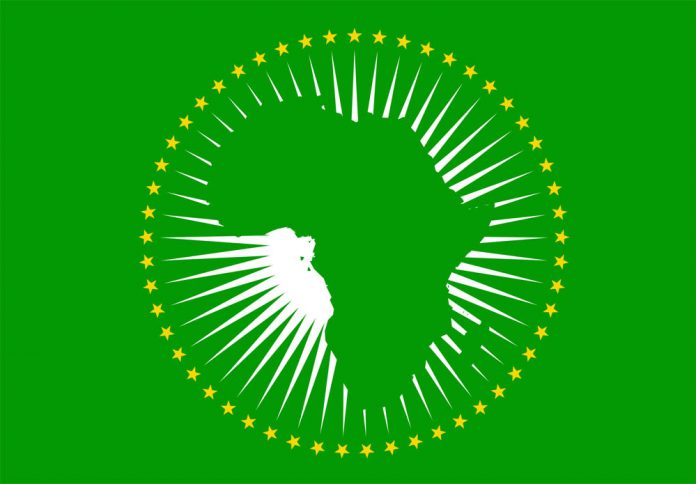Le prix de l’urbanisation et des désillusions
Effaçons tout de suite cette idée reçue qui veut que la prostitution soit le plus vieux métier au monde. La chasse, le travail de la terre, l’élevage, le commerce sont sans doute les premiers métiers au monde. Ils ont permis à la horde, au clan et à la communauté de survivre. Puis est venu le métier de tueur, de criminel : Caen est le premier grand criminel de l’Histoire de ce métier qui marche très bien en Occident et dans les pays de la terreur. La prostitution est probablement venue après, longtemps après, quand l’Homme a décidé de transgresser les bonnes mœurs, sans doute lassé de vivre sous le joug de la morale primitive et sage. Alors, il a fait de la femme, un objet de commerce, une marchandise. Il est fort probable aussi que ce soit la femme elle-même qui, consciente de l’attrait de ses atouts physiques, et de son pouvoir de séduction, ait décidé de monnayer ses charmes.
Dans un cas comme dans l’autre, la prostitution est là. Dans tous les pays. Même les plus officiellement puritains. En Côte d’Ivoire, notamment à Abidjan, elle a atteint un stade professionnel relativement élevé, à l’image de ce qui se pratique dans les grandes capitales du monde. Hôtels, bars, café, restaurants, parcs autos, rues, boulevards et ruelles, etc. Tous les lieux, des plus éclairés aux plus sombres et discrets, abritent désormais ces belles de nuit qui font le bonheur des amateurs de sensations fortes, ou d’expériences érotiques originales et souvent fortement transgressives : de la fellation ‘‘rapido’’ à l’échangisme, de la pornographie en direct, à l’accouplement par sodomie et peu orthodoxe, tout y passe. Au bout de l’exercice ou du spectacle, quelques billets de banque.
Les témoignages concordent à dire que c’est à partir des années 1990 que les Ivoiriennes ont commencé à investir ce secteur d’activités de façon professionnelle et industrielle. Avant cela, c’étaient les Ghanéennes, les Libériennes et quelques Togolaises qui pratiquaient ce commerce. Et c’était au cours des années 1960 et 1980. Ces années correspondent aux périodes de guerre et de troubles que leurs pays avaient connus. Puis Jerry Rawlings redressa le Ghana ; la guerre du Liberia prit fin elle aussi. Les Ghanéennes recouvrirent leur dignité, et beaucoup d’entre elles rentrèrent au pays où elles purent exercer une activité honorable. Vint le tour de la Côte d’Ivoire d’entrer dans les zones de turbulences.
La récession économique et les troubles politiques hypothéquèrent le marché de l’emploi. De nombreux jeunes prirent le chemin de l’aventure en Europe ; d’autres, celui de la prostitution. A partir des années 2000, le phénomène s’imposa à Abidjan comme un choix de vie, apparemment accepté par tous. De Treichville, ancienne base de la prostitution à Abidjan, à Port-Bouët, Vridi, Biétry, Cocody, Koumassi, Riviera, Yopougon, Adjamé, etc., c’est à une industrie en miniature du sexe, que nous avons affaire.
Dans un quartier comme Biétry, il ne manque plus que les magasins de sex toys et les enseignes lumineuses pour faire de certaines rues, des répliques de Pigalle. Mais ce n’est pas d’un paradis qu’il s’agit, car au-delà du décor, des sons décibels, au-delà aussi de l’ivresse que procure l’alcool, c’est d’un monde dur qu’il s’agit.

C’est dur madame
« C’est dur, Madame », me dit Luna (c’est son surnom). Luna a accepté d’échanger un peu avec moi sur son activité. « C’est pas tous les clients qui sont gentils. Beaucoup nous font faire de ces choses ; et après, ils ne te donnent pas grand-chose ». Je risque une question sensée : « Mais pourquoi ne pas encaisser d’abord l’argent avant de travailler ? » Elle rit : « Mais Madame, c’est après le travail qu’on paye, pas avant. C’est comme ça. Même vous, c’est à la fin de mois qu’on vous paie, non ? » Oui, elle a tragiquement raison…
La fin du mois. Combien gagne-t-elle à la fin du mois ? « Ça dépend », me répond Tina Turner. Elle est habillée dans le style de la star mondiale du rock. « Quand tu tombes sur beaucoup de bons clients, tu peux réunir 300 ou 400 000 F cfa à la fin du mois. Mais quand ça ne va pas, tu n’atteints même pas 80 000 F cfa. Et là, même le loyer devient un problème. »
L’âge de ses prostituées varie : des adolescentes (14 ans aux adultes 30-40 ans.) « Mais il y a les grandes sœurs. Ce sont celles qui sont plus âgées que nous, et qui font aussi ça. Elles ont leur appartement, parfois même elles vivent dans une villa. Elles gagnent plus d’argent que nous. » Celle qui me donne cette information refuse de décliner son nom.
Bien malin qui pourrait identifier et énumérer tous les lieux de pratique de la prostitution. On retient tout simplement que cette activité ne se pratique plus, ou du moins se fait rarement, aux domiciles des prostituées. Ces lieux portent des noms évocateurs : « Toi et moi » ou TM, « Mixx Plus », « La Croisette », etc. A première vue, ces endroits ne présentent rien de suspect. Ce sont des bars ou des boîtes de nuit comme l’on en voit partout à Abidjan. Mais en réalité, nombre d’entre eux ont acquis leur notoriété dans la pratique de la prostitution.
Ils sont situés en grande majorité dans les quartiers de Zone 4 et Biétry. Ils emploient de nombreuses jeunes filles comme serveuses. A l’origine, elles sont recrutées comme de simples serveuses. C’est à la pratique qu’elles se retrouvent, contre leur gré, pour la plupart, à l’exercice de la prostitution. « A la demande d’un client, on fait l’amour ou juste une pipe selon les désirs du demandeur. Il y a toujours une ou quelques pièces privées, aménagées pour la circonstance ; ou même dans les fauteuils où sont installés les clients », me révèle Bodjo star. Rondelette. Des hanches larges mettant en relief des fesses charnues et lourdes. Une poitrine fournie, à provoquer des suffocations. Une autre de ces adeptes de Lolo Brigida.
Les formules de prestation de services varient aussi : duo, trio, paires de couples, pratiques lesbiennes, ou show individuel pour un client, un couple ou un groupe de clients.
Inutile de demander qu’est-ce qui a bien pu amener ces jeunes filles à se livrer au commerce de leur corps ? On doit pouvoir se le dire une bonne fois pour toutes : nul ne se prostitue de gaîté de cœur ni par fantaisie. Ici, une seule raison, cruciale, explique ce choix extrême : le besoin dû à la pauvreté ou à de cruelles circonstances de la vie :
« J’ai été très tôt orpheline de mère. Mon père s’est remarié avec une femme qui me détestait mes trois frères et moi. Parfois et même souvent, on n’avait pas droit au repas. Notre père, chauffeur de grumier, n’était pas le plus souvent à la maison. Elle lui a fait perdre la tête. Il en est arrivé à refuser de payer nos frais d’inscription scolaire, ainsi que les uniformes, les livres et cahiers. Des amies m’ont parlé d’une possibilité de gagner de l’argent pour m’occuper de mes frères. Voilà comment j’en suis arrivée à mettre fin aux études pour sauver mes frères. »
Deux filets de larmes s’écoulent de ses yeux. Elle s’appelle… Salomé ! On ne pouvait trouver mieux. Elle a arrêté les études en pleine scolarité, à la classe de première D. Cela fait quatre ans qu’elle est dans le système : « Mes deux premiers petits frères ont eu à présent le bac. Un est au Cafop. Il sortira instituteur ; l’autre est à l’université. Dans deux ans, je vais arrêter pour reprendre les études ou bien apprendre un autre métier moins risqué. Mes frères vivent chez moi. ».
Salomé est belle. Elle s’exprime très bien. Elle fait ‘‘classe’’. On la croiserait en ville, en pleine rue, qu’il serait impossible de l’imaginer dans ce rôle. Elle remporterait aisément le concours national de miss. « J’ai peur du public », me dit-elle quand je lui parle de ça. « Et puis, j’ai besoin d’argent pour mes frères, pas de titre de Miss. Notre problème c’est la survie quotidienne ».
Survie quotidienne ? J’émets un peu de réserve sur son cas. Salomé a une bonne clientèle : les Européens. Ils paient bien, avoue-t-elle. Impossible donc de laisser une telle manne pour se risquer dans la recherche d’un métier aussi hypothétique que certainement mal rémunéré.
LES DEVIANTS
Les Blancs. C’est la grande aubaine pour ces fées de nuit. Filles noires, elles bénéficient de préjugés favorables : un mythe tenace dans l’esprit des Blancs veut que la femme noire soit plus performante et plus délicieuse au lit que la Blanche. Un ami professeur de musique m’a dit un jour que, sur ce terrain, une Noire vaut deux Blanches ! Mariama témoigne : « Je les rends fou. Ils me hurlent qu’ils n’ont jamais connu ça avec les Blanches. Il y en a un qui a failli s’évanouir dans mes bras, un jour. J’ai eu très peur. Mais il m’a bien payé : 200 000 F cfa, la seule nuit. C’était un touriste suisse ; il rentrait dans son pays le lendemain ».
Une autre, étudiante, qui refuse elle aussi de me dire son nom, raconte un épisode singulier. « Moi mon Blanc avait des tendances bizarres. C’était un officier de l’armée ; il me donnait un fouet, je l’enchaînais et je le flagellais. Et il jouissait. Mais il avait commencé à demander des coups de fouet de plus en plus forts. Et moi j’avais peur de le blesser. J’ai donc arrêté de le voir. Il payait bien lui aussi. Quand je l’ai bien flagellé, il me donne au moins 100 000 fois. On faisait deux ou trois, parfois quatre séances de flagellation dans le mois. Mais je l’ai fui. J’ai eu peur de le tuer un jour. C’était un fou ».
Fou, certainement ces Blancs. « Il y en a d’autres dont le plaisir est de nous regarder faire l’amour avec un ou d’autres hommes ». Maï, 24 ans, élancée, et riche d’une paire énorme de seins, affirme. « J’ai un client comme ça. Lui ne me touche pas. Il vient avec deux de ses amis pour me faire ça, et il regarde. Je prends 60 000 F pour chaque homme. Un jour, il est venu avec quatre mecs. Ca faisait 240 000 F ; mais j’ai refusé. Ils étaient trop baraqués ».
Les plus mauvais payeurs, à les en croire, ce sont les Noirs, surtout les compatriotes ivoiriens. Ce sont des voyous. C’est Parfaite O. qui me dit ça. 28 ans. Trois enfants à charge. De pères différents, qui ne s’en occupent pas. « Quand il faut payer, ils donnent à peine 3 000 f Cfa. Il y en a qui vous tendent un billet de 1000 F cfa. Moi je ne fais plus avec les Noirs, surtout les Ivoiriens. Ils ne sont pas sérieux. Ma sœur, nous souffrons ».
Souffrances. C’est bien le cas de Sonia Coulibaly. Environ 19 ans. L’école, pour elle, s’est arrêtée à la classe de 5eme. Serveuse dans un bar dont elle a décidé de taire le nom. Quatre années d’expériences, elle aussi. « C’est à la suite du divorce de mon père et de ma mère que je me suis retrouvée à chercher du travail. Lorsque ma mère est partie, notre marâtre s’est mise à nous maltraiter mes quatre frères et moi. J’ai été servante chez un couple avant de me retrouver ici dans ce bar. Au début, la patronne m’avait dit que c’était pour servir la boisson aux clients. Mais au fil des jours, je suis abordée par les clients pour d’autres services : faire l’amour avec les clients qui le désirent. Et c’est la patronne qui nous encourage à faire ça ».
Zaran Konaté a subi la même expérience : « Ce n’est pas seulement le service de boisson que nous faisons. On s’occupe totalement des clients en faisant notamment l’amour, à leur demande. Ça peut être une pipe ou une relation sexuelle à proprement parler, moyennant de l’argent. » Mais ce n’est pas aussi bien payé que dans la rue où on rencontre des clients qui donnent parfois beaucoup d’argent.
Anne-Lise raconte, elle aussi, sa mésaventure avec un client. « Un jour, je me suis retrouvée avec un client habituel du bar. Un Ivoirien. Nous sommes allés dans l’espace privé. J’ai fait tout ce qu’il m’a demandé. A ma grande surprise, au moment de me payer la prestation, il a prétexté avoir perdu de l’argent. Aussitôt, il m’a accusé d’avoir volé son argent. Il m’a même frappé. Finalement il ne m’a rien payé et j’ai été contrainte par la patronne de lui rembourser son argent, presque 200 000 F. Une somme que je n’avais pas.
Terrible ! Tout tragiquement terrible, le métier de prostituée. Une seule chose rassure : elles utilisent toutes, des préservatifs. Les campagnes contre le VIH ont donc porté. Mais le corps reste soumis à un usage forcené que ces jeunes femmes paieront forcément cher le reste de leur vie.