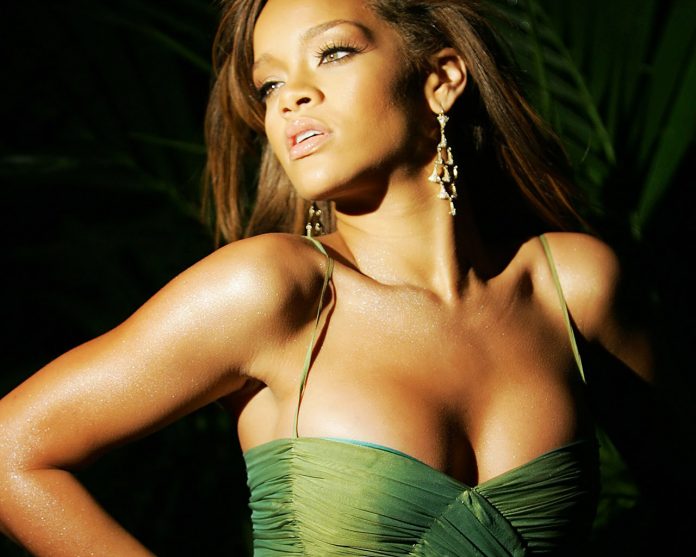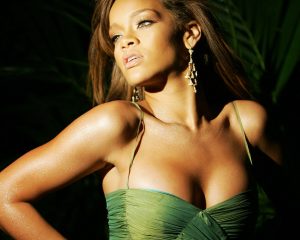Le secteur du tourisme en Afrique subsaharienne pourrait bientôt offrir de nouvelles destinations, et s’accompagner de stratégies misant sur l’écotourisme, la diversification et l’essor des marchés asiatiques.
Plus d’authenticité, plus d’offres différentes…
C’est en substance le créneau porteur pour le tourisme en Afrique, selon l’étude du centre de recherche spécialisé en intelligence économique Euromonitor International.
Selon cette étude, trois pays ont toutes les cartes en main pour voir leur secteur touristique connaître une croissance importante: du côté des outsiders, le Rwanda et la Sierra Leone, et, du côté des destinations touristiques déjà reconnues, la Tanzanie.
Ces pays pourraient bien se faire une place au côté des «vaisseaux amiraux» du tourisme en Afrique subsaharienneque sont le Kenya et surtout l’Afrique du Sud (cette dernière concentre plus du tiers des recettes du tourisme en Afrique subsaharienne).
Le Rwanda, paradis de l’écotourisme
Avec une progression notable de +3% du nombre de visiteurs en 2011, le Rwanda a atteint les 723 000 touristes.
Ces chiffres sont à prendre avec précaution, du fait des migrations de populations venues de RDC (16,5% des entrées), d’Ouganda(13,5%) et de Tanzanie (7,4%) dont toutes ne sont pas touristiques.
Les marchés émetteurs de touristes non-africains sont avant tout les Etats-Unis (3,6%), la Belgique (2%) et le Royaume-Uni (1,5%).
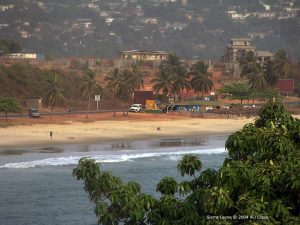
L’observation des gorilles dans les montagnes, attrait touristique du Rwanda depuis plusieurs années, est en passe d’inspirer une stratégie plus générale de positionnement sur l’écotourisme: les autorités diversifient leur offre en la matière, en proposant désormais des promenades dans la canopée, à 150 mètres de hauteur, des parcours dédiés à l’observation des oiseaux, ou encore le sentier pédestre du Congo Nile Trail.
Ce dernier, long de 227 km, est ainsi mis en avant à grand renfort de publicité comme la vitrine du Rwanda comme destination écotouristique.
Les autorités rwandaises tentent ainsi d’associer la protection de l’environnement avec la construction d’un modèle économique rural, concurrent de l’économie du braconnage.
En parallèle, Kigali a lancé une politique intitulée «Look East Policy» (politique tournée vers l’est) par laquelle le gouvernement espère attirer un nombre croissant de touristes en provenance d’Extrême-Orient.
Selon l’étude, «cela aidera à accroître le nombre d’arrivées de touristes et à gonfler considérablement les recettes du tourisme.»
Leprojet de second aéroport international au Rwanda ou la perspective de voir le pays adhérer au visa touristique unique de la communauté est-africaine pourrait également favoriser cette politique de développement du tourisme.
La Sierra Leone peut miser sur son authenticité
«La Sierra Leone est un petit pays, mais avec un potentiel certain pour devenir une destination touristique majeure»,assure l’étude.
Après plusieurs années de troubles, le retour au calme, associé aux campagnes promotionnelles du gouvernement (vidéo ci-dessous, en anglais), pourraient s’avérer payantes, selon Euromonitor International.
Car la Sierra Leone joue une carte précieuse: la promesse d’une destination parmi les moins défigurées par le tourisme, indique l’étude:
«Les points d’attraction du pays, des plages aux réserves naturelles en passant par les montagnes, fournissent une base solide pour l’avenir et offrent une opportunité considérable pour développer le tourisme dans la région.»
En 2011, la fréquentation touristique en Sierra Leone a augmenté de 2%, atteignant les 45 537 entrées.
L’attention croissante des compagnies hôtelières pourrait bien aider le pays à surmonter son handicap côté infrastructures.
La Tanzanie, une croissance du secteur touristique tous azimuts
Avec 5% de croissance en 2011, la fréquentation touristique de la Tanzanie montre sa bonne vitalité. Mais le ralentissement de l’activité économique en Europe et en Amérique du Nord inquiète les autorités.
Le gouvernement tanzanien a donc lui aussi commencé à s’intéresser aux marchés émetteurs des pays asiatiques, expliquent les auteurs de l’étude:
«Dans un effort pour rester compétitif et attractif pour des touristes potentiels, le gouvernement tanzanien a lancé une nouvelle campagne baptisée « Think Asia » (Pensez Asie), en cherchant à toucher une part du marché du voyage asiatique, en pleine croissance.
À la recherche de touristes originaires des marchés émergents comme la Chine, l’Inde et la Russie, le gouvernement a utilisé ses missions étrangères et ses ambassades dans ces pays pour faire la promotion de son offre touristique.»
Le Tanzania Tourist Board (TTB) voit même plus loin: fort de chiffres de fréquentation encourageants de la part des pays du Moyen-Orient, le TTB espère beaucoup des liaisons aériennes vers ces pays.
Le gouvernement vise également le Brésil, et a installé dans la capitale Brasilia une représentation diplomatique.
Mais pour progresser, la fréquentation touristique en Tanzanie devra passer, selon l’étude, par une diversification de l’offre. Le segment safari, selon l’étude, ne pourra plus suffire.
Déjà, la Tanzanie développe des produits touristiques autour du sport, ou à destination d’une cible familiale (positionnement bien avancé sur le marché italien) ou encore le tourisme médical (le complexe immobilier de Dar Es Salam décidé récemment prévoit entre autres un hôpital dédié au tourisme médical).
Cette diversification est même devenue, pour l’étude, un impératif de survie, alors que la compétitivité touristique de la Tanzanie a chuté au cours des dernières années :
«C’est une indication claire selon laquelle il y a un besoin d’accroître l’investissement dans le tourisme afin de faire du pays une destination plus attractive à l’avenir.»
Thierry Barbaut
Source: www.slateafrique.com

















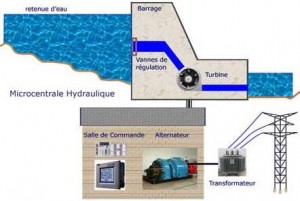




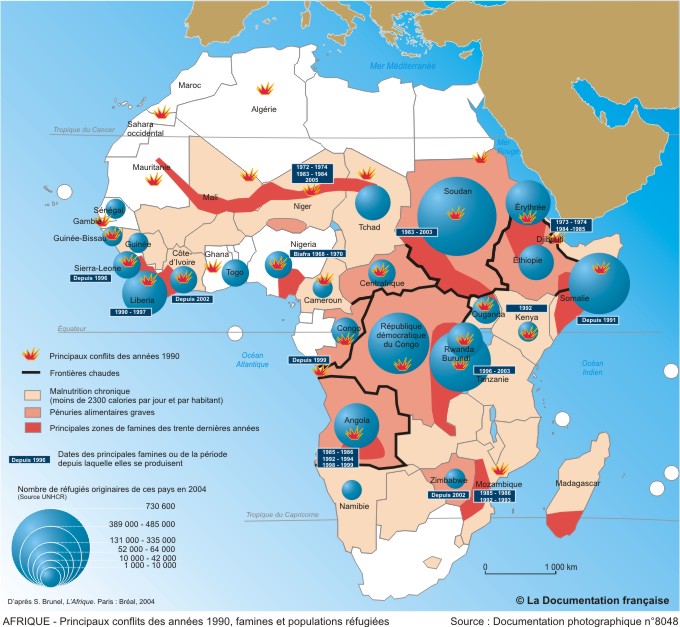
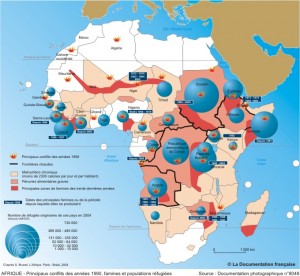
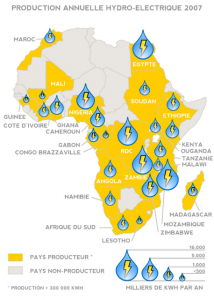



























 La passion de l’art contemporain africain habite cet espace du sud de la
La passion de l’art contemporain africain habite cet espace du sud de la  Si le
Si le 

 On connaît la Biennale de Dakar, dont la dernière édition a eu lieu sous la houlette du nouveau ministre de la Culture,
On connaît la Biennale de Dakar, dont la dernière édition a eu lieu sous la houlette du nouveau ministre de la Culture,  Des sièges aux formes ludiques et confortables, des couleurs qui enchantent un décor, le designer malien Cheick Diallo a imposé son style depuis plus de vingt ans, les boutiques pour bobos s’en sont largement inspirées, mais, lui, c’est la rue qui l’inspire, depuis toujours. Le chef de file du design africain s’expose au musée Mandet à Riom avec « Made in Mali ». Si vous passez par là… Vous ne le regretterez pas !
Des sièges aux formes ludiques et confortables, des couleurs qui enchantent un décor, le designer malien Cheick Diallo a imposé son style depuis plus de vingt ans, les boutiques pour bobos s’en sont largement inspirées, mais, lui, c’est la rue qui l’inspire, depuis toujours. Le chef de file du design africain s’expose au musée Mandet à Riom avec « Made in Mali ». Si vous passez par là… Vous ne le regretterez pas ! On retrouvera Cheick Diallo cet hiver au musée Dapper, où s’ouvrira à partir d’octobre une grande exposition sur le design en Afrique : « S’asseoir, se coucher et rêver ».
On retrouvera Cheick Diallo cet hiver au musée Dapper, où s’ouvrira à partir d’octobre une grande exposition sur le design en Afrique : « S’asseoir, se coucher et rêver ».
 « Danse l’Afrique danse » en Afrique du Sud
« Danse l’Afrique danse » en Afrique du Sud