Google propose des visites virtuelles des réserves en Afrique
Google:
Google propose des visites virtuelles des réserves en Afrique
Google:
Ouverture de la session 2018 du programme de recrutement d’étudiants-chercheurs africains du Groupe de la Banque mondiale. Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir votre dossier de candidature. La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 19 novembre 2017.
WASHINGTON, le 26 septembre 2017 – La Région Afrique du Groupe de la Banque mondiale organise pour la troisième année consécutive son programme de recrutement d’étudiants-chercheurs et de jeunes docteurs ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, afin d’attirer de nouveaux talents africains.
Cette année, le programme est géré par le bureau de l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, en collaboration avec le pôle Fragilité, conflits et violences. Lancé en 2013 par Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, ce programme veut créer un réseau de chercheurs et de professionnels originaires d’Afrique subsaharienne. Il s’adresse en particulier aux femmes qui envisagent de travailler dans le domaine du développement, dans leur pays ou à l’étranger, et qui souhaiteraient intégrer le Groupe de la Banque mondiale. Un grand nombre des candidats ayant suivi avec succès ce programme, ont rejoint le Groupe de la Banque mondiale à l’issue du programme. Les autres poursuivent une carrière prometteuse dans le domaine du développement, ailleurs dans le monde.
Descriptif du programme
Les candidats retenus effectueront un séjour de six mois minimum au siège du Groupe de la Banque mondiale ou dans ses bureaux de pays afin d’acquérir une expérience pratique des métiers du développement. Cette expérience comprend notamment la production et la diffusion de travaux de recherche, la conception de politiques publiques aux niveaux national et international et le renforcement des institutions, en vue d’encourager une croissance inclusive dans les pays en développement. Tout en bénéficiant des recherches et des innovations dans de nombreux secteurs, les candidats retenus mèneront des recherches, travailleront sur les politiques économiques et l’assistance technique ainsi que sur les opérations de prêt qui sont au cœur du double objectif de la Banque mondiale pour mettre fin à la pauvreté et promouvoir une croissance économique équitable.
Cette année, grâce à la générosité de l’Agence britannique de développement international (DFID), dix postes supplémentaires seront offerts, sur le thème des déplacements forcés. Les dix candidats retenus effectueront des recherches sur cette question dans le contexte des opérations menées par le Groupe de la Banque mondiale ou le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud ou au Moyen-Orient. La priorité sera accordée aux candidats issus de communautés de réfugiés ou de déplacés ou à des personnes ayant une expérience avérée des déplacements forcés. Les candidats retenus manifestant un vif intérêt dans ce domaine travailleront sur des programmes de recherche consacrés aux réfugiés, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et aux communautés d’accueil.
Les candidats retenus devront réaliser ou préparer un projet de recherche qu’ils présenteront au personnel du Groupe de la Banque mondiale. Les meilleurs travaux pourront faire l’objet d’une diffusion en interne. Pour les candidats retenus, ce programme sera l’occasion d’avoir :
Conditions d’admission
Peuvent déposer leur candidature, des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne ayant récemment obtenu leur doctorat ou des étudiants en dernière année de doctorat dans les domaines suivants : économie, statistiques appliquées et économétrie, évaluation d’impact, éducation, santé, énergie, agriculture, infrastructures, démographie, déplacements forcés et tous les champs du développement.
Les candidats doivent :
Les caractéristiques suivantes seront un plus :
Procédure de sélection
La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 19 novembre 2017. Après avoir postulé en ligne, les candidats les plus qualifiés seront sélectionnés et leur dossier de candidature sera soumis aux responsables de la région Afrique du Groupe de la Banque mondiale et aux départements participant à ce programme. Ces derniers feront ensuite connaître leurs choix définitifs et définiront les projets à entreprendre.
Une fois avisés et l’offre acceptée, les candidats retenus seront embauchés comme consultants pour une période de courte durée, d’un minimum de six mois. Ils seront rémunérés, bénéficieront d’un vol aller-retour en classe économique entre leur université et Washington, DC ou le bureau de pays de la Banque mondiale auquel ils seront affectés, et seront assurés contre les accidents du travail.
Ouvert jusqu’au 30 janvier 2018, l’appel à candidature est ouvert aux projets pilotes ou en exploitation utilisant les technologies de l’information et de la communication pour améliorer l’accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays du Sud. Les porteurs de projets sont invités à soumettre leur initiative en remplissant le formulaire en ligne.
Les projets retenus seront référencés dans l’Observatoire de la E-Santé dans les pays du Sud et un jury sélectionnera les lauréats des prix de l’Observatoire qui seront remis le 2 juillet 2018 à l’occasion de la Conférence annuelle de l’Observatoire.
Fidèle à sa mission d’améliorer l’accès aux soins et aux médicaments de qualité, la Fondation Pierre Fabre a pris la mesure des enjeux liés à l’essor des nouvelles technologies en créanten 2016 l’Observatoire de la E-Santé dans les pays du Sud. Cet observatoire a pour missions d’identifier, de documenter, de promouvoir, et d’aider à développer les initiatives e-santé qui améliorent l’accès aux soins et aux médicaments de qualité pour les populations les plus défavorisées dans les pays à ressources limitées. Il se positionne comme un référent et une passerelle pour le développement de la e-santé dans les pays du Sud. Le site www.odess.io est une base de données ouvertes qui centralise les données disponibles sur les initiatives référencées.

Actuellement, 95 % de la population mondiale est couverte par un réseau cellulaire qui compte plus de 7 milliards d’abonnements. Le taux de pénétration d’Internet est passé de 6 % en 2000 à 43 % en 2015, reliant 3,2 milliards de personnes entre elles. Cette révolution concerne aussi les pays du Sud, en particulier avec l’adoption massive du téléphone portable.
Ces nouvelles technologies offrent la possibilité de créer des outils adaptés, durables et soutenables pour améliorer la santé des populations, particulièrement dans les zones où règne une pénurie de personnel et d’infrastructures. En participant à la réduction du coût de l’accès à la santé, en fournissant aux populations des informations pour la prévention et le dépistage précoce des maladies, en contribuant à lutter contre les épidémies et en visant à améliorer la couverture vaccinale et l’accès aux médicaments de qualité, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont une formidable opportunité pour la santé des populations des pays du Sud.
En 2017, parmi les 71 initiatives recensées, 9 ont été mises à l’honneur et ont bénéficié d’un accompagnement financier et technique d’1 an par la Fondation Pierre Fabre. Découvrir les lauréats 2017
Comment référencer son initiative e-santé dans l’Observatoire?
Sur le site www.odess.io les porteurs de projets sont invités à remplir un formulaire pour que leur solution soit référencée sur la base de données ouverte de l’Observatoire.
Comment concourir aux prix de l’Observatoire ?
Une fois le formulaire de référencement envoyé, les porteurs de projet pourront postuler pour concourir aux prix de l’Observatoire. : http://www.odess.io/proposer-une-initiative.html
Un Jury examinera les projets soumis et les lauréats seront invités à recevoir leur prix lors de la conférence du 2 juillet 2018, au siège de la Fondation (Lavaur, France).
Le rapport « Doing business 2018 » est enfin disponible et comme pour 2017 le Mroc, Maurice et le Rwanda sont en tête mais c’est le Rwanda qui assure la meilleure performance !
Doing Business 2018: Réformer pour créer des emplois est une publication phare du Groupe de la Banque Mondiale et est la 15ème d’une série de rapports annuels mesurant les régulations favorables et défavorables à l’activité commerciale. Doing Business présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des affaires ainsi que sur la protection des droits de propriété de 190 économies – de l’Afghanistan au Zimbabwe – au fil du temps.
Doing Business mesure les réglementations concernant 11 domaines du cycle de vie d’une entreprise. Dix de ces domaines sont inclus dans le classement de cette année sur la facilité à faire des affaires : création d’entreprise, l’obtention d’un permis de construire, raccordement à l’électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l’insolvabilité. Doing Business mesure également la réglementation du marché du travail, ce qui n’est pas inclus dans le classement de cette année.

Les données de Doing Business 2018 sont mises à jour en date du 1er Juin 2017. Les indicateurs sont utilisés pour analyser les résultats économiques et identifier les meilleures réformes de la réglementation des affaires, en fonction de l’endroit et de l’objectif.
Trait d’union entre « l’Afrique musulmane » et » l’Afrique chrétienne et animiste », la RCA souffre depuis son accession à l’indépendance de plusieurs crises politico-militaires.
Depuis 2013 et l’arrivée au pouvoir de la coalition Seleka menée par Michel Djotodia, les affrontements entre différentes parties ont rapproché le pays d’un phénomène qu’on pourrait qualifier de génocide. Ces massacres qui ont fait plus de 3000 morts sont souvent perçus comme des affrontements entre musulmans et chrétiens, donc une crise d’ordre confessionnel. Qu’en est-il réellement ?
Des puissances régionales et occidentales jouant au pompier pyromane
Cinq, c’est le nombre de coups d’Etat francs qui ont installé au pouvoir cinq présidents sur neuf en Centrafrique depuis 1960. Ces alternances violentes sont le résultat de plusieurs facteurs internes et externes qui ont plongé ce peuple dans le chaos depuis des décennies. Le premier coup d’Etat qui a renversé David Dacko en 1965 a été signé par Bokassa avec l’aide de la France à travers l’opération « Barracuda » de l’armée française pilotée depuis la capitale tchadienne. Face à Dacko qui se tourne vers la Chine, nouvelle économie montante de l’époque, il s’agit pour la France, d’avoir un homme qui puisse garantir sa mainmise sur les richesses naturelles, notamment l’uranium pour l’approvisionnement des centrales nucléaires. L’autre cas, le plus récent d’ailleurs est celui de Bozizé qui, aidé par le Tchad et la France, à sa prise de pouvoir s’est détourné peu à peu du régime de Deby mais aussi de la France et les Etats-Unis pour pactiser avec l’Afrique du Sud et l’Ouganda, qui visent l’or et le diamant centrafricains. Connaissant le Tchad et la France, Bozizé cherche d’autres alliés. Résultat, il est renversé par la Seleka, soutenue en hommes et matériels par le Tchad et la France.

Il apparaît à travers ces exemples que l’absence d’alternance pacifique a instauré une course au pouvoir sanglante qui a distillé les germes de la violence politique. Les puissances régionales et étrangères, cherchant à faire avancer leurs pions, se sont souvent ingérées d’abord en attisant le feu, et ensuite l’éteindre pour se faire passer pour des sauveurs. Cette stratégie leur a permis d’avoir un accès privilégié aux ressources et de s’accaparer les contrats juteux à travers des accords de coopération douteux.
L’exclusion et l’absence d’état de droit ont fait le lit de la violence
Les différents régimes qui se sont succédés à Bangui ont chacun contribué à la genèse de ces crises de violence que vit le pays. C’est le cas de Patassé qui à sa prise de pouvoir par voix démocratique en 1993 a entamé une politique tribaliste en s’entourant des proches de son parti et de son groupe ethnique (les Kaba). Les nominations à des postes de responsabilité se font dans cette sphère privilégiée autour du parti au pouvoir. Les autres partis et leaders politiques sont systématiquement étouffés ou mis en marge de la gestion du pays.
Le Nord Centrafrique abrite la majorité des musulmans du pays qui sont des pasteurs nomades ou semi-nomades originaires du Tchad et du soudan. Les régions de Haute Kotto et le Bamingui Bangoran où vit la majorité de ces nomades musulmans sont abandonnées entre les mains des groupes armés comme la LRA qui organisent des massacres et exploitent illégalement les ressources minières. Selon le Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté 2011-2015, ces régions, sans structures de base, vivent sous le poids de la pauvreté avec un taux de plus de 84%.
Après Patassé, Bozizé surfe sur la même vague tribaliste pour exclure de sa politique le nord musulman. Les pasteurs musulmans sont désignés comme des étrangers venus détruire les champs et les zones de chasse. Tout le monde s’attendait à ce qu’il y’ait des tracés de couloirs de pâturages pour éviter les affrontements récurrents entre les communautés mais le régime de Bozizé n’a rien fait. L’absence de définition et de protection des droits de propriété de la part de l’Etat et celle d’institutions capables de régler la question des terres ont créé les conditions favorables à l’escalade des violences communautaires.
Face aux cultivateurs et à l’absence de l’état de droit, la minorité musulmane se voit obligée de trouver des moyens de survie. Naissent alors plusieurs mouvements politico-militaires comme le CPJP, UFDR… qui se réunissent en coalition, la Seleka, composée majoritairement des nomades musulmans qui revendiquent de meilleures conditions de vie et à profiter davantage de la redistribution des revenus par l’Etat. Face à une Seleka aidée par des mercenaires tchadiens et soudanais, Bozizé se sent menacé. Il essaie de fédérer le peuple autour de lui en désignant la Seleka comme un mouvement islamiste. C’est l’entrée de la dimension religieuse dans la guerre.
La religion, un prétexte pour se venger de l’autre
Bozizé perd ses alliés sud-africains et ougandais suite aux accords politiques de 2013, il est chassé du pouvoir. La Seleka avec à sa tête Djotodia a pris le pouvoir dans un pays où il n’y a pas l’ordre public, ni ressources nécessaires pour relancer la machine économique. Cherchant à récupérer les armes qui se retrouvent au sein de la population à travers les hommes fidèles à Bozizé, les ex-rebelles, désormais au pouvoir en profitent pour piller, massacrer et commettre des viols. Face à ces hommes qui prennent tout le pays comme butin de guerre, le reste de la population à dominance chrétienne et animiste généralement anciens hommes du régime Bozizé, crée le mouvement d’autodéfense, Antibalaka. Les affrontements et les massacres parfois dans les lieux de culte font revenir dans l’esprit des antibalaka, l’avertissement de Bozizé : la Seleka cherche à persécuter les chrétiens et à instaurer un régime islamique. Dès lors, la religion est devenu l’étendard des conflits politiques et économiques entre différentes franges de la population. Antibalaka ou Seleka, Christianisme ou Islam, la religion n’est qu’un instrument utilisé pour fédérer les troupes des deux camps.
Auparavant en Centrafrique, musulmans et chrétiens vivaient en parfaite harmonie depuis des décennies. La religion, souvent pointée du doigt n’est pas un élément déclencheur de la guerre. Elle n’est qu’un amplificateur des tensions naissant du tribalisme ayant conduit à l’exclusion politique et économique, l’absence de volonté de canaliser les richesses vers toutes les couches de la population, l’absence de l’autorité de l’Etat et surtout l’absence d’un Etat de droit capable de régler les conflits entre éleveurs musulmans et les chrétiens cultivateurs. Les puissances occidentales et régionales ont simplement soufflé sur ces braises pour nourrir le feu et profiter ainsi de l’immense richesse du pays.
OREDJE Narcisse, blogueur tchadien.
Article publié en collaboration avec Libre Afrique.
Après avoir reçu le 24 octobre dernier des mains du président de la Cour des comptes le rapport sur les failles de gestion du projet Hoceima Manarat Al Moutawassi (plan de développement provincial doté d’un budget de 600 millions d’euros), un des déclencheurs des manifestations au nord du Maroc, le souverain a décidé de relever de leurs fonctions quatre ministres et 14 autres hauts responsables, tandis que cinq anciens ministres de l’ancien gouvernement ne verront plus aucune responsabilité officielle leur être confiée à l’avenir.
Ces derniers limogeages sont-ils la réponse idoine à la crise d’irresponsabilité au Maroc? Pas vraiment !
Les limogeages à la carte
D’abord, en raison du caractère sélectif de ces limogeages. En effet, plusieurs responsables liés de façon directe au « Hirak du Rif », ont été épargnés. C’est le cas du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime qui n’a pas réussi à lutter contre la rente et la corruption qui gangrènent ce secteur à Al Houceima et dont la stratégie de mise à niveau « Halieutis » est loin d’intégrer tous les acteurs opérant dans ce secteur qui se trouvent poussés vers le marché noir et l’informel. La mort de Mouhcine Fikri, broyé dans une benne à ordures après avoir tenté d’arrêter une opération de destruction de sa marchandise saisie, en est l’exemple typique, ce qui a d’ailleurs déclenché les manifestions d’Al Houceima en octobre 2016. A lui s’ajoute d’autres personnes, comme Ilyas Omari, président de la région de Tanger-Tétouan-Al Houceima. Le SG général du PAM (parti proche du pouvoir), malgré qu’il n’ait pas assuré le suivi nécessaire des projets programmés dans la région, n’a pas été inquiété. En plus de Mohamed El Yaakoubi, gouverneur de la région de Tanger-Tétouan, qui a refusé d’alléger le dispositif sécuritaire à Al Houceima, ou encore Mohamed Bousaid (ministre de l’Économie et des Finances). D’après le rapport, son département et celui de l’intérieur n’ont pas procédé, en concertation avec les deux conseils bénéficiaires (régional et provincial), à l’établissement de programmes d’emploi des 600 MDH reçus. Par ailleurs, Ces fonds, reçus un an plus tôt du ministère des Finances, sont restés gelés en raison de l’absence d’un programme d’emploi. D’autres départements ont été épargnés, comme l’équipement, et les eaux et forêts, qui ont pu accélérer la cadence de la réalisation de leurs projets malgré un démarrage timide, selon le rapport.
Une aubaine politique
Ensuite, parler d’une « reddition des comptes » doit aller au-delà des limogeages symboliques, utilisés comme prétexte pour calmer l’opinion publique ou encore pour remodeler l’échiquier politique via l’altération du rapport de forces entre les différents partis, notamment ceux constituant le gouvernement actuel. Ainsi, la « colère royale » ne doit pas constituer une aubaine pour quelques formations politiques ou un outil de pression sur d’autres. Ainsi, le limogeage actuel sera une opportunité pour intégrer le parti de l’Istiqlal, connaissant très bien les arcanes du pouvoir. De plus, ce geste royal va directement affaiblir à la fois le gouvernement et le parlement, élu démocratiquement par le peuple, censés porter la voix du peuple et contrôler l’action des ministres. Dans la constitution de 2011, le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou plusieurs membres du gouvernement, ce qui n’a pas été fait, d’où le malaise institutionnel.
Un recyclage des acteurs sur fond d’irresponsabilité
Malheureusement, la reddition des comptes au Maroc reste assez souvent personnalisée et non pas institutionnalisée. D’une part, le changement de personnes n’a jamais abouti quand l’on ne change pas le système. L’exemple le plus typique est celui de changement de ministres à la tête du ministère de l’éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, un secteur qui engloutit chaque année plus de 7% du PIB sans grands résultats malgré le changement des têtes, et ce depuis des décennies. D’autre part, l’irresponsabilité est encouragée par l’impunité et le recyclage d’anciens responsables impliqués dans des scandales. C’est d’ailleurs le cas de l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohammed Ouzzine, démis de ses fonctions par le roi Mohamed VI, le 07 janvier 2015, qui a refait surface, deux ans plus tard, pour présider la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants. Une place très convoitée qui revient au troisième homme dans la hiérarchie de l’État (après le roi et le chef du gouvernement). Malgré les nombreux dysfonctionnements déjà mentionnés dans les rapports antérieurs de la cour des comptes (Ex. les défaillances relevant de la gestion des collectivités territoriales, des services déléguées et de l’emploi des fonds publics dans le rapport de 2016), les responsables sont souvent peu inquiétés.
Au delà du limogeage, une nécessité de sanctions
Enfin, la reddition des comptes signifie que les sanctions doivent être prises d’une manière systématique, et toucher tous les responsables, quelque soit leurs niveaux de responsabilités. Pour ce faire, des règles objectives d’évaluation de la négligence et de l’irresponsabilité devraient être instituées de manière claire et précise. La transparence est essentielle dans ce processus, car elle garantit l’équité et la légitimité. En ce sens, il est aussi important de respecter le droit de défense de ceux accusés de négligence, notamment l’organisation d’auditions après enquêtes, afin que l’équité soit respectée. De même, la proportionnalité de la sanction au mal causé devrait être respectée et pourquoi pas ajouter l’exigence de réparation, et ne pas se contenter seulement de limogeage. Enfin, il faudrait arrêter le recyclage des responsables impliqués dans des scandales pour ne pas normaliser l’irresponsabilité.
Des réformes s’imposent
Depuis son accession au trône en 1999, le roi Mohamed VI aurait frappé l’un de ces grands coups. Toutefois, il faut réellement espérer que le dernier « séisme politique » ne se contentera pas uniquement de faire une dizaine de boucs émissaires dans l’exécutif. Parler d’une nouvelle ère de « reddition de compte » nécessite une réforme en profondeur des règles du jeu en matière de gouvernance des instances publiques. Cela permettra d’instaurer une véritable culture d’évaluation et de résultat synonyme de mérite et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques.
Hamza El Guili, chercheur-doctorant à l’ENCG Tanger, Maroc
Article publié en collaboration avec Libre Afrique.
Cette question est au moins aussi vieille que l’iPhone
1. Il est en tout cas évident que la technologie et l’innovation sont en train de transformer le continent.
Tout le monde a entendu parler de M-Pesa, ce service de paiement par téléphone portable qui, comme l’iPhone, vient de fêter sa dixième année d’existence et qui a, de facto, propulsé le Kenya au rang de leader mondial de la banque mobile. En Afrique subsaharienne, le téléphone portable fait désormais office de banque pour des millions de personnes qui n’avaient aucun espoir de pouvoir un jour ouvrir un compte bancaire traditionnel.
En appuyant sur un simple bouton, les petits exploitants peuvent déterminer le prix de vente de leur production. Mais le téléphone portable sert aussi à acheter de l’énergie solaire, à passer un électrocardiogramme grâce à une tablette médicale au fin fond du Cameroun ou à livrer du sang par drone au Rwanda.
Des lacunes inacceptables
Toutefois, ces réussites masquent une réalité moins radieuse. Plusieurs conditions sont nécessaires pour faire de l’Afrique une terre d’innovation : investir massivement dans les infrastructures, instaurer une réglementation favorable à de nouveaux modèles économiques et, bien entendu, mettre l’accent sur la recherche et le développement, ainsi que sur la science et la technologie.
Lors d’un voyage dans la province du Guangdong, en Chine, il y a quelques années, j’ai visité l’une des plus grandes usines d’assemblage de téléphones portables au monde. J’ai été surpris de constater que presque tous les jeunes ouvriers que j’ai rencontrés n’avaient qu’un diplôme de fin d’études secondaires mais s’y connaissaient probablement mieux en informatique que la plupart des Africains diplômés d’université.
De fait, l’innovation requiert une main-d’œuvre suffisamment formée et un système éducatif solide. Selon le Rapport sur le développement dans le monde consacré à l’éducation, en Afrique la majorité des enfants qui rentrent en sixième ont d’énormes lacunes en lecture et en maths. Ceci est inacceptable.
Le Kenya est parvenu à raccorder des écoles rurales très isolées au réseau électrique et à leur fournir un accès à Internet. En 2016, 95 % des écoles du pays avaient l’électricité, contre seulement 43 % en 2013. Plus de 90 000 enseignants ont reçu une formation à l’éducation numérique et l’apprentissage en ligne a été introduit dans plus de 18 000 écoles primaires. Ces investissements porteront leurs fruits.
N’oublions pas non plus qu’en Afrique, la moitié des adultes ne sont jamais allés à l’école ou ont uniquement fréquenté l’enseignement primaire. Si l’on veut que personne ne reste sur le bord du chemin, il faut doter ces adultes de compétences informatiques de base. La technologie évolue à un rythme tel que les pays ne peuvent se contenter de rattraper leur retard (la moitié des pays affichant les vitesses de connexion à Internet les plus faibles se trouvent en Afrique subsaharienne).
Faire preuve d’audace
D’Accra à Dar es-Salaam, rien ne semble pouvoir arrêter les jeunes qui ont accès à Internet… dès lors qu’ils disposent des financements pour déployer tout leur potentiel. Rappelons que les start-up africaines ont levé 129 millions de dollars (environ 122 millions d’euros) de financements en 2016. Il s’agit certes d’un montant honorable, mais ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux sommes dont ils auraient besoin.
Sur l’ensemble du continent, je rencontre des jeunes entrepreneurs talentueux, qui sont en train de changer leur pays, start-up après start-up. Dès qu’ils voient un problème, ils essaient d’y remédier. En trouvant des solutions locales, ils pourraient devenir l’une des principales sources de création d’emplois dans leur pays. Qu’il s’agisse de petites start-up ou de grands projets d’infrastructures visant à électrifier le continent, par exemple, le principal obstacle reste souvent le manque de financements.
Les énergies renouvelables confèrent à l’Afrique une occasion unique de se développer. Saura-t-elle la saisir ? Elle devra investir massivement dans ce secteur, moderniser les entreprises publiques, la réglementation et les moyens de financement. Des mécanismes de financement non conventionnels peuvent s’avérer utiles, par exemple dans le domaine des infrastructures. La Banque mondiale a un rôle à jouer dans ce processus : nous atténuons le risque pays à l’aide de différents outils, tels que les garanties, ce qui permet d’attirer des investissements internationaux de qualité et des financements locaux.
Toutes les tentatives n’aboutiront pas. Les pays africains, le secteur privé et les partenaires de développement doivent être prêts à prendre des risques et à apprendre de leurs échecs. Mais une chose est sûre : nous devons faire preuve d’audace et considérer les obstacles comme des opportunités. Ce n’est qu’ainsi, et en créant un environnement propice à la diffusion des technologies, que l’Afrique pourra mettre à profit l’innovation et s’approprier le XXIe siècle.
La clôture de l’Africa Code Week était organisée dans un hôtel sur les hauteurs de Bujumbura.
Les codeurs mais aussi des personnes de la société civile ainsi que les autorités locales étaient présentes.
L’Africa Code Week en images
Lors de la dernière conférence de presse qui a suivi le sommet du G20 en Allemagne, un journaliste ivoirien avait demandé au président français, Emmanuel Macron, pourquoi il n’y avait pas de plan Marshall pour l’Afrique.
« Nous avons déjà essayé cela et cela n’a pas fonctionné, avait reconnu M. Macron ». Et il avait raison.
En effet, au cours des deux dernières années, les gouvernements européens ont créé, entre autres initiatives, le Fonds d’affectation spéciale d’urgence de l’UE pour l’Afrique, le Plan européen d’investissement extérieur (EEIP), et en juillet dernier le Fonds européen pour le développement durable (EFSD), la meilleure initiative de l’UE. Ce ne sont que quelques exemples, mais historiquement, il y a eu de nombreux plans de développement de l’Europe vers l’Afrique qui se sont avérés inutiles.
Rappelons qu’en 1884-1885, 11 puissances européennes et quelques autres nations se sont réunies à Berlin pour décider de l’avenir de l’Afrique. Bien que ça était très condescendant, l’une des motivations à l’origine de la Conférence de Berlin était d’aider l’Afrique. Plus précisément, l’objectif annoncé était de créer les conditions «les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation» en Afrique afin d’accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes. Or, ce qui s’est produit n’a été qu’une «ruée sur l’Afrique». Cette conférence a fait le lit du colonialisme, entraînant une exploitation inédite, permettant aux signataires de siphonner les ressources africaines pour alimenter leur propre développement. Le plan de développement pour l’Afrique a donc conduit au sous-développement et à l’appauvrissement du continent.

Plus de protectionnisme n’est pas la réponse
Apparemment, la leçon n’a pas été retenue car, au début de cette année, environ 120 ans après la Conférence de Berlin, une autre recommandation pour le développement de l’Afrique est sortie de Berlin, le soi-disant «plan Marshall pour l’Afrique».
Le premier pilier de ce plan encourage les pays africains à «introduire des barrières tarifaires pour assurer une protection partielle et temporaire des marchés intérieurs contre la concurrence mondiale». Cela contredit les souhaits des entrepreneurs africains qui ont demandé à plusieurs reprises aux gouvernements africains de se débarrasser du protectionnisme. Il est choquant que les élites en charge du développement à l’UE demandent plus de protectionnisme à un continent qui a déjà des tarifs douaniers importants qui entravent le commerce intra-régional, des restrictions de visa strictes empêchant la libre circulation des personnes, et où l’intégration économique régionale est à l’agonie.
Contrairement à la conférence de Berlin de 1885, cette nouvelle initiative n’est pas un accord formel, mais, une nouvelle fois, elle met en évidence l’infantilisation de l’Afrique. Comme le souligne Henning Melber, le chercheur associé principal du Nordic Africa Institute, c’est «Un autre plan grandiose pour l’Afrique sans aucune collaboration avec les Africains».
L’un des plus grands obstacles à la sortie de millions d’Africains de la pauvreté est le fait que la politique de développement de l’Afrique a été élaborée depuis des siècles par des non-Africains. Tant que les pays africains ne seront pas investis dans leur propre développement, et les gouvernements africains seront des obstacles au progrès sur le continent, la pauvreté persistera. Il incombe à la fois à l’Afrique et à l’Europe de donner aux Africains la possibilité de formuler leurs propres politiques.
Qui devrait formuler le programme de développement de l’Afrique?
Prenons l’exemple d’autres pays qui étaient aussi pauvres, sinon plus pauvres, que de nombreux pays africains il y a 60 ans, comme la Corée du Sud et Singapour. En 1957, le Ghana et la Corée du Sud avaient le même PIB par habitant. En 1990, le PIB de la Corée du Sud était 10 fois plus élevé que celui du Ghana. L’une des principales raisons de cette différence de trajectoire est que, en Corée du Sud, les organismes d’aide étrangères n’ont pas dominé l’élaboration des politiques nationales, contrairement au Ghana. En outre, les processus politiques internes, créés et conduits par des personnes sud-coréennes, ont contribué à renforcer les institutions du pays et ont permis une plus grande productivité nationale.
En 1965, Singapour était un pays du tiers monde, avec un PIB par habitant de 500 $, le même qu’en Afrique du Sud à l’époque. En 2015, le PIB par habitant du pays a égalé celui de l’Allemagne et les États-Unis, soit environ 56 000 dollars. Pour y arriver, Singapour, comme tous les pays riches du monde, a formulé son propre programme de développement. L’autodétermination de Singapour a contribué à l’élaboration de politique pro-marché, responsables de la majeure partie de ses progrès.
Les élites et les opposants au développement pourraient invoquer l’histoire dite « compliquée » de l’Afrique et prétendre que les cultures sud-coréennes et singapouriennes sont différentes ou plus propices au développement que les cultures africaines. Pour eux, je rappelle qu’il y a deux siècles, les Britanniques considéraient le peuple allemand comme malhonnête et «lent». Au début du XXe siècle, les pays occidentaux riches considéraient les Japonais comme paresseux. Le Japon, comme beaucoup de pays africains d’aujourd’hui, a été contraint de signer des traités commerciaux inégaux avec l’Occident. Les deux cultures ont été considérées comme arriérées et non favorables au développement. Aujourd’hui, le Japon et l’Allemagne ne peuvent guère être considérés comme des « loosers », et les perceptions négatives de leurs cultures ne sont que de l’histoire ancienne.
La culture africaine n’est pas inférieure et l’histoire africaine n’est pas si unique et compliquée pour que les pays africains ne puissent pas formuler de manière indépendante des politiques de développement saines. Le vrai problème est que, tout simplement, au cours des derniers siècles, les politiques africaines ont été décidées par des non-Africains. Comme le disait Daniel J. Mitchell de l’Institut Cato : « Si l’Afrique veut de bons résultats économiques, elle doit implémenter de bonnes politiques. Et depuis quelques siècles, les politiques conçues par l’Europe ne sont pas les bonnes pour l’Afrique ».
Stacy Ndlovu est la rédactrice en chef de Young Voices, un projet pour les jeunes écrivains. Originaire du Zimbabwe, Stacy est diplômée de l’Université Cornell en 2016 (version élaguée).
Article publié en collaboration avec Libre Afrique.

En juin dernier, le Prix mondial de l’alimentation 2017 était décerné à Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD). Ce prix vient reconnaître sa contribution exceptionnelle et son travail sans relâche en faveur d’une meilleure disponibilité des semences et des engrais pour les agriculteurs africains, d’un plus large accès de ces derniers aux financements, ainsi que pour avoir posé les jalons d’un plus grand engagement des jeunes Africains dans le secteur agricole, en tant qu’activité lucrative.
Équivalent d’un « prix Nobel » de l’agriculture, le Prix mondial de l’alimentation, qui fut créé par Norman Borlaug, lui-même fut lauréat d’un Nobel, passe pour la plus importante distinction mondiale couronnant les accomplissements d’individus qui ont fait progresser le développement humain en améliorant la qualité, la quantité et la disponibilité de la nourriture dans le monde. Le prix est décerné chaque année à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, célébrée le 16 octobre, au cours d’une cérémonie à Des Moines, capitale de l’État de l’Iowa aux États-Unis.
Le Prix mondial de l’alimentation, qui se décline désormais en une série d’évènements sur toute une semaine, attire plus de 1 200 participants en provenance de 65 pays, venus débattre des enjeux liés à la sécurité alimentaire mondiale et à la nutrition.
Outre la cérémonie de remise du prix au lauréat, la série de rencontres qui ponctuent le Prix mondial de l’alimentation comprend le Symposium international du dialogue de Borlaug, le Sommet de l’Iowa contre la faim, des conférences du lauréat (Laureate Lecture Series) et la remise du prix Norman Borlaug pour la recherche et l’application sur le terrain, décernée par la Fondation Rockefeller.
À la tête d’une délégation de Banque africaine de développement, le président Akinwumi Adesina se rend en Iowa pour le Symposium international Norman E. Borlaug, également connu sous le nom de « Dialogue de Borlaug », qui se déroule du 18 au 20 octobre 2017 à Des Moines. C’est lui qui prononcera le discours phare de la conférence Norman Borlaug le 16 octobre, date de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, un discours sur le thème « Parier sur l’Afrique pour nourrir le monde », à l’Iowa State University. Le Prix mondial de l’alimentation 2017 lui sera décerné au cours de la soirée du 19 octobre, et le président fera son allocution de lauréat lors d’un déjeuner le lendemain.
Sous l’égide du président Adesina, la BAD accélère le développement de l’agriculture sur le continent, avec sa stratégie « Nourrir l’Afrique », et compte investir 24 milliards de dollars EU au cours des 10 prochaines années. Le prix couronne également le travail qu’Akinwumi Adesina a accompli durant les deux dernières décennies, avec la Fondation Rockefeller et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), mais aussi en tant que ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria.
Le 18 octobre, le président de la Banque prendra la parole lors d’une session sur le thème « Rendre l’agriculture “cool” : investir dans les futurs agriculteurs et agripreneurs africains ». Cette session mettra en lumière la convergence entre agriculture et emploi des jeunes, et mettra l’emphase sur le rôle des politiques, de la gouvernance et des technologies dans l’accélération d’une croissance économique durable.
De jeunes entrepreneurs agricoles africains – “agripreneurs” –, qui bénéficient du soutien de la BAD à travers le programme ENABLE Youth (Empowering Novel Agri-Business-Led Employment for Youth), un programme qui encourage la création d’emplois pour les jeunes dans l’agribusiness, participeront à un débat sur l’amélioration des perspectives économiques pour la jeunesse d’Afrique via l’agriculture.
Le président Adesina interviendra également lors d’une session sur l’Initiative pour la transformation de la savane en Afrique (dite TASI par acronyme pour Transformation of the African Savanah Initiative), un programme de la BAD qui vise à mettre en culture 1,6 million d’hectares de terres supplémentaires, dans le but de doubler la production de maïs, de soja ainsi que l’élevage de bétail dans huit pays africains – Ghana, Guinée, Ouganda, Kenya, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Mozambique et Zambie.
Le président sera également au côté d’acteurs clés en matière de nutrition, de représentants du secteur privé, de décideurs et autres leaders d’opinion, lors d’une session plénière du Panel mondial sur l’agriculture et les systèmes alimentaires pour la nutrition, afin de promouvoir la responsabilité mutuelle en matière de leadership, de gouvernance et d’investissements en faveur de la nutrition.

Beaucoup de pays asiatiques utilisent déjà des indices météorologiques (humidité, pluviométrie, température, etc.) et la collecte des données satellitaires pour anticiper et gérer les pertes agricoles (assurance indicielle).
En juillet 2017 après une sécheresse dans l’État du Tamil Nadu (Inde du Sud), 203 000 riziculteurs/trices ont perçu des indemnités allouées dans le cadre de l’assurance-récolte sans plus dépendre des aumônes et autres aides humanitaires d’urgence. Or, Atlas Magazine qui publie l’actualité sur l’assurance dans le monde rapporte qu’en 2015, seuls 0,25% d’Africains comptaient parmi les 178 millions d’agriculteurs assurés dans les pays du Sud : 800 000 en Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie et Rwanda), 52 228 en Afrique de l’Ouest et l’essentiel en Afrique du Sud. Pourtant selon ACRE Africa, la micro-assurance apporte un gain supplémentaire de 16% aux paysans. La question est de savoir pourquoi le Cameroun où près de 65% des citoyens vivent de l’agriculture reste en marge ?
Jusqu’ici, pour calculer l’assurance agricole, la probabilité de sinistre était évaluée sur la base du rendement de l’année précédente. Pour cette raison, le marché était moins attrayant et le montant des primes était intenable (entre 320 000 et 650 000 FCFA). L’assurance indicielle apporte l’espoir de jouer un rôle de facteur-clé de développement puisqu’elle ouvre aux paysans l’accès aux financements et peut permettre de stabiliser leurs revenus en cas de sinistre. Auprès de la Banque Mondiale, le Cameroun avait commandé une étude de faisabilité en vue de lancer un projet pilote d’assurance indicielle en 2017 avec pour ambition de faire bénéficier 70 000 agriculteurs et éleveurs d’ici 2019. Mais, plusieurs facteurs ont freiné cette initiative aux rangs desquels : la mauvaise gouvernance, des réglementations non-adaptées, des modèles commerciaux obsolètes et des investissements quasi insignifiants dans l’innovation.
En effet, à cause de la mauvaise gouvernance, les délais d’exécution sont rarement respectés. Un gap de plusieurs années (voir décennies) existe entre la date de prise d’une décision et la date de sa mise en œuvre. Par conséquent, à ce jour, le projet pilote de micro-assurance annoncé en grande pompe à Douala le 15 décembre 2016 lors d’un atelier regroupant tous les différents acteurs dont le gouvernement et l’Association des compagnies d’assurances du Cameroun (ASAC) reste toujours « en cours ». Cette pratique s’observe aussi chez les assureurs eux-mêmes où le non-respect des délais de paiement des prestations accentue la méfiance et pose le problème de leur solvabilité.
Sur le plan juridique, le Cameroun a bénéficié comme les autres pays ACP du Mécanisme mondial pour l’assurance indicielle (GIIF) pour intégrer la notion d’assurance indicielle. Les 14 ministres des Finances de la zone CFA ont ratifié en 2012 le nouveau Code (Livre 7) de la Conférence Interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) qui permet la pratique des activités de micro-assurance, y compris de l’assurance indicielle. Mais, la micro-assurance reste inféodée par les règles rigides de l’assurance traditionnelle (code CIMA) qui la rend contraignante pour le micro-assureur et le paysan déjà non couvert par la protection sociale. Aussi, le règlement CEMAC 2002/01 qui régit les établissements de micro-finance (EMF) n’intègre pas la micro-assurance, rendant l’activité officieuse dans ces établissements de microcrédits représentant pourtant 98% du portefeuille de la micro-assurance en 2011 selon un rapport de Développement International Dejardins. Pis, les tontines qui comblent le besoin local de micro-assurance sont maintenues dans l’informel, ce qui éloigne les offres d’assurance des habitudes socioculturelles des paysans. Par conséquent, la loi n’instaure que très peu de dispositifs incitatifs adaptés susceptibles de renforcer la demande d’assurance et de combler les lacunes du marché. Elle doit assouplir les conditions d’agrément des agents de micro-assurance.
Par ailleurs, le modèle de calcul des indices est obsolète. Le risque de base est difficile à évaluer dans la mesure où il y a insuffisance de l’historique des données météorologiques susceptibles de permettre de savoir ce que serait une année «normale» dans les différentes localités. Il devient donc difficile de fixer un indice de calcul des primes approprié pour chaque zone agro-écologique. Pis, les paysans sont non-sensibilisés et en manque d’éducation financière. Plus important, le modèle d’accompagnement de la formation des institutions financières et des assureurs locaux n’est pas au point. Il s’agit de l’élaboration et la distribution de contrats et produits d’assurance indicielle, de la procédure de prise en charge des demandes d’indemnisation, etc. En clair, comment réussir lorsqu’il existe encore des lacunes dans l’élaboration des produits susceptibles de satisfaire et de stimuler la demande locale ? Par exemple au Kenya, les produits de micro-assurance sont vendus sous formes de microcrédit, d’une prestation de conseil ou de l’achat de semences. Grâce à l’utilisation de la téléphonie mobile, les paysans achètent des semences codées avec la certitude qu’ils seront compensés en cas de non-germination dans 21 jours.
La solution réside dans l’innovation. Par exemple, les stations météorologiques doivent être rénovées et pourvues en ressources suffisantes en quantité et en qualité afin de rendre disponibles et régulières les données fiables. En l’état, seuls une vingtaine de stations et 30 postes climatologiques existent et l’on ne note aucune station agro-météorologique. Au lieu de compter comme maintenant sur les subventions du GIIF pour baisser les primes, il faudrait investir massivement dans les TICs afin de rendre possible la collecte des données pluviométriques ou l’utilisation des données satellites obtenues à l’aide de différents capteurs pour mettre au point de nouveaux indices ou créer des produits basés sur le rendement. Les TICs pourraient aussi renforcer des solutions comme le mobile financing dans un secteur de l’assurance en pleine croissance où le chiffre d’affaires a augmenté de 13% en 2015 et le paiement des sinistres de 5% selon l’ASAC.
En somme, le retard du Cameroun dans l’assurance agricole bute principalement sur la mauvaise gouvernance et l’insuffisance de l’investissement dans l’innovation. Il convient maintenant de joindre la parole aux actes pour surmonter ces difficultés.
Louis-Marie Kakdeu, PhD &MPA
Article publié en collaboration avec Libre Afrique
Le géant du net explique :
Que vous soyez sur votre trajet entre pour aller ou revenir du travail, que vous recherchiez les derniers résultats sportifs ou le numéro de téléphone du restaurant le plus proche, la rapidité d’accès à l’information est déterminante.
En Afrique, on constate que près de 40 % des personnes équipées d’un appareil Android ne disposent que d’une connexion lente ou différée lorsqu’ils naviguent sur le web en raison du faible niveau de RAM des appareils. Nous lançons aujourd’hui une fonctionnalité qui, nous l’espérons, vous permettra d’accéder plus rapidement, plus facilement et à un coût abordable à l’information que vous recherchez.
Désormais, dans la quasi-totalité des pays africains, lorsque vous ferez une recherche sur Google à l’aide d’un appareil à faible niveau de RAM via le navigateur Google App, Chrome ou Android, les pages web que vous consulterez à partir de la page de résultats de la recherche Google seront optimisées pour un chargement plus rapide, en utilisant moins de données.
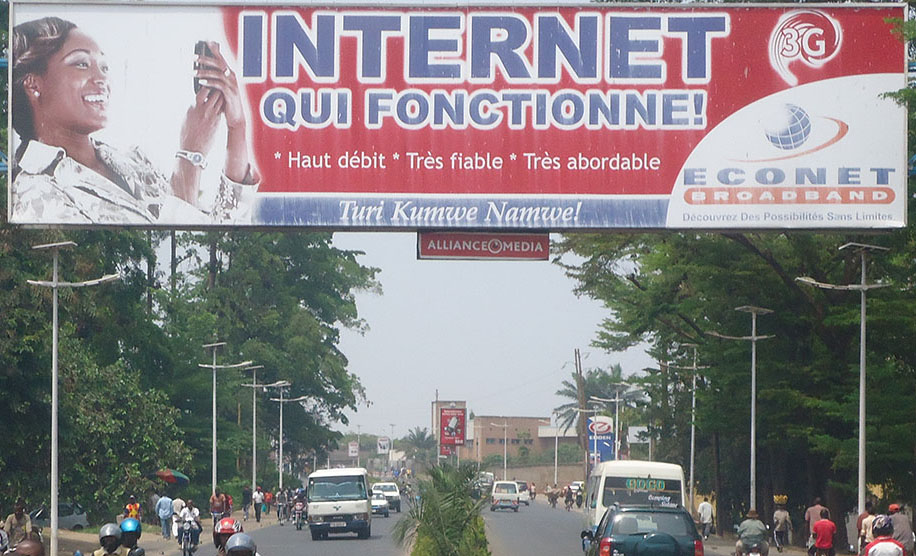
Cette fonction est dès à présent disponible au Nigeria, en Indonésie, en Inde et au Brésil. Les analyses montrent que ces pages optimisées se chargent trois fois plus vite et utilisent 80 % de données en moins. À noter que le trafic vers les pages web à partir de la recherche Google a également augmenté de 40 %. Cependant, si vous préférez voir la page d’origine, vous pouvez choisir cette option en haut de la page.
Nous espérons que cette fonction permettra d’améliorer l’expérience de recherche pour des millions d’utilisateurs dans les régions où les connexions réseau sont lentes et l’accès limité. Bonnes recherches !Publié par Hassan Abyaneh, Product Manager
Ces derniers peuvent détenir des droits coutumiers ou traditionnels sur leurs terres, mais dans de nombreux cas, ces droits ne sont pas officiellement reconnus par l’Etat.
L’entreprise utilise des smartphones compatibles GPS pour cartographier les contours des parcelles des agriculteurs. Elle vérifie les délimitations obtenues avec les agriculteurs et leurs voisins, puis ils fournissent aux agriculteurs des documents attestant de leurs propriétés foncières, à un coût relativement faible.
Grâce à cette information précise et vérifiée, les agriculteurs peuvent accéder plus facilement au crédit ou conclure des contrats pour approvisionner en produits de base les entreprises (cacao, noix de karité). LandMapp s’efforce de faire ce que les gouvernements africains ont eu de la difficulté à faire: fournir des services de cartographie et d’arpentage fiables et des preuves pour faire valoir des droits fonciers légitimes à un coût raisonnable au profit des familles et des communautés.
Droits de propriété en Afrique
Dans un précédent article, j’avais parlé de la façon dont, en donnant le droit de gérer et d’exploiter la faune sauvage à des communautés, le gouvernement de la Namibie a contribué à accroître cette faune tout en favorisant le développement économique et les nouvelles possibilités d’emploi pour les personnes vivant dans les zones rurales. En fournissant aux populations locales des droits de propriété sécurisés sur la faune, le gouvernement a créé des incitations positives pour protéger et conserver les animaux. Il a également créé des incitations pour les populations locales à penser de manière entrepreneuriale quant à la meilleure façon de bénéficier de la présence de ces animaux.

Certaines communautés participent à des joint-ventures avec des entreprises de tourisme pour construire des loges qui procurent des revenus ; d’autres peuvent organiser des « chasses au trophée » limités. L’approche de la Namibie en matière de gestion de faune a rapporté des gains environnementaux et économiques importants.
Imaginez donc comment ce type d’approche pourrait aider à améliorer les conditions économiques des Africains. Et si les populations locales disposaient de droits de propriété sécurisés pour gérer et profiter des forêts, des pâturages ou des terres agricoles? Quel genre d’activités entrepreneuriales verrions-nous?
Malheureusement pour les Africains, ces types d’expériences sont limités. Selon certaines estimations, près de 98% des forêts africaines appartiennent à l’État. Bien que les communautés locales puissent avoir des droits informels sur les forêts et les produits forestiers, ces droits faibles et inapplicables signifient que les forêts deviennent de facto des ressources « à accès libre». Elles sont gratuites et disponibles aussi bien pour les bons que les mauvais usages parce que les gouvernements ont une capacité limitée à surveiller ceux qui peuvent entrer et exploiter du bois, des plantes, de la viande de brousse, du miel et d’autres ressources forestières.
Actuellement, les populations locales ont moins d’incitations à conserver et à protéger les forêts qu’elles ne le seraient, en tant qu’individus ou en tant que communautés, si elles étaient légalement habilitées à gérer et à bénéficier de l’utilisation de ces forêts. Certains pays ont adopté des pratiques communautaires de gestion forestière et, selon des arrangements institutionnels spécifiques, cette approche a contribué à réduire les taux de déforestation et à générer des revenus. Mais à ce jour, peu de pays africains ont délivré des droits sécurisés aux populations locales pour gérer les forêts ; les stratégies de gestion « top down » restent l’approche privilégiée.
Les droits coutumiers
Le problème ne se limite pas aux forêts. En Afrique, la majorité des gouvernements possèdent légalement les autres terres. Mais, bien que les gouvernements possèdent légalement les terres (et l’eau, les forêts et toutes les richesses souterraines), de nombreux paysans possèdent des droits traditionnels et coutumiers sur ces terres. Dans la pratique, cela signifie que de nombreuses communautés ont des chefs ou d’autres leaders traditionnels qui sont responsables de l’attribution des droits d’exploitation des terres au sein des villages, ainsi qu’aux nouveaux arrivants (migrants) ou aux groupes qui utilisent la terre de manière saisonnière (les éleveurs).
Ces systèmes coutumiers ou communaux de propriété foncière ont évolué au fil du temps et sont assez flexibles, souvent en s’adaptant à la pression démographique croissante ou à la découverte de ressources précieuses. Il n’est pas surprenant qu’ils diffèrent d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre (et même d’un village à l’autre). Leur problème, c’est qu’ils existent à la marge et sont souvent en concurrence avec le système gouvernemental formel de propriété foncière. Concrètement, 60% des terres en Afrique subsaharienne sont régulées selon ces droits coutumiers. Les terres coutumières ne sont généralement pas cartographiées avec précision et les droits sur ces terres ne sont généralement pas formellement immatriculés, bien que de nombreux pays africains disposent de lois qui permettent de le faire (beaucoup de personnes ayant des droits coutumiers choisissent de ne pas enregistrer leurs terres parce que la procédure est trop chère et compliquée). En conséquence, beaucoup de personnes vivant dans les zones rurales ont des droits de propriété insécurisés sur leurs terres. Cette insécurité signifie qu’elles sont moins susceptibles d’investir dans l’amélioration de la productivité agricole, elles peuvent être expulsées de la terre par des plus puissants, et ils sont souvent en conflit avec d’autres – et parfois ce conflit est violent.
Ainsi, il est encourageant de voir comment des solutions émanant du secteur privé, y compris la technologie, peuvent aider à résoudre certains de ces problèmes. Il n’est pas encore clair dans quelle mesure LandMapp est une solution évolutive ou quelle est l’application de cette approche dans un environnement où les agriculteurs cultivent du maïs (une culture de subsistance) plutôt que du cacao (une culture de rente). Mais il est certainement prometteur de savoir que les entrepreneurs essaient de résoudre ce problème omniprésent et faire profiter de millions de paysans africains, dont les droits fonciers demeurent non enregistrés et exposés au risque, des avantages des droits de propriété sécurisés.
Karol Boudreaux, analyste pour Fee.org.
Internet rend le monde aussi petit qu’un village dit-on ; c’est par ce village que l’initiative AFRICA CODE WEEK est parvenue à 2 jeunes Burundais, Natacha et Daly.
Une initiative par laquelle des centaines de milliers d’enfants apprenaient l’informatique dans 30 pays d’Afrique mais pas au Burundi. Après quelques contacts fructueux au Rwanda, au Kenya et en Afrique du Sud, pour apprendre d’eux, il a vite été possible d’ajouter le Burundi parmi les pays qui participeraient à l’édition 2017 de l’AFRICA CODE WEEK.
Natacha et Daly venaient justement de créer BiHub (Burundi Innovation Hub), dont le but était de regrouper des talents de la jeunesse Burundaise dans un cadre propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans le but de développer des ressources humaines Burundaises et des entreprises rentables en mesure d’avoir un impact significatif dans le développement du pays.
Pour la promotion des nouvelles technologies, AFRICA CODE WEEK allait être le parfait premier projet de Bihub avec des objectifs ambitieux dès le départ :
Bihub dispose de très peu de moyens pour réaliser ses objectifs, Natacha et Daly partent à la chasse de partenaires ; le Secrétariat Exécutif des TICs, rattaché au ministère des Technologies répond très vite et offre un bureau ; l’Institut Français du Burundi fournit la salle qui abritera la formation des formateurs et accepte d’accueillir des sessions de formations des enfants pour tout le mois d’octobre.
Les enfants sont surpris de constater que logiciel peut être configuré dans plusieurs langues dont le swahili et le kinyarwanda expliquent les organisateurs
2 Entreprises répondent également présent : SMART une entreprise Telecom signe un chèque, offre des clés USB pour la formation et promet de mobiliser des ingénieurs pour les formations. MEDIABOX, une société spécialisée dans les Systèmes d’Information d’Aide à la Décision promet met également l’expertise de ses ingénieurs à contribution ainsi qu’une salle de formation.

Un appel aux volontaires est fait sur les médias sociaux pour trouver une centaine de formateurs.. au total 174 volontaires auront répondu ; le nombre de séance a été doublé pour former tout le monde. Les contacts sont également établis avec des établissements scolaires, 24 écoles s’engagent à Bujumbura et à Gitega. Faute d’avoir trouvé un partenaire sur place, la ville de Ngozi est abandonnée.
A Bujumbura et à Gitega, les futurs formateurs découvrent SCRATCH, le logiciel avec lequel ils feront la programmation avec les enfants, ils sont surpris de constater que logiciel peut être configuré dans plusieurs langues dont le swahili et le kinyarwanda… mais pas encore le kirundi. Il n’en fallait pas plus pour stimuler leur ardeur, leur orgueil légèrement pincé ; ils sont décidés à produire la traduction en kirundi au plus vite. Toutes les séances de formation se passent dans la bonne humeur, SCRATCH permet de facilement créer des animations, des jeux… ils s’en donnent à cœur joie.
« Ils en veulent toujours plus », « ils refusent de rentrer » nous rapportent les formateurs au sujet des enfants qui découvrent le code.
Les activités de l’AFRICA CODE WEEK sont prévues du 18 au 25 octobre. Pour se préparer au mieux, des formations pilotes sont prévu à Bujumbura à l’Institut Français dès le 5 octobre et à Gitega par quelques volontaires sur leurs propres ordinateurs. A Gitega comme à Bujumbura, la première séance avec les enfants est plutôt timide mais très vite les enfants s’approprient l’outil et laissent leur imagination s’exprimer. « Ils en veulent toujours plus », « ils refusent de rentrer » nous rapportent les formateurs.. « ils », ce sont les enfants qu’ils forment. Sur les photos que nous recevons, des enfants sont parfois agglutinés sur un même ordinateur, leurs yeux brillants de curiosité.. pour nous, une victoire est déjà remportée, ces enfants aiment ce qu’ils font !
A la veille du lancement officiel de l’AFRICA CODE WEEK, 327 jeunes filles et garçons ont déjà été formés, à Gitega et à Bujumbura, en ville et sur les collines, dans des salles informatiques et sur de simples tabourets.
Désormais, nous allons déployer l’ensemble de nos volontaires auprès des écoles partenaires. Pendant une heure, ils devront expliquer le fonctionnement du logiciel aux enfants, le laisser expérimenter, le guider et le laisser exprimer son imagination. Nous nous permettons d’espérer que bientôt la programmation informatique fasse partie intégrante de la formation des enfants, même des plus jeunes.
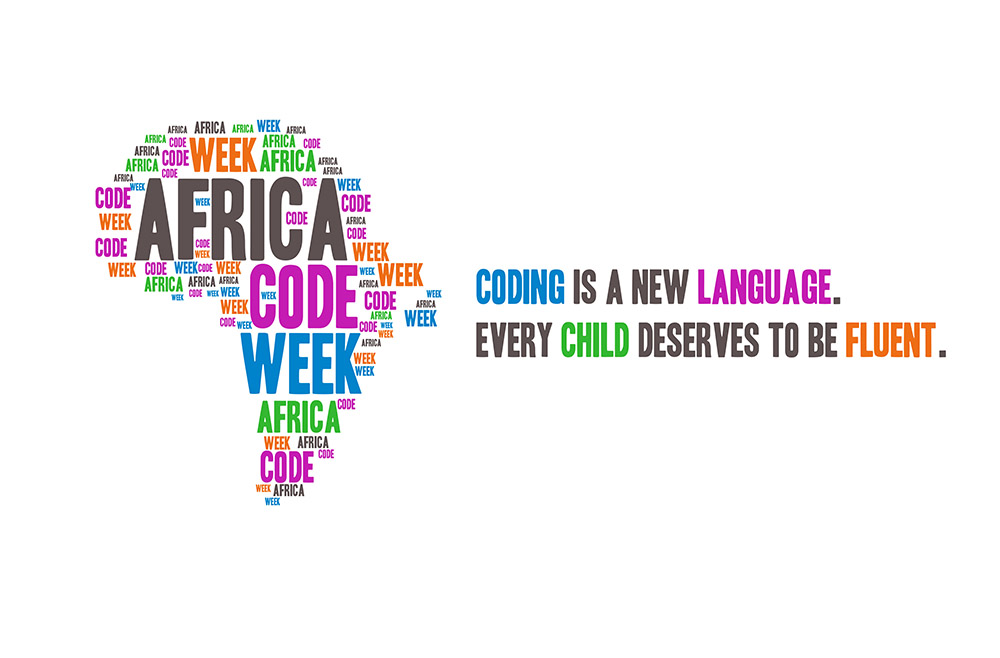
Les jeunes générations d’aujourd’hui sont à juste titre considérées comme les natifs de la technologie: ils sont nés dans un monde qui fonctionnait déjà avec internet, les ordinateurs, la téléphonie mobile et maintenant la téléphonie intelligente. Le monde de demain sera encore d’avantage celui de la technologie et la programmation une langue à part entière, une compétence incontournable comme l’est aujourd’hui savoir utiliser un ordinateur.
C’est ainsi qu’est né l’initiative AFRICA CODE WEEK sous l’impulsion d’acteurs internationaux des sciences et de la technologie comme la société SAP, l’UNESCO, le « Cape Town Science Center« , le « Galway Education Centre« .
Le Burundi a été inscrit dans la liste des pays participant à l’initiative Africa Code Week le 27 août 2017 grâce à l’initiative « Burundi Hub » désireuse de promouvoir l’innovation et la technologie au Burundi.
Burundi Hub vise à initier des jeunes Burundais à la programmation et ainsi contribuer à les mieux outiller pour leur rôle comme les futurs acteurs clés du développement du Burundi.
Burundi Hub se fixe les objectifs suivants :
La vision de Burundi Hub ne s’arrête pas à la réussite de l’évènement. L’Africa Code Week est un excellent point de départ mais nous croyons qu’un impact durable dans le contexte particulier de notre pays ne pourra se faire que sur une certaine durée, avec une organisation et des partenariats solides.
Il est vital, pour des résultats pérennes, d’inscrire l’impact de l’Africa Code Week dans une logique d’éducation et de formation continue. De même l’accès aux ressources nécessaires ne pourrait être envisagé sans l’implication des acteurs des technologies de l’information au Burundi.
Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle réalisée en toute indépendance par l’Institut Choiseul. Il identifie, recense et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins, appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche.
Fruit d’un travail mené sur plusieurs mois, l’Institut Choiseul a fait appel à de nombreux experts et spécialistes du continent pour réaliser cette étude ambitieuse et unique en son genre qui dresse un état des lieux des forces vives de l’économie africaine.
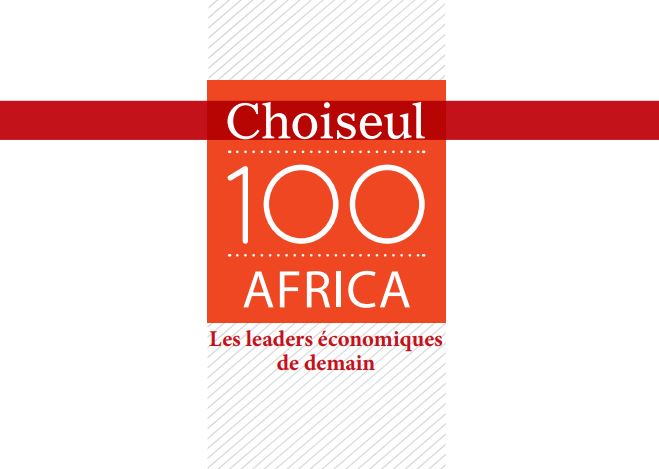
Cliquez sur la couverture pour télécharger Choiseul 100 Africa 2017 ou sur ce lien
Personne, mêmes les tchadiens ne s’attendaient à cette décision, puisque le pays est considéré comme étant le principal allié de la communauté internationale dans ce combat contre les forces du mal. Au delà des raisons invoquées officiellement, la décision de Trump ne cache t-elle pas d’autres motivations ?
Le Tchad regorge de terroristes sur son sol et ne partage pas de manière efficace des informations avec les agences américaines de renseignements. Ce sont en résumé les reproches faits au Tchad par l’Administration Trump. Plusieurs éléments concourent à corroborer ces reproches. Le Nord du Tchad regorge de trafiquants de drogues et d’armes qui sont susceptibles d’être qualifiées de terroristes selon la nature des activités qu’ils mènent. Boko Haram, l’EI et les milices djihadistes du Sud libyen utilisent ce couloir pour se ravitailler en armes et en hommes. Le recrutement de nouveaux candidats terroristes se fait jusqu’en profondeur dans la région du Lac aussi bien du côté tchadien, nigérien que nigérian.
De même, le système d’état civil tchadien est défaillant du fait de la corruption et du manque de sérieux des autorités en charge de ses services. Tout le monde peut se procurer une pièce d’identité puisqu’il n’y a pas vraiment de moyens pour filtrer les demandeurs d’identité. D’autres malfaiteurs venant d’autres pays peuvent donc se faire délivrer ces documents précieux. C’est le cas en 2015 de Mahamat Moustapha, alias Bana fanaye, le nigérian qui coordonnait les activités de Boko Haram depuis le Tchad.
Quant aux services de renseignements tchadiens ils ne sont pas formés pour partager des informations avec d’autres agences. Moins professionnels et non informatisés, leur travail au quotidien consiste à collecter des informations politiques afin de réprimer les voix discordantes et consolider ainsi le régime du président Deby. Une technique que le régime utilise depuis 27 ans pour semer la terreur au sein de la population.

Mais s’il faut s’arrêter à ces raisons officielles, pourquoi fallait-il punir seulement le Tchad ? Les incohérences de cette décision avec les réalités sur le terrain sont notoires. Le pays partage ses frontières avec d’autres pays en crise et en proie au terrorisme. Le Nigeria, pays d’origine même de la secte Boko haram, le Cameroun et le Niger sont les théâtres récurrents d’actes terroristes depuis quelques années. Ces pays présentent presque les mêmes défaillances sécuritaires. Pourtant, ils n’étaient pas inquiétés ! Par ailleurs, si Trump voulait réussir dans son combat contre le terrorisme, il aurait plutôt intérêt à soutenir Deby, même si celui-ci n’est pas un ange, et non le sanctionner. Car une telle décision pourrait pousser Deby à « lever le pied » dans ce combat et à partir de là, il y a le risque que ça empire. Pour rappel, l’armée américaine est toujours en place et c’est d’ailleurs elle qui encadre le Groupement anti-terroriste de l’armée tchadienne dans ce domaine. Il s’en suit que la responsabilité est aussi partagée.
Au regard du caractère non convaincant de la version officielle, l’on est en droit de chercher d’autres motifs qui auraient pu motiver la décision de l’Administration Trump.
Le Président Deby se considère comme le seul allié capable de stopper la progression des sectes terroristes dans le sahel. Fort de cette posture, il reproche aux dirigeants de grandes puissances notamment les USA de ne pas mettre assez de moyens à sa disposition. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il aurait boycotté la dernière rencontre du G5 Sahel et en même temps l’Assemblée Générale de l’ONU. Ce qui aurait été perçu comme un chantage par le Président Trump qui, en signant ce décret, voudrait rappeler à Deby que c’était lui le « maître du jeu ».
L’autre raison possible et non des moindres, c’est l’attitude du Président Deby envers EXXON MOBIL ; la multinationale américaine qui, depuis plusieurs années déjà, exploite à travers ses filiales (ESSO, PETRONAS et CHEVRON) le pétrole tchadien. Depuis 2009, l’Etat tchadien accuse EXXON MOBIL de ne verser que 0,2% de la redevance qu’elle doit au Tchad alors que le taux fixé par la loi était de 2%. Dans ce litige, la justice tchadienne a condamné en 2016, le pétrolier à verser 44 700 milliards de FCFA au Tchad. Le règlement à l’amiable de cette affaire a permis de prolonger le contrat de EXXON MOBIL jusqu’en 2050, mais la firme a perdu sa notoriété, de l’argent et sa position privilégiée auprès des autorités tchadiennes. Par suite, les américains en ont voulu au régime de Deby pour cette affaire. Dès lors, il est plausible de penser à un désir de revanche de la part d’ EXXON MOBIL via son ex-PDG de, Rex Tillerson, qui n’est autre que le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères dans l’Administration Trump. De même, le nouveau feuilleton de l’AIRBUS A340 de la compagnie AIR INTER1 serait l’autre raison de la colère de Trump. Cet avion immatriculé au Tchad dans des circonstances inconnues jusqu’à ce jour, serait impliqué dans le trafic d’armes et des produits prohibés au Kazakhstan, l’Iran et l’Iraq.
Certes, les défaillances sécuritaires au Tchad existent mais les présenter de cette manière s’apparente plutôt à de l’instrumentalisation politique, de la part de Trump qu’une véritable invitation à pallier à ces lacunes. De même, Déby est en train d’instrumentaliser ce décret afin de se refaire une popularité en fédérant le peuple tchadien contre l’ennemi américain. Les tchadiens ne devraient tomber pas dans ce double piège. S’ils voulaient retrouver de la souveraineté, il faudrait faire pression sur Déby pour que les griefs cessent d’être instrumentalisés par les leaders occidentaux afin d’avancer leurs pions sur l’échiquier géostratégique mondial.
OREDJE Narcisse, blogueur tchadien
Article publié en collaboration avec Libre Afrique.
L’Afrique représente 50 % des engagements de l’AFD à l’international. Nous avons financé 4 milliards d’euros de projets en Afrique en 2016. C’est la priorité de la politique de développement de la France : 85% des moyens budgétaires qui nous sont accordés par l’Etat y sont concentrés.
Au Sénégal, nos engagements ont dépassé 140 milliards de francs CFA en 2016. En cumulé, depuis 2007, ce sont près de 900 milliards de francs CFA (1,4 milliard d’euros) que nous avons engagés dans votre pays. Dans de nombreux secteurs : les infrastructures bien sûr (eau et assainissement, transport avec le TER, développement urbain), l’énergie, l’agriculture, mais aussi les secteurs sociaux, en particulier l’éducation, priorité du Président de la République française. J’ai rencontré lundi 25 septembre Serigne Mbaye Thiam le Ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, pour préparer l’importante réunion internationale du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) qui se tiendra à Dakar en février prochain, sous la co-présidence des Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.
L’Afrique est la priorité de l’AFD. Fondée par le général De Gaulle à Londres en 1941, notre Agence sait ce qu’elle doit aux Résistants et aux combattants d’Afrique. Elle a dans son ADN la lutte contre toutes les injustices et toutes les inégalités. En cherchant à créer des liens multiples entre l’Afrique, l’Europe et la France. En cherchant à innover pour faire du développement un partage d’expériences entre égaux. Aujourd’hui, le Sud inspire le Nord. Mobile banking, énergies renouvelables, gestion des biens communs : l’Afrique a beaucoup à nous apprendre!
Quelles sont les grandes lignes de la stratégie tout Afrique ?
L’AFD développe une stratégie « Tout Afrique ». Et si l’on cessait de couper l’Afrique en deux, entre Afrique du nord et Afrique subsaharienne, que verrions-nous ? Il est temps de voir l’Afrique comme un tout, comme la voient les Africains eux-mêmes, pour comprendre les dynamiques à l’œuvre – continentales, sous-régionales, nationales, territoriales. L’AFD veut sortir d’une vision duale du continent, décentrer le regard, décloisonner les approches. Voir l’Afrique du Maroc à l’Afrique du Sud, du Sénégal à Djibouti. C’est une évidence… qui n’en est pas encore une!

Notre stratégie « Tout Afrique » suppose de nous doter des moyens nouveaux pour traiter les enjeux transfrontaliers et les questions d’intégration régionale. L’AFD va notamment se doter de cinq délégations régionales en Afrique. L’AFD voudrait être la première institution non-africaine à voir l’Afrique comme les Africains eux-mêmes.
Nous voulons ainsi contribuer à la réussite des cinq grandes transitions engagées en Afrique comme dans le monde entier : la transition démographique et sociale, d’abord (la natalité, l’éducation, l’emploi des jeunes, les migrations) ; la transition territoriale et écologique (l’urbanisation, l’adaptation au changement climatique, la biodiversité) ; la transition énergétique (une énergie durable, abordable et accessible à tous) ; la transition politique et citoyenne (la paix, la gouvernance, la société civile) ; la transition numérique, enfin. L’AFD, Bpifrance et La French Tech viennent de lancer la deuxième édition du challenge « Digital Africa », concours de startups et d’innovations numériques en faveur du développement durable. Rendez-vous à Abidjan, lors du Sommet entre l’Union européenne et l’Afrique, pour découvrir les nouveaux lauréats!
L’Afrique est la priorité de l’AFD. Fondée par le général De Gaulle à Londres en 1941, notre Agence sait ce qu’elle doit aux Résistants et aux combattants d’Afrique
Quel peut être l’apport de l’International Development Finance Club (IDFC) qui réunit 23 banques de développement du Sud et du Nord ?
L‘International Development Finance Club (IDFC) est une plateforme inédite et significative dans la sphère du financement du développement, dont l’AFD est un membre fondateur tout comme nos collègues africains de la BOAD, de la Caisse des Dépôts et de Gestion marocaine, de la DBSA sud-africaine et de la TDB Bank d’Afrique de l’Est. Il s’agit d’un réseau de vingt-trois banques nationales et régionales de développement du Nord et du Sud, qui financent chaque année plus de 600 milliards de dollars de projets – ce qui en fait de très loin le premier financeur du développement. Dont près de 100 milliards déjà pour la lutte contre le changement climatique.
Pour mobiliser des volumes de financement plus élevés encore, nous finançons le secteur privé et nous cherchons à orienter les investisseurs vers l’Afrique indique Rémy Rioux
L’AFD va s’impliquer davantage encore dans ce réseau. C’est la raison pour laquelle j’ai participé cette semaine au forum sur l’investissement en Afrique organisé à Dakar par la China Development Bank (CDB), membre du club IDFC, avec la Banque mondiale. Car notre conviction est que le rôle des banques nationales de développement est essentiel. Elles sont seules capables de concrétiser les engagements de la communauté internationale, en mobilisant leurs puissants moyens financiers et leurs multiples relais dans leurs pays respectifs. Ce sont des acteurs cruciaux pour accélérer les transitions indispensables à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) que tous les pays membres des Nations-Unies se sont engagés à atteindre d’ici à 2030.
Vous injectez plus de fonds dans les prêts que dans les dons (1 milliard d’euros sur 9 milliards). Pourquoi cette option ?
La France a un modèle de financement du développement qui combine en effet prêts et dons. Nous avons besoin des dons pour intervenir dans les contextes les plus difficiles. Et nous accordons des prêts concessionnels, c’est-à-dire très inférieurs aux taux du marché, pour permettre des investissements d’un montant plus importants et qui ont un fort impact de développement durable. J’ajoute que, pour mobiliser des volumes de financement plus élevés encore, nous finançons le secteur privé et nous cherchons à orienter les investisseurs vers l’Afrique. C’est la mission de notre filiale PROPARCO, qui a fêté ses 40 ans le 19 septembre, et du nouveaux fonds d’investissement dans les infrastructures de 600 millions d’euros que nous montons avec la Caisse des Dépôts française. Et nos moyens vont encore s’accroître à l’avenir, puisque le Président Macron a fixé à 0,55% de notre revenu national le montant qui sera alloué à l’aide publique au développement (APD) en 2022.
Votre question rejoint une conviction forte, que nous nous sommes forgée depuis 75 ans que nous intervenons en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen Orient, dans les Caraïbes et dans l’outre-mer français. Le privé et le public sont complémentaires. Aucun pays ne s’est développé uniquement par de l’endettement public. L’investissement public est indispensable pour financer les services publics, pallier les défaillances des marchés et accélérer l’investissement privé. Mais c’est l’initiative privée qui permet de passer à l’échelle, de prendre du risque et d’innover. Nous finançons, par exemple, au Sénégal neuf centres de formation professionnelle selon un modèle de gouvernance public-privé innovant. L’emploi des jeunes est une priorité. Public et privé peuvent et doivent œuvrer ensemble à la prospérité de chacun.
Quels sont vos objectifs chiffrés en développement pour l’Afrique ?
Sur les cinq prochaines années, l’AFD engagera 23 milliards d’euros sur le continent. Le Groupe AFD entend maintenir la cible de 50 % de ses engagements en Afrique, et ainsi passer de 4 à 5 milliards d’euros par an. Pour y parvenir l’AFD va mobiliser toute la gamme de ses instruments financiers (prêts, dons, garanties, fonds propres) mais aussi son expertise et ses capacités de recherche. Pour être précise et pertinente, elle invente de nouveaux instruments comme une facilité Crises et Conflits de 100 millions d’euros par an en dons ou le fonds AFD-CDC pour les infrastructures et cherche à inventer de nouvelles formes d’actions, comme cette Alliance pour le Sahel, coalition inédite de bailleurs et de pays, pour faire plus et faire mieux pour les populations de cette région.
L’AFD se soucie-t-elle de transfert de technologies dans ses projets souvent exécutés par des entreprises françaises ?
L’AFD apporte à ses clients un soutien tant financier que non financier. A cet égard, l’appui conseil, le renforcement de capacités, et plus largement l’accès à l’expérience française dans de nombreux domaines font partie des transferts de savoir-faire auxquels les projets que nous finançons contribuent. Quant aux entreprises françaises, elles ont parmi les meilleures pratiques internationales en termes de responsabilité sociale et environnementale. Nous veillons dans le cadre de nos financements à ce que les meilleurs standards de concurrence, de passation de marchés et de qualité soient respectés.
J’irais plus loin. Le développement doit marcher dans les deux sens. Aujourd’hui, l’Afrique innove et nous aurions tort de ne pas nous en inspirer. Partager nos expériences et apprendre les uns des autres, c’est le sens désormais de la politique de développement. Nous devons porter la plus grande attention aux processus d’innovation croisée et inversée. Dans la défense de nos biens communs, le Sud a souvent une longueur d’avance sur le Nord. L’AFD veut accélérer cette prise de conscience et contribuer à en étendre les bienfaits.

Le Soudan du Sud, la République centrafricaine et le Niger dans le haut du classement des mauvais élèves
D’après le classement exclusif de ONE, 9 des 10 pays où l’accès des filles à l’éducation est le plus difficile sont en Afrique, et tous sont des Etats fragiles en situation de crise ou de conflit.
Les chiffres parlent d’eux même : au Soudan du Sud, 1er pays du classement, seulement une fille sur 4 va à l’école primaire. Au Burkina Faso, en 8e position, seul 1% des filles ont terminé leurs études secondaires.
Cet index montre que pour améliorer réellement l’accès de toutes les filles à l’école et à l’instruction, une attention particulière doit être accordée aux pays les plus pauvres et aux pays en conflit – en particulier en Afrique.
130 millions de filles sans accès à l’école : les raisons et les conséquences
L’accès des filles à l’éducation et la poursuite de leur scolarité se heurtent à de nombreux obstacles sociaux, culturels et économiques. Dans les 10 pays à la tête de ce classement, plus de la moitié des filles se marient avant leur 18ème anniversaire, et en moyenne, une fille sur quatre est obligée de travailler. Pour se rendre à l’école, parfois sans sanitaires ou manuels scolaires adaptés, elles doivent généralement parcourir de longues distances, souvent dans des conditions dangereuses.
Pourtant, lorsqu’une fille a accès à un enseignement primaire et secondaire de qualité, elle est plus susceptible d’être en bonne santé et de réussir professionnellement. L’éducation donne aux filles davantage de possibilités de faire valoir leurs droits, de contribuer au bien-être de leur famille et de leurs communautés et de participer au développement de l’économie locale et mondiale.
A titre d’exemple, la réduction des inégalités dans le monde entre les filles et les garçons en matière d’’éducation pourrait rapporter entre 112 et 152 milliards de dollars chaque année aux pays en développement.

Le Sénégal et la France, partenaires pour améliorer l’éducation dans le monde
Dans les mois à venir, le Sénégal et la France seront en première ligne pour améliorer l’accès à l’éducation à l’échelle mondiale. En effet, en février 2018, ils co-organiseront la reconstitution du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), un mécanisme international qui finance l’éducation dans les pays les plus pauvres.
Oulie Keita, représentante de ONE pour l’Afrique de l’Ouest, déclare :
« Les gouvernements du Sénégal et de la France vont co-parrainer la reconstitution du Partenariat mondial pour l’éducation à Dakar l’année prochaine. Ce sera un événement unique qui verra, pour la première fois, un pays donateur et un pays en développement travailler de concert pour accueillir une conférence de cet ordre. Ce sera aussi l’occasion de construire un partenariat pour des systèmes éducatifs de qualité dans les pays en développement. Le Sénégal est en effet un champion dans l’éducation, avec près de 25% de son budget national alloué à ce secteur.
« L’éducation est un des investissements les plus importants qu’un pays peut faire pour son avenir et celui de son peuple. Malheureusement, le dernier rapport de ONE montre que 9 des 10 pays où l’accès des filles à l’éducation est le plus difficile sont en Afrique. Pourtant on sait que l’éducation des filles peut avoir de nombreux effets positifs, que ce soient sur la réduction de la pauvreté et sur l’augmentation des revenus et de la croissance. C’est pourquoi les dirigeants africains et mondiaux doivent ensemble s’assurer que le Partenariat mondial pour l’éducation soit financé à la hauteur des besoins, soit 3,1 milliards de dollars pour 3 ans. »
Friederike Röder, directrice France de ONE, déclare :
« Cet engagement de la France engendre une responsabilité : Emmanuel Macron doit s’assurer, comme il l’a annoncé, que le PME soit financé à hauteur des besoins. Pour cela, la France doit avant tout montrer l’exemple et annoncer une contribution de 300 millions de dollars au PME pour la période 2018-2020. Cette annonce doit se faire au plus vite, afin d’entraîner d’autres pays donateurs dans son sillage. »
D’après le classement exclusif de ONE, 9 des 10 pays où l’accès des filles à l’éducation est le plus difficile sont, à l’exception de l’Afghanistan, situés en Afrique. Il s’agit du Soudan du sud (le pays qui enregistre la moins bonne performance), de la Centrafrique, du Niger, du Tchad, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Liberia et de l’Éthiopie.
Au Soudan du Sud, une fille sur quatre seulement va à l’école primaire et seuls 15,93 % des filles ont accès à l’éducation. Ce pays d’Afrique orientale est suivi par la République Centrafricaine (17,75 %), le Niger (21,50 %), l’Afghanistan (23,51 %), le Tchad (27,16 %), le Mali (29,28 %) et la Guinée (30,35 %).
Le Burkina Faso figure en 8e position (33,03 %) et seul 1 % des filles ont terminé leurs études secondaires. Les deux derniers pays du classement sont le Liberia (36,20 %) et l’Éthiopie (36,79 %).
L’agression fatale d’un policier à Yopougon le 31/08/2017, par les « microbes », officiellement appelés « enfants en conflit avec la loi », a mis toute la cité en alerte. Depuis lors, la ville d’Abidjan est soumise à une série d’interventions des forces de l’ordre dénommées « opérations épervier ».
Interventions à l’issue desquelles, plusieurs « microbes » sont appréhendés. Pourtant, le 28 septembre dernier, à Adjamé, contre toute attente, une série de nouvelles agressions de ces jeunes délinquants a été enregistrée en pleine journée. Ce problème de « microbes » est-ce un pur phénomène criminel ou le symptôme d’une société ivoirienne en crise ?
La crise post-électorale de 2010 a eu plusieurs répercussions sur la société ivoirienne. La Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR), mandatée pour « recoudre » le tissu social, a révélé une société ivoirienne post-crise loin d’un climat complètement apaisé. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les phénomènes de troubles sociétaux à l’instar de celui des « microbes ».
Ce phénomène est apparu, certes après la crise post-électorale, néanmoins, ce phénomène est le résultat de l’instrumentalisation des mineurs au cœur de cette crise qui les a engagés dans un apprentissage de la violence. En effet, plusieurs enfants ont pris une part active dans la crise de 2010 à 2011 en suivant des combattants, leur prêtant aide en tenant des sacs de munitions ou même des armes. Après ces événements faisant d’eux des acteurs aussi bien que leurs mentors (chefs de guerre), nul doute qu’ils ont goûté à la barbarie et à la violence.
Par conséquent, la majorité de ces enfants sont devenus des délinquants n’ayant autre modèle que la violence qui les a bercés, expression de l’influence psycho-sociale d’une société toujours en crise. D’ailleurs, à la « prétendue » sortie de crise post-électorale, aucune commission de prise en charge psycho-sociale n’a été mise en place pour résorber tant soit peu les traumatismes subis par ces jeunes.
Le phénomène des « microbes » n’a émergé que de quartiers pauvres, à l’instar de la commune d’Abobo qui en dénombre plusieurs. Cette commune a abrité de nombreux combats entre forces régulières et celles qui ne le sont pas. L’on ne saurait oublier, en Côte d’Ivoire, le fameux « commando invisible » qui a fait de cette commune son fief. Cette commune est depuis belle lurette un fief de gangs dangereux qui ont trouvé dans la pègre un moyen de s’affirmer en essayant d’échapper à leur marginalisation sociale. Sans conteste, la plupart des gangsters qui vivent dans cette commune ont tous un point commun : la pauvreté de leur famille. À Abobo, il est courant de voir des jeunes qui ont interrompu, faute de moyens financiers, leurs cursus scolaires pour « traîner » dans les gares routières et les rues, sans perspectives d’avenir.
Toutes les communes qui voient cette délinquance juvénile prendre de l’ampleur regorgent de familles pauvres et de chômeurs. Ainsi, le taux de chômage des jeunes selon l’Organisation internationale du travail (OIT) s’estime à près de 9,4% en 2017. Le taux de pauvreté au niveau national est de 46% malgré une croissance de 8% en moyenne ces dernières années. La responsabilité de l’État dans le chômage et la pauvreté est bien établie en raison de ses politiques économiques non inclusives.
Là où les familles sont taraudées par la pauvreté et le chômage, il n’y a presque pas de perspectives et de modèles à suivre par les jeunes. Ceux-ci sont sans repères, puisque leurs familles ne peuvent le leur offrir. La famille n’est-elle pas le premier lieu éducatif de l’enfant ? Il est déconcertant de voir des familles où les enfants passent plus de temps dans la rue qu’avec leurs parents, sans que ceux-ci ne s’en soucient.
L’exemple des familles polygames est encore plus critique, vu qu’elles peuvent se retrouver avec près d’une vingtaine d’enfants dont il faut assurer l’éducation. Comme corollaire, ces enfants sont à la merci des ex-combattants rebelles, de chefs de gangs ou des détenteurs de fumoirs de drogue qui les utilisent pour acquérir de l’argent, en restant dans l’ombre, par et dans la violence, leur garantissant protection et secours au besoin. D’une manière ou d’une autre, le phénomène des « microbes » découle manifestement de la démission des familles.
La méthode répressive ne peut réussir à éradiquer ce phénomène de « microbes », car à n’en point douter, ce phénomène est la conséquence d’une société ivoirienne en crise. En ce sens, il faudrait le juguler par une approche plus globale. De prime abord, il faudrait accorder un soutien financier ciblé et décent aux familles pauvres. Car, même si la Banque mondiale s’est donnée pour tâche d’allouer à 35000 ménages 36000 francs CFA par trimestre, avec une participation de l’État ivoirien à 10% des 25 milliards de francs CFA budgétisés, il faut reconnaître que cela reste insignifiant.
Ensuite, il importe de revoir le modèle de développement, afin que la croissance économique soit pourvoyeuse d’emplois et plus soit inclusive. De plus, il faudrait inciter à l’entrepreneuriat, non par des slogans ou la distribution de quelques crédits, mais en améliorant la qualité de l’environnement des affaires pour qu’il soit plus favorable à l’initiative privée.
La promotion de l’entrepreneuriat va de pair avec création de richesse et emplois, ce qui permettra de sauver ces jeunes de la délinquance et du crime. Enfin, il faudrait soutenir la société civile, en vue de multiplier les actions de sensibilisation, de rééducation et de réinsertion de ces jeunes. C’est en actionnant tous les leviers que ce phénomène peut être éradiqué. Rappelons la citation de Carl Jung, « Un homme sain ne torture pas ses semblables, il n’y a que les victimes qui deviennent les bourreaux ».
AGBAVON Tiasvi Yao Raoul, étudiant-chercheur en Philosophie, Université Alassane Ouattara.
Avec Libre Afrique
« L’État a besoin du secteur privé et le secteur privé a besoin de l’État »
À l’occasion des Rencontres Africa 2017 à Abidjan, le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) a présenté le deuxième volume des « Cahiers du Cian » consacré au dialogue entre les secteurs public et privé en Afrique.
En présence d’Étienne Giros, Président Délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), Patrick Sevaistre et Jean-Luc Ricci ont présenté leur dernier livre « Le nouveau pacte africain : les défis du dialogue public – privé » (Éditions Michel Lafon).
Après plus d’une décennie de forte croissance économique, l’Afrique est actuellement confrontée à un ralentissement qui s’explique par la baisse des cours des matières premières, mais pas seulement. Le continent souffre aussi d’un déficit de dialogue entre les États et le secteur privé, pourtant nécessaire afin de transformer les économies pour les rendre plus performantes et plus compétitives. Environnement des affaires, fiscalité et législations, secteur informel, partenariats public/privé pour financer les immenses besoins en infrastructures…, les sujets ne manquent pas et sont autant de défis à relever.
Sans parti pris et avec une solide expérience, les deux auteurs présentent dans ce livre un diagnostic précis du dialogue public privé en Afrique et proposent une série de réformes à engager pour changer la donne et instaurer un véritable climat de confiance. Avec deux objectifs : promouvoir l’État stratège, facilitateur et arbitre, renforcer le rôle des entreprises dans le développement de l’Afrique.
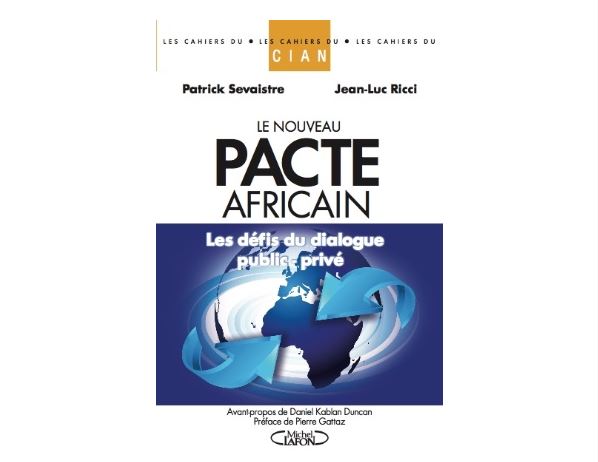
« Après plusieurs années de méfiance, voire même d’hostilité, l’heure est à une prise de conscience : l’État a besoin du secteur privé et le secteur privé a besoin de l’État. La volonté est donc au rendez-vous mais à présent il faut passer aux travaux pratiques avec des réformes précises et de véritables politiques publiques pro-business », explique Patrick Sevaistre, consultant spécialisé dans les politiques publiques et le développement du secteur privé en Afrique, qui insiste sur l’importance des espaces de dialogue et de discussions pour élaborer des compromis.
« L’État a besoin du secteur privé pour augmenter ses recettes, financer les plans de développement et les infrastructures, diversifier l’économie et créer des emplois. Ces deux mondes ont donc l’obligation de travailler ensemble même si parfois les intérêts sont divergents », ajoute Jean-Luc Ricci, Directeur du développement de HEC Paris en Afrique.
« Après la révolution digitale pour le premier tome des Cahiers du CIAN, il nous semblait important de produire une réflexion sur l’état d’avancement du dialogue public – privé en Afrique. Nous sommes une organisation patronale en relation permanente avec les pouvoirs publics français et africains. Nous sommes persuadés que nous devons avancer ensemble sur tous les sujets économiques au bénéfice des populations », déclare Étienne Giros.
« Le nouveau pacte africain : les défis du dialogue public – privé » contient un avant-propos du Vice-président de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, et une préface de Pierre Gattaz, Président du Medef.
Patrick SEVAISTRE est consultant spécialisé dans les politiques publiques et le développement du secteur privé en Afrique. Membre du Comité directeur du CIAN et Conseiller du Commerce Extérieur de la France (CCEF), il est également chargé d’enseignement à Sciences Po et HEC Paris.
Jean-Luc RICCI est directeur du développement de HEC Paris en Afrique et membre du Comité Afrique du Medef International. Il conduit des programmes pour la haute fonction publique. Il établit des partenariats avec les institutions internationales et conçoit des programmes sur mesure pour les entreprises africaines.
Les Cahiers du CIAN
Lancée par le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), qui regroupe l’essentiel des sociétés françaises présentes sur le continent africain, cette collection a pour but de décrire les grandes évolutions de l’Afrique. Les Cahiers du CIAN visent à participer au débat public en contribuant à l’implication de l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et de la société civile. Son ambition est de renforcer la connaissance et la confiance en l’Afrique de demain.
Éditeur
Michel Lafon, 20 €, 192 pages, en librairie à partir du 26 octobre 2017.
Le travail d’HITeuse produit un effet sur le plan professionnel : elles incorporent les codes de l’entreprise alors qu’elles n’avaient juste un usage personnel.
Lancée en 2016, dans le cadre d’une démarche d’externalisation équitable ou « impact sourcing », isahit a pour mission de redonner de la dignité par le travail aux personnes en recherche de complément de revenu. Pour cela, la plateforme met en relation des « workers » d’Afrique et des entreprises françaises cherchant à externaliser une partie de leurs activités digitales nécessitant l’intervention humaine, mais aucune qualification. Depuis son lancement, isahit a mis en place un référentiel d’évaluation avec l’aide du cabinet KIMSO pour pouvoir suivre et mesurer son impact social. Les résultats à 6 Mois après le lancement montre que :
Profil type du « HITer » : une femme diplômée de 27 ans avec une bonne connaissance des outils numériques.
Isahit emploie plus de 145 HITeurs, principalement des femmes, et c’est cette population qui est représentée dans l’échantillon retenu par KiMSO pour son étude d’impact. La majorité d’entre elles a entre 26 et 30 ans (52%) et près de 9 sur 10 ont un ou plusieurs enfants (2 en moyenne). Étudiantes (32%), déjà actives (32%) ou sans emploi (36%), elles vivent pour la plupart au sein d’une famille nombreuse, comprenant au moins 6 membres (56%).

100% des HITeuses interrogées sont inscrites sur les réseaux sociaux et ont une activité sur Internet, comme « lire les journaux » (88%) ou « suivre des cours » (32%). Elles sont également 80% à disposer d’un compte bancaire ou d’un moyen de paiement en ligne.
62% des Hiteuses rencontrent des difficultés pour financer leurs études et les revenus générés par la plateforme leur donne les moyens de poursuivre leur cursus universitaire
Les HITeuses encore étudiantes dépendent majoritairement du soutien de leur famille (87%). Néanmoins, 62% reconnaissent rencontrer des difficultés pour financer leurs études. Toutefois, si 40% d’entre elles déclarent une activité rémunérée complémentaire à isahit, la plateforme représente bien souvent leur principale source de revenu et 60% des HITeuses en dépendent même exclusivement. Il s’agit pour elles d’une rémunération stable, avec un taux horaire bien supérieur à ce qu’elles peuvent espérer trouver ailleurs.
Ainsi, pour celles qui sont encore étudiantes, le revenu généré par cette activité leur donne les moyens de se maintenir dans le système universitaire. De leur côté, 94% des HITeuses qui avaient dû interrompre leurs études supérieures pour des raisons financières (frais de scolarité trop élevés ou obligation de travailler pour subvenir aux besoins du foyer) peuvent de nouveau se projeter dans une formation diplômante.
88% déclarent pouvoir, grâce à leur travail sur isahit, faire face aux dépenses et soutenir financièrement leur entourage en cas de besoin
Isahit : vecteur d’empowerment de la femme Africaine par le numérique.
Jeunes et dynamiques, les HITeuses révèlent une forte capacité à être dans l’action et à agir pour améliorer leur quotidien. En travaillant pour isahit, elles gagnent en confiance et en autonomie. Au quotidien, cela se traduit par la possibilité pour elles de résoudre des problèmes tels que : faire face aux dépenses ou soutenir financièrement leur entourage en cas de besoin (88%). Elles développent par ailleurs une plus grande ouverture d’esprit et une vision moins court-termiste. Ainsi, 100% affirment avoir confiance en elles et être capables de se projeter dans l’avenir.
Majoritairement heureuses dans leur vie (76%), elles souhaitent toutes poursuivre leur travail de HITeuse, même une fois leur projet personnel abouti, comme monter leur propre business ou se lancer dans une carrière en rapport avec leur diplôme.
« Nous recevons régulièrement des messages de nos HITeuses qui nous remercient. Si elles sont majoritairement familières des outils numériques, très peu de HITeuses en avaient jusqu’alors un usage professionnel. Ainsi, les premières choses qu’elles ont apprises en arrivant chez isahit ont été de se créer un mail, d’utiliser des logiciels de communication comme Skype® ou encore de faire des recherches pertinentes sur Internet. Ainsi, en devenant HITeuses, elles ont pu améliorer leurs compétences professionnelles en matière de digital, tout en intégrant les codes de l’entreprise. », explique Isabelle Mashola, Présidente d’isahit.
Les témoignages des HITeuses rencontrées dans le cadre de cette première étude d’impact montrent que l’apport financier de la plateforme améliore concrètement leur quotidien, leur ouvre de nouvelles perspectives et renforce leur capacité à faire des choix et à agir sur leur vie.
L’objectif assigné à ce plan est de réduire la pauvreté et d’impulser le développement. Cependant, ces fonds qui seront collectés contribueront-ils au développement du pays ou s’agit-il d’une contrepartie des services géopolitiques que Deby rendra aux Occidentaux?
Depuis 2003, le Tchad a initié deux documents de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP 1 et 2), quatre Plans Nationaux de Développement (PND 2003-2006 ; PND 2008-2011 ; PND 2013-2015 et le PND 20017-2021). A cela, faut-il ajouter les PND 2022- 2026 et 2027-2030 contenus dans le document « Vision 2030, le Tchad que nous voulons », pour lesquels, il faudra encore mobiliser des fonds. Ces documents censés tracer la voie pour un développement harmonieux se sont révélés des fiascos. Pis, ils étaient des opportunités d’enrichissement pour les gouvernants, sans réel impact sur la vie des populations tchadiennes.
En effet, le pays occupe la 186ème place mondiale sur 188 selon l’Indice de Développement Humain 2016. En outre, seulement 52% de la population a accès à l’eau potable contre 3% de la population à l’électricité selon la Banque Africaine de Développement. Plus de 3,7 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire en 2016 selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires. Certes, des avancées sont constatées dans le domaine des infrastructures. Mais, celles-ci obéissent peu aux normes de réalisation parce que le maître d’ouvrage est tenu de mouiller la barbe de toute une chaîne de commandement.
L’échec des Stratégies et Plans de développement est lié à l’adoption d’une approche du développement par « le haut ». Des approches élitistes donc, déconnectés des vrais besoins du peuple «d’en bas»; irresponsables car absence de transparence et de reddition des comptes, privilégiant le bureaucrate sur l’entrepreneur. Or, seul ce dernier peut créer de la richesse et des emplois. Aussi, avec une telle approche dirigiste de l’économie, on ne pourrait que créer de la corruption, de la gabegie, de la rente au lieu de créer des entreprises, de la richesse et des emplois. En d’autres termes, les bailleurs de fond, en plus de la prime à la dictature, accordent une prime à la mauvaise gouvernance et aux mauvaises politiques économiques.
Le népotisme, la corruption, la gabegie, la « tribalisation » de l’administration,…, sont les maux qui minent l’Etat tchadien. Le pays occupe la 40ème place sur 59 pays africains et la 159ème place mondiale sur 176 pays selon le classement de Transparency International 2O16. Par ailleurs, l’indice Mo Ibrahim 2016 qui évalue la gouvernance place le pays 51ème sur 54 pays. Dans son Rapport, « Tchad S.A », l’ONG SWISSAID, fustige clairement la gestion patrimoniale des revenus du pétrole. Le pays a engrangé plus de 13 milliards de dollars des revenus du pétrole à partir de 2003. Pourtant, 50% de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. La raison est que « Déby aurait fait du Tchad une véritable S.A familiale ».
Enfin, le Tchad est l’un des pays où le climat des affaires reste des plus hostiles en Afrique, décourageant ainsi l’entrepreneuriat. L’indice Doing Business 2017, crédite le pays de la 48ème place sur 53 pays africains alors que selon l’indice de liberté économique publié par l’Institut Fraser, le Tchad est classé parmi les 11 pays du continent réprimant la liberté économique. Si le Tchad est un Etat défaillant, comment alors expliquer l’enthousiasme des partenaires occidentaux qui continuent à miser sur le soldat-Deby?
Le fort engouement des bailleurs s’explique par l’importance que le Tchad représente dans leur dispositif sécuritaire et de projection de puissance. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Tchad est en première ligne avec ses contingents au Mali, au Nigéria et au Cameroun. En outre, environ 3000 soldats tchadiens devraient participer à la force du G5 Sahel, 5000 sont engagés dans la Multinational Joint Task Force (MNJTF) dans la lutte contre la secte Boko Haram. 1150 opèrent au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le pays est également intervenu en Centrafrique dans le cadre des opérations de maintien de la paix.
Ces soldats qui devraient servir à assurer la sécurité du peuple sont devenus, en quelque sorte un moyen de chantage et d’échange pour drainer les dons et les financements. Le Président Déby en a fait la démonstration lors de son interview avec les journalistes de la Radio France Internationale, dans l’émission « Internationale » en menaçant de retirer ses forces dans la lutte contre le terrorisme, si ses partenaires occidentaux ne lui venaient pas en aide. La forte mobilisation pour le financement de ce PND répond donc, à la logique de la préservation d’un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme.
En ce qui concerne la lutte contre l’immigration clandestine, le Tchad fait partie des pays de transit des migrants. Une coopération avec la France dans le cadre de la sécurisation des frontières afin de lutter contre les migrants est en cours. Des centres de tri (hotspots) des migrants sont envisagés dans le cadre de cette coopération. Le pays profite donc, d’une rente liée à son positionnement géographique. Pour avoir des financements, il accepte de faire le travail ingrat.
Au plan militaro-stratégique, de nombreuses initiatives s’appuient sur le positionnement du pays. Le commandement opérationnel de la force Barkhane, le Quartier Général de la Force Mixte Multinationale de la CBLT se trouvent au Tchad. Le pays fait partie du dispositif américain de lutte contre le terrorisme (TSCTP), il abrite une base française de projection et d’attaque qui constituent des postes avancées pour le contrôle indirecte du pays. Le Tchad assure donc, une sous-traitance stratégique aux puissances tout en sacrifiant les intérêts suprêmes du peuple tchadien. Le pays offrira ses services à ces puissances, en contrepartie, l’on fermera les yeux sur les exactions, les malversations financières et économiques. Le grand perdant dans ce marchandage, c’est le peuple tchadien.
Bref, le PND ne peut profiter au peuple tchadien que si les bailleurs de fonds conditionnent le financement à la vraie démocratisation et la bonne gouvernance. Faute de quoi, les financements offerts ne feront que renforcer l’emprise du Président Déby sur le pays en lui donnant encore plus de moyens pour asservir son peuple.
Alfred Ndegoto, chercheur tchadien.
Article publié en collaboration avec Libre Afrique

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, ont présenté aujourd’hui leurs plans pour accélérer la mobilisation de financements en faveur de l’action climatique, à travers une nouvelle plateforme conçue pour identifier et faciliter les investissements porteurs de transformations dans les pays en développement.
Après une semaine de rencontres avec des leaders politiques et des chefs d’entreprise ainsi que des responsables de villes ou d’États et des représentants de la société civile du monde entier, les deux hauts responsables ont plaidé pour une action climatique d’urgence et une hausse massive des investissements.

« Les pays s’emploient avec succès à réduire leurs émissions et à améliorer leur résilience au changement climatique, mais, pour parvenir à faire en sorte que leurs actions soient à la hauteur des objectifs fixés à Paris voici deux ans, il sera indispensable d’augmenter très fortement le flux de financements et d’investissements requis pour assurer la réalisation des contributions déterminées au niveau national, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Les catastrophes naturelles qui s’abattent actuellement sur la planète (ouragans, inondations, sécheresses…) démontrent clairement l’urgence de cette mobilisation, en particulier pour les petits États insulaires. »
Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale, s’est adressé en ces termes au Bloomberg Global Business Forum : « Des domaines comme les énergies propres et l’agriculture climato-intelligente recèlent un immense potentiel pour les pays en développement et permettront d’installer les conditions d’un avenir plus durable et prospère. Tout l’enjeu, pour nous, est de s’assurer que les investissements affluent et de mobiliser et coordonner toutes les formes possibles de financement afin d’avoir un impact maximal. »
La nouvelle plateforme Invest4Climate entend rassembler des gouvernements, des institutions financières, des investisseurs privés, des organisations caritatives et des banques multilatérales dans le but de soutenir une action climatique porteuse de transformations s’inscrivant dans les objectifs de l’accord de Paris. Cette plateforme réunira des investisseurs autour de projets à fort impact dans les pays en développement, à l’image du développement à grande échelle d’accumulateurs, des véhicules électriques ou des systèmes d’air conditionné à faible niveau d’émissions. Elle facilitera également ces opérations financières en introduisant des instruments d’atténuation du risque et, le cas échéant, en travaillant avec les autorités nationales à l’optimisation du cadre réglementaire.
« Les villes ouvrent la voie de la lutte contre le changement climatique et pourraient avoir une efficacité encore plus grande et rapide si elles avaient accès à davantage de financements, a souligné Michael R. Bloomberg, l’envoyé spécial des Nations Unies pour les villes et le changement climatique. C’est là un défi majeur auquel nous pouvons nous atteler à travers des mesures concrètes, en aidant notamment les villes à améliorer leur solvabilité, quantifier leurs besoins financiers et baliser certains projets vers des prêteurs potentiels. La Banque mondiale et les Nations Unies montrent l’exemple, en rassemblant toutes les énergies susceptibles de contribuer à la réalisation de ces objectifs. »
La plateforme Invest4Climate bénéficiera du soutien de ministères des Finances, de responsables politiques sensibilisés aux enjeux climatiques, de chefs d’entreprises, de fondations et d’institutions financières mais également de hauts responsables des Nations Unies et du Groupe de la Banque mondiale. Elle ne disposera pas de ses propres sources de financement, mais viendra compléter les initiatives et les institutions de financement du climat et du développement qui existent déjà.
Son champ d’action sera affiné en concertation avec les différents partenaires lors des prochaines Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI et de la COP23. Les premières initiatives soutenues par la plateforme Invest4Climate devraient être annoncées à l’occasion du sommet sur le climat à Paris, en décembre 2017.
La Commission économique pour l’Afrique (CEA) joue un double rôle en tant qu’organisme régional de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et en tant que partie intégrante du paysage institutionnel régional en Afrique.
Composée de 54 États membres, la CEA est bien placée pour contribuer spécifiquement à la recherche de solutions aux défis de développement du continent.
Créée en 1958 par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, la CEA est l’une des cinq commissions régionales et a pour mandat d’appuyer le développement économique et social de ses États membres, d’encourager l’intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.
La CEA tire sa force de sa qualité de seul organisme des Nations Unies à avoir pour mandat d’opérer aux niveaux régional et sous-régional pour mobiliser des ressources et les mettre au service des priorités de l’Afrique. Pour renforcer son impact, la CEA porte une attention particulière à la collecte de statistiques régionales actualisées destinées à étayer la formulation de politiques et le plaidoyer ; promouvoir le consensus politique ; appuyer le renforcement des capacités ; renforcer les services consultatifs dans les principaux domaines thématiques.
Les domaines thématiques prioritaires de la CEA sont les suivants:
La CEA apporte également des services consultatifs techniques aux gouvernements africains, aux organisations et institutions intergouvernementales. En outre, elle formule et favorise des programmes et projets d’aide au développement au profit des États membres et de leurs organisations et institutions intergouvernementales et agit en tant qu’agence d’exécution de projets opérationnels pertinents.
Les services consultatifs régionaux spécialisés aux États membres et le soutien au renforcement de leurs capacités essentielles s’articulent autour des priorités suivantes:
Le secrétariat de la CEA comprend le Bureau du Secrétaire exécutif, qui est secondé par un Secrétaire exécutif adjoint. Son programme de travail repose sur deux piliers: la recherche sur les politiques et la diffusion du savoir. Il existe cinq divisions organiques à la CEA (politique macroéconomique, intégration régionale et commerce, formulation de politiques sociales, initiatives spéciales et Centre africain pour la statistique) responsables de la recherche sur les politiques.
La Division du renforcement des capacités, l’Institut africain de développement économique et de planification (organe de formation de la CEA), la Division de l’administration et les bureaux sous-régionaux de la CEA à Rabat, Niamey, Yaoundé, Kigali et Lusaka constituent les pièces maîtresses de diffusion du savoir. La Division de la planification stratégique et de la qualité opérationnelle ainsi que la Division de la gestion de l’information publique et du savoir relèvent directement du Secrétaire exécutif. Le Bureau des partenariats et le Secrétariat conjoint CEA/CUA/BAD sont dirigés par le Bureau du Secrétaire exécutif adjoint.
Le représentant de l’Unicef en Guinée Équatoriale, dans une interview à Info Afrique parle de l’action de l’Unicef en Guinée Équatoriale.
Par : Fabien Essiane
L’un des objectifs de l’Unicef, c’est de réduire l’extrême pauvreté et la faim afin que la moitié de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour s’améliore. Et cette réduction de la pauvreté commence par les enfants. Que fait dans ce sens la représentation en Guinée Équatoriale que vous dirigez?
Ici en Guinée Équatoriale, nous sommes quelques partenaires qui nous investissons dans la lutte contre la pauvreté. Je veux parler des organes du système des nations unies (OMS, PNUD, FNUAP, ONUSIDA, FAO). Il y a en plusieurs ici et ils participent aussi de la lutte contre la pauvreté en Guinée Équatoriale. Il y a aussi le soutien indéfectible du gouvernement, avec qui nous collaborons beaucoup dans les incitatives en faveur de la lutte contre la pauvreté.
Lorsqu’on parle de Guinée Équatoriale, on parle de richesse le taux de croissance est l’un des plus élevé du monde. Est-ce qu’il y a des pauvre ici ?
Comme dans tous les pays du monde, il y a des pauvres. Mais une lutte intense est menée pour que le taux des pauvres diminue. Et ce travail est déjà palpable. Entre 2006 et 2011, le taux de pauvreté est passé de 77 à 44%. Et la pauvreté extrême est passée de 33 à 14%. Donc vous voyez de gros efforts sont fournies par toutes les parties présentes. Et comme vous le savez, notre domaine ce sont les enfants. Et c’est prioritaire pour nous. Par exemple, nous sommes depuis le début de cette année entrain de nous investir énormément dans la couverture vaccinale afin que tous les enfants équato-guinéens aient accès aux vaccins.

Dans le domaine de l’éducation, il y a un effort énorme que nous faisons en partenariat avec le gouvernement équato-guinéen. L’Unicef est entrain d’appuyer l’État à travers la formation et le renforcement des capacités des enseignants pour des enseignements de qualité et l’équité.
Au niveau de la protection sociale, l’Unicef en collaboration avec les autres représentations du système des nations Unies, est sur un grand projet qui a pour objectif d’établir un système de protection sociale cohérent en faveur des familles de la guinée équatoriale. La finalité c’est de promouvoir l’équité et réduire la pauvreté.
Quelque 10% d’enfants de 7 à 18 ans ne sont jamais allés à l’école ici en Guinée Équatoriale. Est-ce que l’Unicef développe un programme ou un plan axé sur la scolarisation des enfants en Guinée Équatoriale ?
L’éducation continue d’être pour nous une grande préoccupation ici en Guinée Équatoriale. Il y a un programme que le gouvernement a mis sur pied en vue de son plan de développement économique et social « horizonte 2020 » (horizon 2020) et qui est intitulé « éducation pour tous ». Nous appuyions les autorités équato-guinéennes dans ce sens. En 2017, nous avons financé la formation d’au moins 2000 enseignants au niveau maternelle et primaire pour renforcer leurs capacités.
Mais le programme qui nous tient à cœur, c’est celui du changement des comportements. Nous nous y attelons à bien le mener. Si nous pouvons amener les enfants à changer les comportements depuis leur maison jusqu’çà l’école, cela pourrait contribuer grandement à la réduction du nombre de malades.
Oui bien sûr. J’ai tout récemment visité la ville d’Ureka dans le district de Luba. J’ai touché du doigt les problèmes des enfants. C’est un lieu isolé ou il n’y a pas de poste de santé. Je me suis rendu compte qu’il y a des efforts à faire pour les enfants de ce côté-là. Et je compte m’y rendre une fois de plus très prochainement. Je compte aussi me rendre dans le district d’Acurenam et de Mbini au Littoral ou San Antonio de Palé dans l’île d’Annobon.
Nous sommes entrain de nous organiser à y faire plusieurs visites dans les prochains mois.
La dimension traitée dans cet article concerne les droits de propriété physique. Ici les droits de propriété peuvent être définis comme l’ensemble des lois créées par le gouvernement d’un pays pour définir comment les individus peuvent posséder, faire fructifier et aliéner les biens. Un droit de propriété est le droit définitif et inaliénable de contrôler l’usage des ressources d’une propriété.
En plus du droit d’utiliser et de contrôler l’usage des ressources dérivées d’une propriété, le concept de droit de propriété comprend également le droit de déléguer le droit d’utiliser des ressources, le droit de vendre, de louer ou autrement aliéner la propriété. Là où les droits de propriété privée ne sont pas respectés, il y a un manque général d’incitation à préserver la terre, la propriété ou ses ressources.
Dans ce cas, l’individu ne voit pas l’intérêt de rationnaliser sa gestion de la terre ou de créer de la valeur, car justement il n’a pas de droit de propriété sur les fruits de ses efforts. Cette apathie conduit finalement à la surexploitation des ressources, aux gaspillages, à la mauvaise gestion et in fine au sous-développement. Le déficit de droits de propriété peut également entraîner une course destructrice, entre les individus dans la communauté, pour le contrôle des ressources économiques disponibles sur ces propriétés.
À la lumière de ce qui précède, il devient évident que les droits de propriété privée sont des institutions indispensables dans un pays. Il existe plusieurs avantages liés aux droits de propriété privée. Cette vue est étayée par les résultats de l’indice international des droits de propriété (IPRI) 2014.
Selon l’IPRI, les pays ayant un score IPRI élevé enregistrent des niveaux élevés de revenu par habitant, reçoivent plus d’investissements directs étrangers et affichent des taux supérieurs de croissance du PIB par rapport aux pays à faible score. Malheureusement, les pays africains ont de mauvais scores sur l’indice international des droits de propriété avec une moyenne de 4,8 sur 10. Bien que des pays comme l’Afrique du Sud (6,7), le Botswana (6,3) et l’île Maurice (6,3) se soient bien comportés ; sur les dix derniers pays du classement de l’IPRI, sept étaient africains. Selon une enquête de la Banque mondiale, si les pays africains peuvent simplifier les procédures complexes entourant la propriété et la gestion des terres sur le continent, il y aura une augmentation significative de la quantité de nourriture produite dans la région et une transformation structurelle vers plus de développement.

L’un des plus grands défis des droits de propriété en Afrique subsaharienne est que la plupart des terres ne sont pas immatriculées, ce qui fait que l’on ne sait pas exactement pas qui les possède ou qui a le droit de les utiliser. Selon le rapport de la Banque mondiale, on estime que jusqu’à 90% des terres rurales de l’Afrique sont sans titres fonciers. Au Nigeria, la position sur les droits de propriété privée est tout à fait claire. Elle est fermement ancrée dans la section 1 de la Loi sur l’utilisation des terres. Cette section attribue la propriété de toutes les terres situées dans un Etat au gouverneur de l’État. Toutes les terres urbaines sont la propriété, sous le contrôle et la gestion du gouverneur, tandis que la propriété, le contrôle et la gestion des terres rurales sont conférés au gouvernement local.
Sur l’Indice de l’IPRI, le Nigeria affiche un score de 30/ 100 étant le plus haut score possible. Cet index des droits de propriété mesure le degré de protection des droits de propriété privée par les lois d’un pays et indique dans quelle mesure son gouvernement applique ces lois. Des scores plus élevés signifient que les droits de propriété dans ce pays sont mieux protégés.
On ne soulignera jamais assez les avantages que procure la protection des droits de propriété. Elle entraîne une transformation radicale du niveau et de la qualité de la croissance économique. Afin d’assurer la protection des droits de propriété privée, le Nigeria doit :
– appeler à une réforme législative visant à modifier la première section de la Loi sur l’utilisation des terres qui attribue la responsabilité du contrôle et de la gestion de tous les biens situés dans un État au gouvernement d’un tel État.
– s’efforcer d’implémenter de meilleures politiques et règlementations relatives à l’immatriculation foncière. L’enregistrement des terres doit être réalisable vite et moins cher.
– éduquer et sensibiliser la population rurale au sujet du régime foncier, l’immatriculation et les droits de propriété privée.
Si ces recommandations sont mises en œuvre, le Nigeria sera sûr de bénéficier de :
– une stimulation de la croissance économique et de l’esprit d’entreprise. Lorsque les politiques d’immatriculation foncière appropriées sont mises en place, les individus auront un meilleur accès aux titres de propriété qui peuvent être utilisés comme garantie pour obtenir des prêts auprès des banques et d’autres institutions financières. De tels prêts peuvent alors être investis dans des projets et des joint-ventures.
– une augmentation de la confiance des investisseurs et in fine du niveau des investissements. Cela résulte de la confiance que les investisseurs ont quant à l’appropriation des fruits de leurs investissements car la propriété de leurs terres est sécurisée.
– une compétition saine et une bonne gestion des ressources disponibles. Contrairement au climat actuel d’apathie générale en faveur de la préservation de la terre, la réforme de l’utilisation des terres entraînera une utilisation saine de la terre par des individus qui savent pleinement qu’ils ont un intérêt à bien gérer la terre et qu’ils pourront en profiter. Ceci est contraire à la concurrence destructrice pour les terres et les ressources qui se produit quand il n’y a pas de propriétaires bien désignés.
Pour que le Nigeria atteigne un état où la liberté est à l’ordre du jour, les droits de propriété ne peuvent et ne doivent pas être ignorés. Les paroles de Friedrich Hayek sonnent vrai.
Oyinkan est coordonnatrice locale chez ASFL. Elle est également présidente de l’Association des étudiants des Nations Unies (ANUNSA) à l’Université d’Ibadan, Nigéria. Article initialement publié par African Liberty.
Une startup qui a pour but d’être le porte-étendard du continent Africain, de ses succès, de ses entreprises et technologies.
Nous souhaitons être plus qu’une simple écurie automobile mais une vraie passerelle entre l’Afrique et le reste du monde. Indique Ludovic Peze porteur du projet
Pour définitivement changer l’image que les gens ont de l’Afrique et qui est plutôt péjorative nous comptons être la première équipe à faire courir un pilote d’origine Africaine et de le former afin d’être professionnel et obtenir les meilleurs résultats et ainsi le faire participer à un championnat mondial et aux 24 heures du Mans avec notre équipe.
Grâce aux accords de fourniture passés avec des structures tels que la prestigieuse équipe de F1 et constructeurs Mclaren mais aussi structures spécialisées en prototype. Cela permettra de démarrer avec un capital performance garantie et compétitifs.

D’abord en franchissant les paliers étapes par étapes en commençant par le GT4 Southern Cup soutenu techniquement par Mclaren. Ce championnat permet de se rôder aux courses d’endurance dans un championnat professionnel, compétitif et dynamique avec de bonnes retombées médiatiques.
Puis en passant au championnat d’endurance ACO avec un prototype LMP3 qui permet d’apprendre le pilotage de prototype et se préparer aux 24 heures du Mans dans les meilleures conditions et travailler avec le promoteur de la course.
Participer aux 24 heures du Mans et à un championnat mondial afin de promouvoir nos partenaires et le continent aux 4 coins du globe et auprès du plus grand nombre.( 800 millions de télespectateurs et 230 000 spectateurs rien que pour la course de 24 heures du Mans ).
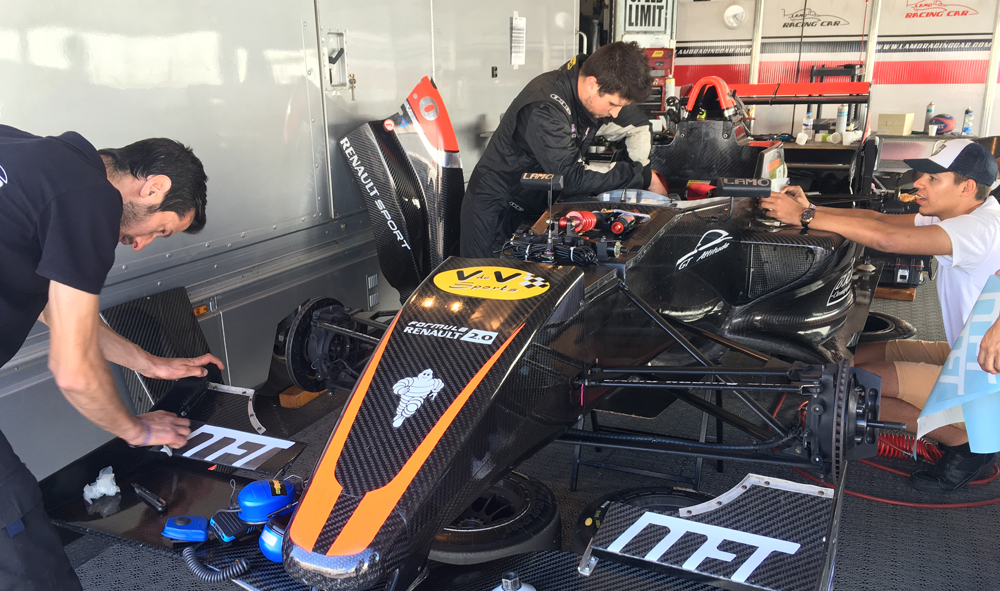
Ce serait avantageux pour les compagnies de soutenir un tel projet. « Au niveau des médias, on touchera aux alentours de 10 millions de personnes via la BBC Afrique et les autres médias dans le monde. Ajouté à cela, il y aurait le placement de produits, les revenus en termes de ‘merchandising’. Il y a également la possibilité d’organiser des événements. Les collaborateurs et clients seraient également invités en VIP, sans oublier la possibilité de stage avec McLaren sur des circuits en Europe ou encore en Afrique du Sud. »
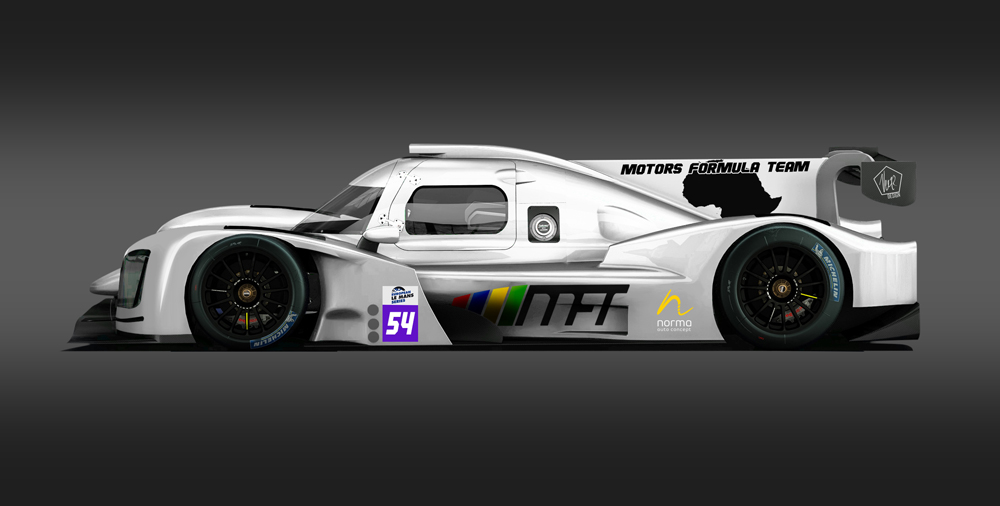
Ainsi, la MFT peut mettre la voiture aux couleurs du sponsor. C’est parfait pour les investisseurs. Ils peuvent acheter l’ensemble des emplacements et les revendre ensuite avec une plusvalue, afin d’avoir un retour sur investissement. Le secteur des loisirs, du tourisme et de l’immobilier bénéficierait également d’un tel partenariat, car les personnes qui assistent aux courses sont susceptibles d’investir ou de voyager en Afrique. Les promoteurs et financiers peuvent attirer bon nombre de clients.
L’équipe peut aussi participer ponctuellement à des courses dans les régions où ils ont des objectifs (Amérique , Europe, Asie, Océanie).
Pour en savoir plus contactez-nous : Ludovic Peze
La libéralisation du secteur des télécommunications a été lancée depuis 1999. Pourtant, le Bénin continue d’enregistrer de mauvaises performances du fait de la mauvaise gouvernance qui prévaut dans le secteur.
Après un contrôle effectué du 02 mars au 18 avril 2017, l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Benin (Arcep-Bénin) a constaté la persistance de la mauvaise qualité des prestations des réseaux de téléphonie mobile. Pour l’ensemble des réseaux, la conformité par rapport aux obligations des cahiers des charges varie entre 49% et 75% pour la 3G, et de 4% à 75% pour la 2G selon l’Arcep, et ce depuis les audits de 2016 et même bien avant.
Des pratiques de fraude ont été également constatées, incluant des complicités internes et externes au secteur et un manque à gagner de plusieurs milliards pour l’Etat Béninois et les opérateurs concernés chaque année.
Cela en dépit de l’obligation faite aux réseaux de sécuriser leurs installations.

Si tous ces maux existent en dépit de la libéralisation, c’est parce que celle-ci a été mal implantée en ignorant les préalables de mise en œuvre. La première étant bien évidemment l’existence d’un état de droit. La corruption, le manque de contrôle dans le secteur et surtout le silence complice des autorités sont les premiers responsables des maux du secteur. Déjà lors de la libéralisation du secteur en 1999, à cause de l’impréparation des acteurs, et une forte corruption, les licences avaient été bradées, souvent de gré à gré, à 120 millions FCFA aux réseaux pendant que le prix variait entre 800 millions FCFA au Togo et 70 milliards FCFA au Sénégal à la même période.
Les différentes réévaluations à 5 milliards FCFA puis à 30 milliards FCFA respectivement intervenues en 2004 et en 2007 souvent de façon arbitraire alors que les anciennes licences étaient toujours en cours.
Les appels d’offres étaient uniquement pour la forme. Cela a poussé les opérateurs à une course à la rentabilisation de leurs investissements, notamment la partie pots-de-vin. Le résultat a été : des tarifs élevés sans amélioration de la qualité des services. L’exaspération des abonnés a donc conduit au mouvement de boycott des services GSM largement suivi le 5 juillet 2017. L’existence d’une Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste est certes une avancée.
Mais la cooptation à peine voilée des membres de ladite autorité ne garantit pas l’autonomie de son fonctionnement. La « capture » de cet organe par les politiques et les hommes d’affaires ayant cautionné l’arrivée de ces membres, en a entaché l’impartialité et l’efficacité. Pour preuve, l’ancienne équipe de l’Arcep installée par le gouvernement passé et n’ayant pas fini son mandat, a purement et simplement été mise à la porte par un nouveau décret abrogeant les précédents à l’arrivée de l’actuel gouvernement. Déjà l’opinion publique soupçonne la nouvelle équipe de l’Arcep, à tort ou à raison, d’être le bras armé de l’exécutif contre les hommes d’affaires ou politiques dissidents exerçant dans le secteur.
En cause, la décision de retrait de licence à l’opérateur Bell Bénin précédemment propriété d’un député opposé au régime actuel. Au-delà de cette prise en otage de l’organe, ce qu’il faudrait pointer du doigt est la défaillance du cadre législatif, notamment la non-effectivité d’un code numérique devant servir de gouvernail. Même si la loi sur le code numérique a été adoptée au parlement le 13 juin 2017, elle n’est pas encore mise en application. Par ailleurs, l’Arcep ne dispose pas encore de tout l’équipement nécessaire à l’exercice de toutes ses attributions. Pour cette raison elle n’a que des réactions sporadiques alors que les préjudices sont quotidiens.
Ainsi, en matière d’accès à internet, le gigabyte coûte au minimum l’équivalent de 16,60% du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) d’après le rapport 2017 de l’Alliance pour Internet abordable.
Cela vaut au Bénin d’être classé 29ème sur 57 pays pris en compte.
Mais ce mauvais rapport qualité/prix s’explique par l’inexistence d’une concurrence saine entre les différents réseaux de téléphonie mobile. En effet, le Bénin dispose encore de trois réseaux actifs dont deux (Moov et MTN) contrôlent près de 90% du marché après la cessation d’activités de deux d’entre eux pour endettement massif.
Mais à en croire les tarifications, il y a une entente tacite entre les différents réseaux sur les prix et les parts de marchés au détriment des abonnés. Cela explique la forte similarité des offres, l’immobilité des tarifs et surtout l’absence de compétition directe entre les réseaux.
Face à ces constats amers, les sanctions ne suffisent pas à assainir le secteur. L’urgence est à l’instauration d’une veille sur le marché pour prévenir les pratiques anti-concurrentielles. En ce sens un conseil de la concurrence compétent et indépendant serait le bienvenu non seulement dans le secteur des GSM mais également pour les autres secteurs. Mais cela ne suffit pas pour améliorer la gouvernance du secteur. Il faudrait encore garantir un respect strict des cahiers des charges. Pour ce faire, les organisations de la société civile et l’Arcep ont un rôle important, particulièrement les associations de défense des consommateurs qui devraient redoubler de vigilance et être associées aux activités par l’Arcep afin de mieux protéger les intérêts des consommateurs.
En outre une ligne verte devrait être mise en place pour recueillir les plaintes des consommateurs. Enfin, les médias aussi doivent jouer leur partition en relayant les plaintes et informations utiles.
Sans une attention particulière au secteur des services GMS à travers l’instauration d’une meilleure gouvernance, et une autorité de régulation compétente et autonome, les bienfaits de la libéralisation espérés seront hors de portée.
Pire, le Bénin risque de rater l’émergence d’une économie numérique créatrice de richesse et d’emplois.
Mauriac AHOUANGANSI, doctorant-chercheur béninois.
Avec Libre Afrique.
C’est avec pragmatisme et sans tabou de Jean-Michel Huet, de BearingPoint et Dominique Lafont, ancien directeur Afrique de Bolloré évoquent le cap à prendre pour participer au développement de l’Afrique. Un rapport de l’Institut Montaigne
l’institut Montaigne insiste sur l’importance de développer davantage l’aide publique au développement française a destination des start-up, des petites entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Il faut impérativement également augmenter les montants dédiés au capital-risque et au capital amorçage, via Proparco et le nouveau fonds entre l’Agence française de développement (AFD) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Un autre point important des propositions chocs est la nécessité de favoriser la création de Partenariats public-privé (PPP) dans le secteur de l’éducation, en faisant appel aux entreprises investissant en Afrique, les écoles et universités étrangères et africaines, et les pouvoirs publics africains.
Un rapport impressionnant et passionnant qu’Info Afrique vous recommande vivement. Thierry BARBAUT, directeur de rédaction d’Info Afrique
Peu de régions du monde suscitent autant de lectures, de commentaires et de fantasmes que l’Afrique. Raisonnés (parfois), fantasques (souvent), passionnés (toujours), les discours et contre-discours sur l’Afrique se suivent et ne se ressemblent pas. De l’afro-pessimisme excessif des années 1960 à l’afro-optimisme démesuré des années 2000, une littérature abondante s’est penchée sur “l’Afrique”, espace géographique indistinct, tantôt appréhendé d’un bloc, tantôt disséqué par les commentateurs les plus avisés.
Parce que l’Afrique est traversée par une série de transitions qui la projettent résolument dans l’avenir. Les transformations à l’œuvre sont démographiques, politiques, économiques, sociales, climatiques ; elles dessinent une Afrique en mutation rapide, de plus en plus éloignée des images d’Epinal.
Parce que la France est un partenaire historique du continent. Notre antériorité et la continuité dans la relation avec de nombreux pays africains est incontestée. Pourtant, nous n’avons pas su proposer de stratégie de long terme pour leur développement économique. Concurrencée par les émergents, en premier lieu la Chine, la France peine à bâtir un discours renouvelé, empêtrée dans un passé qu’elle a longtemps refusé d’assumer pleinement pour avancer.
Parce qu’il est possible, enfin, d’en parler autrement. Le prisme politico-institutionnel qui a longtemps prévalu peut céder sa place à une vision qui est celle du terrain. Celle d’entreprises, grandes ou petites ; celle d’entrepreneurs, novices ou aguerris ; celle de startups qui peuvent être aussi idéalistes que pragmatiques. Ce sont ces voix là que nous avons souhaité porter dans notre rapport, à travers près de cinquante entretiens menés auprès d’entreprises de tout secteur et de toute taille.
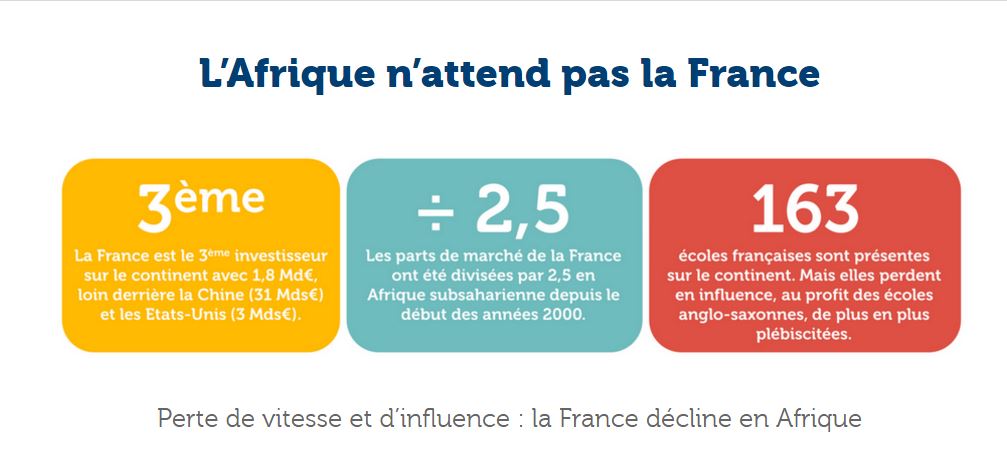
Le quinquennat qui s’ouvre doit être celui de l’afro-réalisme.
En France, il s’agit d’investir davantage et autrement, de multiplier les opportunités pour nos entreprises en nouant des partenariats locaux et de renforcer nos liens dans l’éducation et le capital humain.
En Europe, il s’agit de refonder la logique qui a longtemps prévalu : d’une relation “pays-continent” il est temps de muter vers une relation “continent-continent”, bâtie sur des accords renouvelés et des ambitions partagées.
L’Afrique subsaharienne est l’une des régions les plus dynamiques du monde, dépassée seulement par l’Asie émergente. Ses performances économiques sont, depuis le début des années 2000, supérieures à celles de l’économie mondiale. Alors que celle-ci s’accroissait de 4,2 % par an de 1999 à 2008, l’activité africaine connaissait une croissance moyenne de 5,6 % sur la même période. Depuis cette date et jusqu’en 2015 la croissance a oscillé entre 3,4 % et 7 % alors que la croissance mondiale se maintenait à un niveau proche de 3,5 %.
Ces dernières années ont également été marquées par des transitions démocratiques relativement réussies en Afrique, à l’instar de la transition à l’œuvre au Burkina Faso ou de la confirmation de la stabilisation en Guinée-Conakry, dans le cadre d’élections jugées libres par les observateurs internationaux. L’arrivée au pouvoir des partis d’opposition marque également l’instauration d’un cycle d’alternance électorale, comme au Nigéria en 2015 ou au Ghana en 2016. Ces récentes actualités ne doivent cependant pas faire oublier le maintien au pouvoir de régimes autoritaires, dont les dirigeants sont peu pressés de mettre leurs pays sur les rails de la transition démocratique.
Des mutations démographiques profondes traversent le continent : la population d’Afrique subsaharienne est passée de 186 millions d’habitants en 1950 à 670 millions en 2000. Selon des estimations, elle pourrait être portée à 2,5 milliards d’habitants en 2050 puis 4,4 milliards d’habitants en 2100. Cette croissance démographique représente autant d’enjeux que d’opportunités pour les pouvoirs publics africains.
Le secteur informel (ou “marché noir”), estimé à près de 80 % de son marché global, reste largement prédominant. Si la part du secteur agricole dans l’économie a nettement diminué depuis 1990 en Afrique subsaharienne (passant, entre 1990 et 2010, de 40 % à 32 % dans les pays à faible revenu), l’industrie ne s’est pas développée pour autant (environ 10 % de l’économie de ces pays). Le secteur des services est celui qui a connu le plus fort développement, avec de moindres effets sur l’emploi. Selon l’International Labour Organization, de 2009 à 2012, le secteur des services a ainsi représenté 32,4 % de l’emploi total en Afrique.
Structurellement déficient en Afrique subsaharienne, le système fiscal ne permet pas un financement adéquat des Etats alors même qu’il s’agit d’une condition indispensable au soutien de leur développement.
Qu’il s’agisse d’infrastructures d’énergie, de transports, de services publics éducatifs ou sanitaires, l’Afrique subsaharienne arrive en dernière position des régions en développement dans ce domaine. Encourager les investissements et améliorer les infrastructures sont donc deux défis majeurs.
Les questions d’éducation et de qualifications représentent un enjeu majeur. Avec plus de 300 millions de jeunes Africains sur le marché de l’emploi à horizon 2050, l’insertion et la valorisation de ces talents sont deux défis prioritaires.
Le manque de formation, le trop faible taux de scolarisation et l’hétérogénéité des structures éducatives sont considérés comme les principaux facteurs de blocage par les entrepreneurs, qu’ils soient français ou africains.
Si la scolarisation des enfants au primaire a fortement progressé ces dernières années, pour dépasser 76 % de la population en 2010, les taux de scolarisation demeurent bas dans le secondaire (40 %) et le supérieur (7 %). La qualité de la formation acquise reste par ailleurs généralement faible.
L’investissement dans le capital humain, condition indispensable au développement du continent, doit donc être renforcé.
Sur le continent africain, les atouts de la France sont indéniables :
Les “Nouvelles routes de la soie” développées par la Chine, la “Route de la Croissance Asie-Afrique” conduite par l’Inde et le Japon, les stratégies – contrariées mais volontaristes – menées par la Turquie, le Qatar, Israël ou encore le Brésil marquent un intérêt considérable des émergents pour l’Afrique.
Pékin accélère sa stratégie d’implantation durable sur le continent et distance ses concurrents. En 2016, la Chine est le plus important investisseur en valeur avec près de 31 milliards d’euros investis sur le continent, très loin devant les Etats-Unis (3 milliards) ou la France (1,8 milliard). Mais la route empruntée par la Chine ne génère pas uniquement de l’enthousiasme. Le défaut de certaines infrastructures, le manque de transparence dans les appels d’offres sont autant d’éléments qui pourraient, à terme, affaiblir la position dominante de Pékin.
La France doit porter une politique et une stratégie de développement économique franche en Afrique. Il est impératif de laisser nos inhibitions derrière nous en faisant collectivement le choix d’un nouveau discours : un discours de restart. Il suppose de lever les tabous. La corruption, les alternances démocratiques, les pratiques financières de certains pays émergents, le Franc CFA, ne doivent pas être abordés qu’à mots couverts. Il convient d’ouvrir plus largement ces sujets au débat démocratique pour crever des abcès créés par un manque de transparence. Ce discours doit avant tout dissiper les fantasmes qui nourrissent à tour de rôle les afro-optimistes et les afro-pessimistes. Le restart est résolument afro-réaliste, pragmatique. Il nous permet d’être prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui et celle de demain.
Il est également temps de considérer les pays africains comme nos partenaires, politiques et économiques. L’Afrique présente pour les entreprises françaises de nombreuses opportunités. Ce discours de restart doit libérer les énergies et favoriser l’accès des entreprises françaises aux marchés africains.
Existe-t-il une politique africaine de l’Europe aujourd’hui ? Les Etats membres de l’Union européenne, qui découvrent l’intérêt de coopérer sur les questions sécuritaires en Afrique, doivent-ils mener davantage d’actions en commun sur le continent africain ?
La France doit faire en sorte que la politique africaine de l’Europe ne soit pas uniquement dictée par le défi migratoire.
La France reste un partenaire commercial important pour l’Afrique subsaharienne (ses parts de marché dans les pays de la Zone franc atteignaient encore 13,7 % en 2016). Sa fine connaissance du continent est un atout. L’Allemagne, de son côté, souhaite davantage s’y investir, disposant pour cela de son bras armé, sa banque de développement, la KfW, qui, en 2015, a consacré 1,6 milliard d’euros à l’Afrique subsaharienne.
La période qui s’ouvre, portée par un européanisme réaffirmé, doit être celle d’un rééquilibrage des relations non plus de pays à continent mais entre deux continents se tenant face à face.
Paris et Berlin doivent s’allier pour relancer les relations euro-africaines dans un contexte stratégique :
1
Sous impulsion française, refonder au niveau européen le cadre réglementaire qui entoure les institutions internationales en exigeant d’elles un contrôle et une vérification du respect de l’application des clauses dans les projets qu’elles financent.
2
Orienter davantage l’Aide Publique au Développement française vers les startups, TPE, PME et ETI.
Augmenter les montants dédiés au capital-risque et au capital amorçage, via Proparco et le nouveau fonds entre l’AFD et la Caisse des dépôts et consignations.
3
Créer un guichet unique d’accès aux différents outils de financement, d’assurance et d’aide technique à l’export, à destination des entreprises françaises.
Réfléchir à l’opportunité de concentrer davantage certains instruments, à terme, au sein d’une banque française de l’export.
4
Utiliser les relais institutionnels français dans les organisations de développement pour aider les entreprises françaises à saisir les opportunités offertes par la mise en place d’instruments de financement du secteur privé par les bailleurs de fonds.
Utiliser plus efficacement le levier de l’expertise technique comme source d’information et d’influence pour mobiliser des financements.
5
6
Favoriser la création de Partenariats publics-privés dans l’éducation, intégrant les entreprises investissant en Afrique, les écoles et universités, étrangères et africaines, et les pouvoirs publics africains.
Axer ces PPP sur des compétences à la fois plus techniques et peu développées sur le continent (mathématiques, ingénieurs…) ; les orienter vers le niveau bac – 2 / bac + 3, par le développement de BTS notamment.
Cette diversification et cette massification de l’offre doivent permettre de répondre à l’enjeu déterminant de la formation du middle management, des techniciens, de l’innovation et de la recherche & Développement en Afrique.
7
Faciliter la délivrance de visas économiques et de visas étudiants afin de multiplier les opportunités pour les Africains en France. L’ensemble des démarches administratives nécessaires au recrutement de salariés africains doit procéder de cette même logique de simplification.
8
Dans le cadre du 5ème sommet Afrique-UE, proposer une stratégie claire, renouvelée et coordonnée des politiques européennes en Afrique. En s’appuyant sur le couple franco-allemand, redéfinir les objectifs de développement post-Cotonou, en coordination avec les pouvoirs publics africains. Associer le secteur privé européen, partie-prenante non escamotable, à ces négociations.
9
Promouvoir un « discours de restart » de la France en Afrique porté par les pouvoirs publics, afin de libérer nos entreprises d’une charge historique et politique qui handicape leur développement sur le continent. Ce discours de restart doit libérer les énergies et favoriser l’accès des entreprises françaises aux marchés africains.
Télécharger le rapport de l’Institut Montaigne

A l’occasion du 40ème anniversaire de Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au Secteur Privé, l’AFD, Bpifrance et La French Tech ont lancé le 19 septembre la deuxième édition du challenge Digital Africa, concours de startups et d’innovations numériques en faveur du développement durable.
La première édition du challenge Digital Africa, lancée en octobre 2016, avait reçu plus de 500 candidatures et récompensé 10 startups lauréates qui ont convaincu le jury par le potentiel d’impact de leur innovation. Forts de cette réussite, l’AFD, Bpifrance et La French Tech ont décidé de renouveler l’expérience avec pour objectif d’accompagner sur le long terme l’émergence d’écosystèmes numériques matures et solides, porteurs de nouvelles opportunités économiques.
La révolution numérique est en train de transformer le continent africain. C’est un ferment d’innovation qui bouleverse les économies et les sociétés. Ecologie, énergie, culture, éducation, création artistique, gouvernance, médias : le numérique a un impact transversal et démultiplicateur dans tous ces secteurs clés.
« L’innovation numérique est foisonnante en Afrique. Les Africains sont en train de réaliser un saut technologique qui accélère l’émergence du continent. Avec Digital Africa, en accompagnant des startups emblématiques des écosystèmes numériques africains, l’AFD remplit sa mission de développement au service de l’éducation et de l’innovation, à l’heure du numérique. Le développement marche aujourd’hui dans les deux sens, entre les deux rives de la Méditerranée. » Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD.
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance déclare « Nous sommes fiers de participer au challenge Digital Africa et d’accompagner 5 startups françaises dans leur développement sur le continent africain qui offre d’exceptionnelles opportunités. Ce concours s’inscrit dans la continuité de nos actions pour l’internationalisation des entreprises et la coopération avec le continent Africain.»
« L’innovation en Afrique fait preuve d’un développement extraordinaire et les écosystèmes de startups y sont en pleine structuration. En favorisant aujourd’hui les liens entre entrepreneurs français et africains, nos écosystèmes se construisent un avenir commun. Le challenge Digital Africa est pour La French Tech une étape supplémentaire pour porter cette ambition avec l’Afrique.» David Monteau, Directeur, La French Tech, Ministère de l’économie et des finances.
L’ensemble des lauréats de cette seconde édition du Challenge Digital Africa bénéficieront d’une visibilité sans précédent et de l’accès à un réseau mondial de partenaires, clients, investisseurs. Ils intègreront une communauté qui rassemble les meilleurs talents de l’innovation numérique en Afrique et pour l’Afrique, de partage d’expériences, de pratiques.
Les 5 startups africaines lauréates seront accompagnées par l’AFD au travers d’un « pack accélération », appui technique et financier personnalisé d’une valeur maximale de 30 000 euros.
Les 5 startups françaises lauréates seront accompagnées par Bpifrance qui leur offrira un pack accompagnement d’une valeur maximale de 10 000 euros pour renforcer leur expertise et développer de nouvelles opportunités sur le continent africain : formation Bpifrance Université, voyage de networking et de découverte des écosystèmes d’Abidjan et de Cape Town, auprès de la communauté des entrepreneurs français dans les French Tech Hubs.
« Pour une jeune startup, le challenge Digital Africa offre une belle opportunité de visibilité tant continentale qu’internationale », Dieu-Donné Okalas Ossami, E-Tumba, startup lauréate de la première édition du Challenge.

Quels critères de sélection ?
Pour la seconde édition de Digital Africa, les startups sont invitées à proposer des projets innovants en rapport avec les thématiques suivantes:
•Territoires (défi urbain, transformation rurale, smartcity,…)
•Citoyennetés (e-gouvernement, engagement, activisme, nouveaux médias,…)
•Savoirs et Créativité (éducation, formation, industries créatives et culturelles,…)
•Environnement et Climat (greentech, cleantech, transports durables, économie bleue, énergies ;…)
La pertinence des solutions imaginées, leur faisabilité, leur durabilité et leurs impacts potentiels en termes de développement seront au cœur du processus de sélection, qui se déroulera en plusieurs étapes:
•Une analyse approfondie des projets, de leur caractère innovant, de leur modèle économique ;
•Une revue par les experts de l’AFD, de Bpifrance et de La French Tech des projets pré-qualifiés ;
•Une sélection finale par le jury composé d’experts de l’écosystème tech-entrepreneurial en Afrique.
A propos de l’AFD
L’Agence Française de Développement est un établissement public au cœur du dispositif français de coopération qui agit depuis soixante-quinze ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable.
Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD exerce la mission que lui a confiée le gouvernement français en finançant des projets et programmes de développement dont la finalité est de contribuer à une croissance économique plus durable et partagée, améliorer les conditions de vie des populations, participer à la préservation de la planète et aider à stabiliser les pays fragiles ou en sortie de crise.
Pour prendre en compte les nouveaux enjeux du numérique pour le développement, dans ses opportunités comme dans ses défis, l’AFD s’est donné comme objectif prioritaire d’accompagner la transformation des économies africaines et la promotion du développement humain par la dynamisation de l’innovation numérique.
Suivez-nous sur Twitter : @AFD_France - @AFD-en
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
A propos de la French Tech
La French Tech est le nom de la communauté des startups françaises, incarné par une marque collective. C’est aussi une Initiative publique innovante au service de ce collectif. La mission French Tech est l’équipe qui pilote et coordonne au sein du Ministère de l’Économie le déploiement des actions de l’initiative French Tech lancée en novembre 2013 par le gouvernement et structurée autour de 3 axes : fédérer l’écosystème de startups français, accélérer la croissance des startups et faire rayonner la French Tech à l’international. Les partenaires fondateurs de l’Initiative sont : Direction Générale des Entreprises, Direction Générale du Trésor, Ministère des affaires étrangères, Caisse des dépôts, Bpifrance, Business France, Commissariat Général à l’Investissement.
Plus d’information sur : www.lafrenchtech.com
Twitter : @lafrenchtech – Facebook : @happyfrenchtech