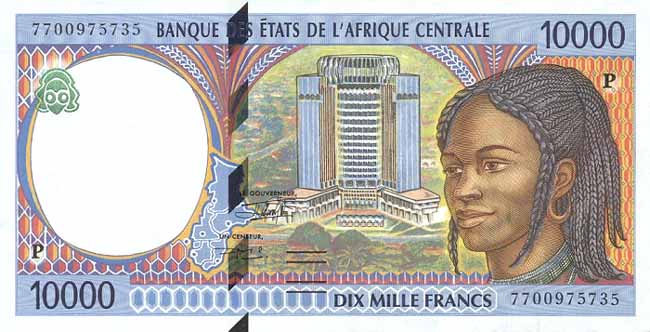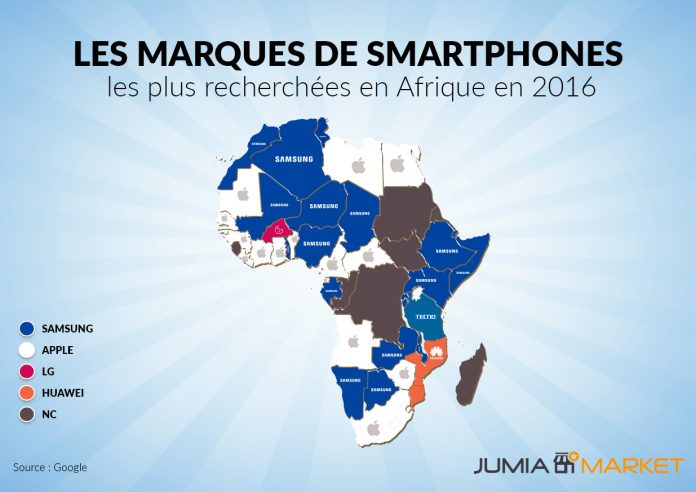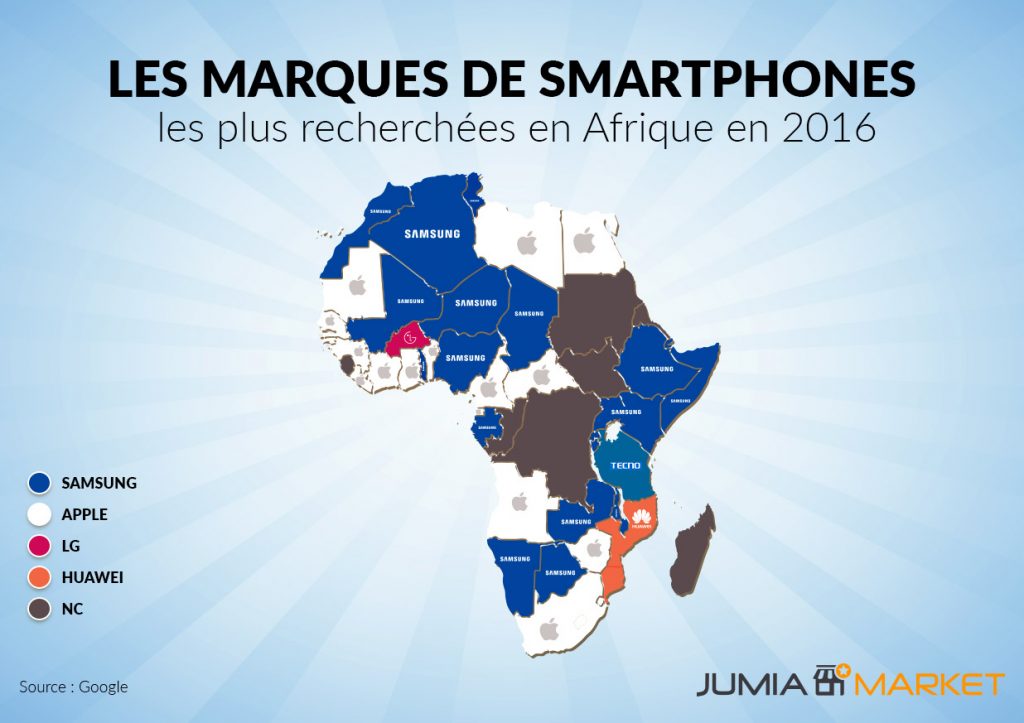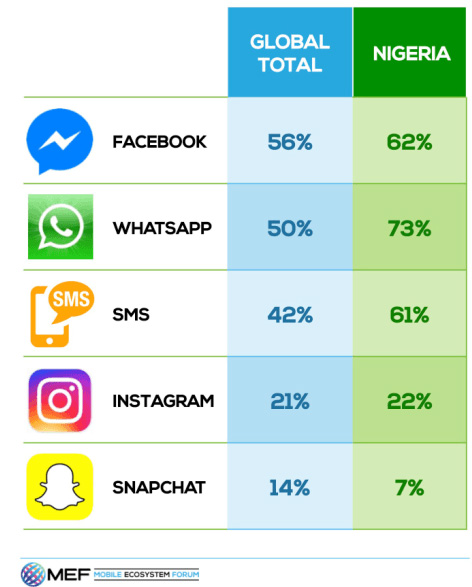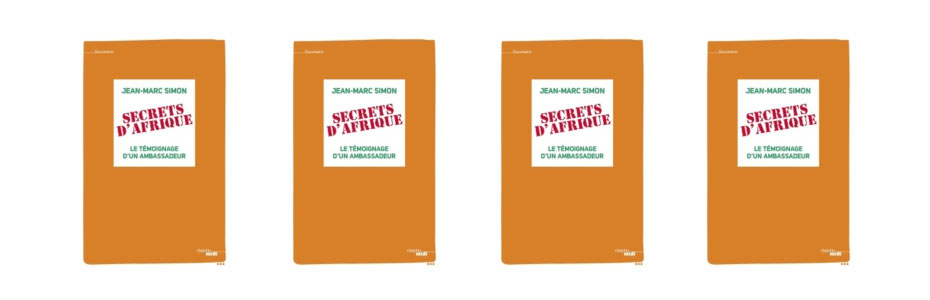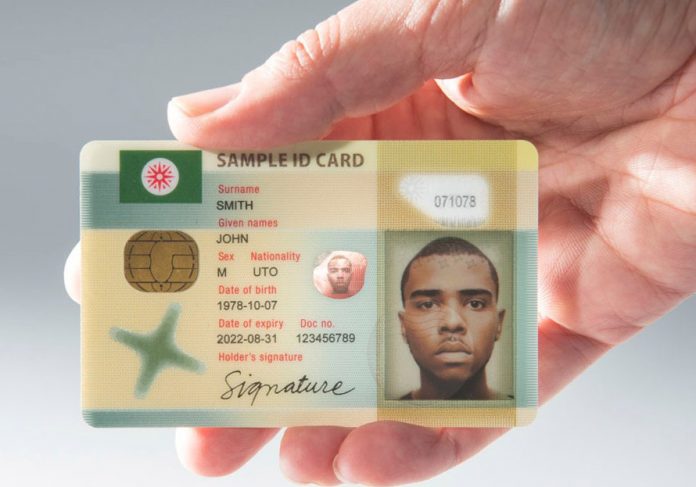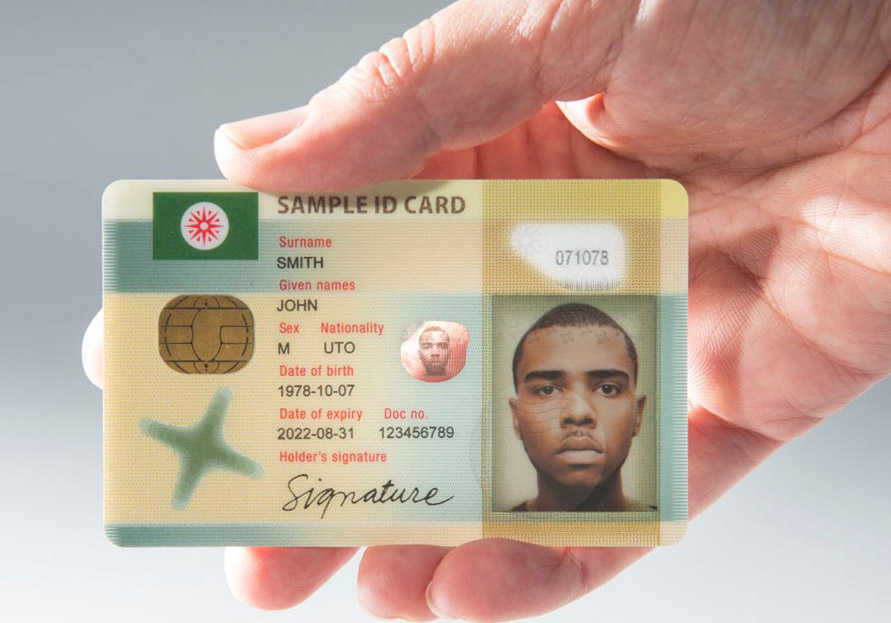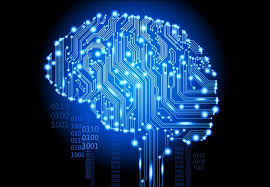Disposant de toutes les autorisations pour se lancer dans la banque, Orange se prépare à attaquer le marché dès le premier semestre 2017
Orange va s’inspirer aussi de l’Afrique et d’Orange Money
Orange ne veut pas seulement se lancer dans la banque. Le groupe veut compter parmi les leaders. Ses ambitions sont spectaculaires: selon les syndicats, Orange Bank vise 400.000 clients dès la première année, et 2 millions d’ici à 2024. C’est par exemple deux fois plus que les leaders historiques comme ING Direct ou Boursorama, la filiale de la Société Générale qui vient tout juste de franchir le cap des 900.000 clients.
Pour atteindre ses ambitions, le groupe va frapper fort dès le départ, en proposant d’emblée la quasi-totalité des services offerts par n’importe quel réseau traditionnel: compte courant, épargne, assurance ou encore crédit à la consommation. Tout, excepté le crédit immobilier, qui sera lancé dans un deuxième temps mais qui est déjà au programme.
S’appuyer sur un réseau puissant
Côté distribution, sa force de frappe se résume en une phrase : les agences bancaires sont vides, les boutiques Orange, elles, sont pleines.
L’offre sera accessible sur internet et via une application mobile mais c’est surtout sur ce réseau que le groupe compte s’appuyer. L’offre sera d’abord distribuée dans 140 boutiques, qui ont déjà été sélectionnées sur les 850 que compte le réseau. « Ce sont les plus grosses, celles dans lesquelles il est possible d’aménager un espace de confidentialité ».
Dès le deuxième semestre 2017, l’offre sera également distribuée par les réseaux Groupama et Gan. Ce qui représente 3.000 points de vente supplémentaires.
700 commerciaux bientôt à l’oeuvre
Dans les boutiques, les appels à candidature ont déjà été lancés. 700 commerciaux triés sur le volet vont être formés sur 80 heures, le minimum réglementaire pour être habilités à vendre des produits bancaires. Orange recherche « les plus expérimentés » précise un document interne.
« Nous n’allons pas transformer nos agences en banques ou nos commerciaux en conseillers bancaires » explique-t-on au sein du groupe. « Ils seront en quelque sorte des apporteurs d’affaires » ajoute un responsable syndical qui décrit le futur scénario: l’idée, c’est qu’à chaque fois qu’un client entre dans la boutique pour souscrire un forfait, le conseiller lui propose l’ouverture d’un compte, avec à la clé des réductions ».
La Pologne comme modèle
Un scénario confirmé à demi-mot par le groupe. « Nous allons nous inspirer de ce que nous faisons en Pologne ». Là-bas en effet, Orange s’est déjà lancé dans la banque, en octobre 2014. Il s’est adossé à mBank, une banque allemande pour proposer le même type d’offre qu’en France.
En Pologne toujours, Orange est aussi présent dans la téléphonie et dans l’électricité, via sa filiale Orange Energia. Le principe? Plus vous consommez de services Orange, moins votre électricité vous coûte. Une stratégie qui visiblement fonctionne, puisque la filiale bancaire compte 300.000 clients. « Orange pourrait bien être le premier acteur non bancaire à vraiment bousculer le marché » explique un expert.
Tous les ingrédients sont en effet réunis: une offre simple et lisible adossée à la puissance d’un réseau physique, avec à la clé des tarifs attractifs. Tout cela dans un contexte particulièrement porteur.
Un planning idéal ?
Le planning n’a pas été choisi au hasard. À partir de février 2017, date officielle du lancement d’Orange Bank, la loi Macron permettra aux Français de changer de banque plus facilement: toutes les procédures seront automatisées et prises en charge par la banque. « C’est vrai que cela pourrait convaincre certains clients de franchir le pas » explique le patron d’une grande banque en ligne. « Rien ne dit en revanche que les clients auront suffisamment confiance pour confier leur argent à un opérateur téléphonique » ajoute cette même source.
Les études prouvent pourtant que l’état d’esprit est en train de changer. Selon un récent sondage publié par Deloitte, 38% des Français sont prêts aujourd’hui à ouvrir un compte ailleurs que dans une banque traditionnelle. Toutes les conditions semblent donc bel et bien réunies pour qu’Orange bouscule le secteur et devienne, comme le veut Stéphane Richard, « le Free de la banque ».