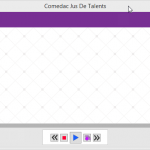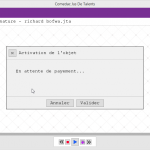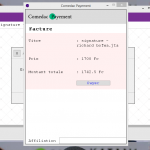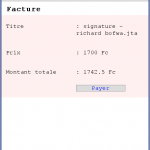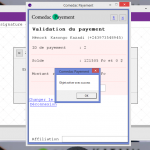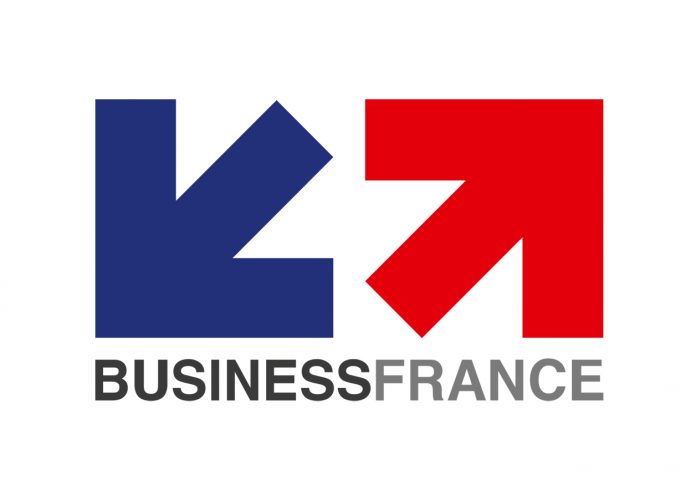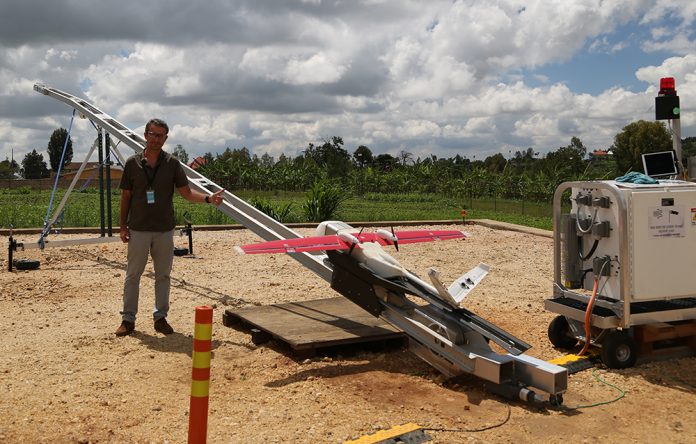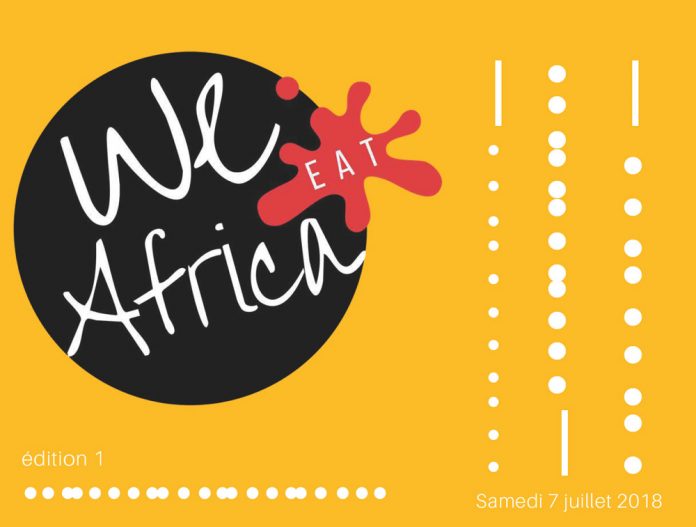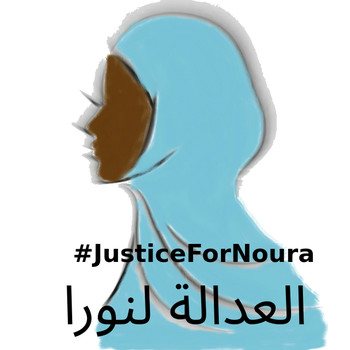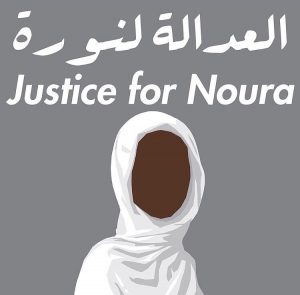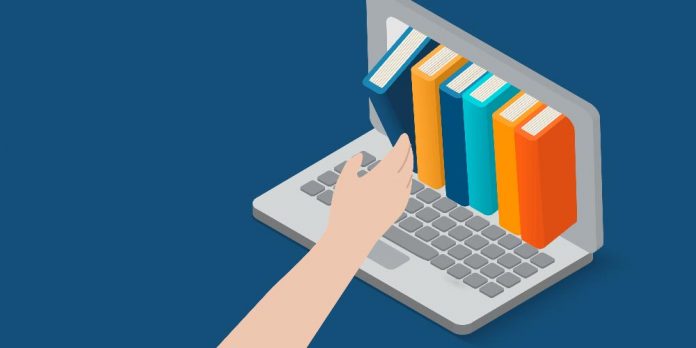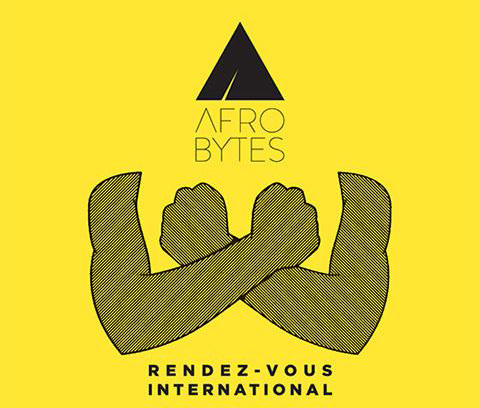- Le Rwanda est en passe de devenir l’une des premières destinations du tourisme d’affaires en Afrique.
- Grâce à un projet de conseil du Groupe de la Banque mondiale, le nouveau Bureau des congrès aide les autorités à mieux identifier les opportunités dans le secteur des réunions, congrès, conventions et voyages de gratification et les opérateurs privés à profiter de ces nouveaux débouchés.
- Entre 2014, date de la création de ce dispositif, et 2016, le nombre de participants aux conférences a pratiquement doublé, de 17 950 personnes à 35 100, tandis que les recettes liées au tourisme d’affaires sont passées de 29,6 millions à 47 millions de dollars.
Le Rwanda s’impose aujourd’hui comme l’une des premières destinations du tourisme d’affaires en Afrique de l’Est, grâce aux efforts du gouvernement rwandais, appuyé par ses partenaires de développement, pour renforcer et développer la place du secteur privé dans ce secteur
Le pôle mondial d’expertise en Commerce et compétitivité du Groupe de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (IFC) a lancé en 2012 le Projet de soutien de la compétitivité et de la gouvernance (G4C), qui a débouché sur la création du Bureau des congrès du Rwanda, en 2014. Le Groupe de la Banque mondiale, qui a apporté 1,2 million de dollars d’assistance technique au département Tourisme et conservation du Rwanda, et les autorités rwandaises se sont appuyés sur ce nouvel instrument pour promouvoir le pays comme destination privilégiée des réunions d’affaires auprès de clients régionaux et internationaux.
Depuis, ce segment dynamique du tourisme, mieux connu par les professionnels sous son acronyme en anglais « MICE » pour meetings, incentives, conferences, and events, connaît un essor considérable. En 2016, le Rwanda a accueilli plus de 40 conférences internationales, le Bureau des congrès organisant directement plusieurs manifestations de haut niveau : Forum économique mondial, Sommet mondial sur l’investissement en Afrique, Sommet de l’Union africaine et Forum africain de l’investissement hôtelier. Il est également intervenu lors de manifestations de l’AFREXIMBANK et de l’Académie mondiale des sciences, ainsi que pour la convention continentale annuelle de Coca Cola.
Cette recrudescence de réunions, de conventions et de manifestations depuis la création du Bureau des congrès a induit une hausse des recettes, qui ont dépassé 37 millions de dollars en 2015 et atteint 47 millions de dollars en 2016. En 2017, le tourisme d’affaires dans le pays devrait rapporter 64 millions de dollars.
« Le travail du projet G4C avec le Bureau des congrès pour développer le tourisme d’affaires a eu d’immenses répercussions », se réjouit Jean-Louis Uwitonze, directeur général de l’unité d’exécution du projet au ministère du Commerce et de l’Industrie. « Après la clôture du projet, le Conseil de développement du Rwanda continuera de mobiliser ses propres ressources pour garantir la pérennité des réformes. »
Le Bureau des congrès stimule le développement du tourisme d’affaires
Devenu l’organisme central de coordination du secteur MICE à Kigali, le Bureau des congrès assure la liaison entre les demandes de tourisme d’affaires et les prestataires locaux afin de faire du Rwanda une destination fiable pour toutes les rencontres d’affaires, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales. Il contribue ce faisant à la réalisation de la stratégie à moyen terme du pays pour la réduction de la pauvreté et le développement économique ainsi qu’à la stratégie nationale de 2011 pour les exportations.
« Le Bureau des congrès sert désormais d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et le secteur privé pour développer l’industrie des réunions », souligne Chris Munyao, directeur général de Primate Safari, un tour-opérateur local.
Selon Patience Mutesi, directrice-pays de Trademark East Africa, « ces projets sont vitaux pour ouvrir l’économie rwandaise et réaliser les objectifs de transformation ». Mais, rappelle-t-elle, « toute la difficulté consiste maintenant à s’assurer que la demande est suffisante pour assurer la rentabilité des investissements structurels. »
Le Rwanda, l’un des premiers pays d’Afrique de l’Est à s’être doté d’un Bureau des congrès, s’est rapidement imposé comme un leader du marché. Il se hisse ainsi au troisième rang du classement 2016 de l’Association internationale des congrés et conférences pour le tourisme d’affaires en Afrique, derrière l’Afrique du Sud et le Maroc. En 2015, le Rwanda ressortait au septième rang pour les 39 pays d’Afrique classés tandis que Kigali obtenait la cinquième place parmi les premières villes du continent accueillant des réunions d’affaires et autres manifestations de ce type.
Donner au secteur privé les moyens de se développer
Avant la création du Bureau des congrès, les réservations se faisaient directement auprès du gouvernement, explique Chris Munyao. Désormais, c’est le Bureau qui identifie les opportunités, fait venir les organisateurs dans le pays et sollicite les entreprises privées du Rwanda pour répondre aux appels d’offres.
« C’est le principal intérêt du Bureau des congrès », souligne-t-il. « Il permet aux entreprises privées de se positionner sur le marché du tourisme d’affaires. »
Soucieux de perpétuer cette stratégie de développement de l’industrie des réunions, le Rwanda a également investi dans la construction d’un nouveau centre des congrès, à Kigali, à proximité des grands hôtels, afin de multiplier les espaces de réunion. Fin 2016, Kigali pouvait proposer 3 400 chambres d’hôtel moyen et haut de gamme pour les délégations.
« À part le Rwanda et l’Afrique du Sud, rares sont les pays d’Afrique à faire appel à un bureau des congrès pour mettre directement en contact les entreprises et les opérateurs privés », déclare Adja Mansora Dahourou, chef d’équipe du projet au Groupe la Banque mondiale et spécialiste senior du secteur privé. « Le Bureau a également mis sur pied une équipe de recherche pour constituer une base de données et estimer la durée de séjour des délégations, les sommes dépensées et l’impact préalable et postérieur à cette initiative sur toute la filière, afin de mieux cibler les efforts à l’avenir. »
Le projet bénéficie également à l’Association des professionnels de congrès du Rwanda (RAPCO), qui met en place un système d’accréditation pour les professionnels du secteur. Elle a vocation à développer les capacités des opérateurs privés du Rwanda à répondre aux appels d’offres et à remplacer progressivement l’État pour assumer la responsabilité totale de cette filière.