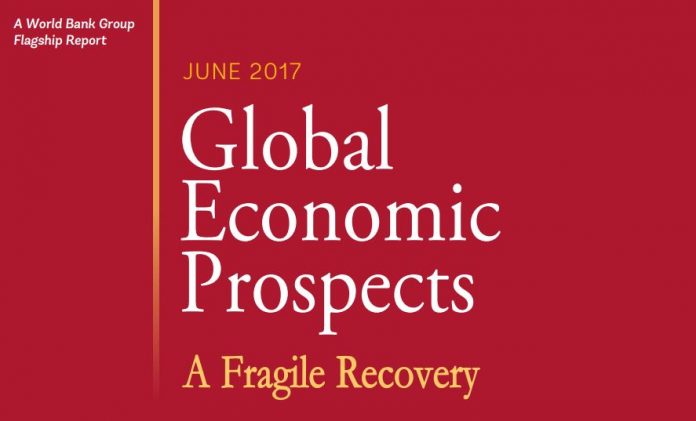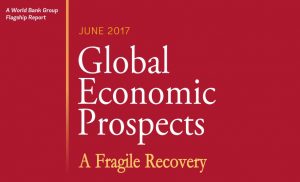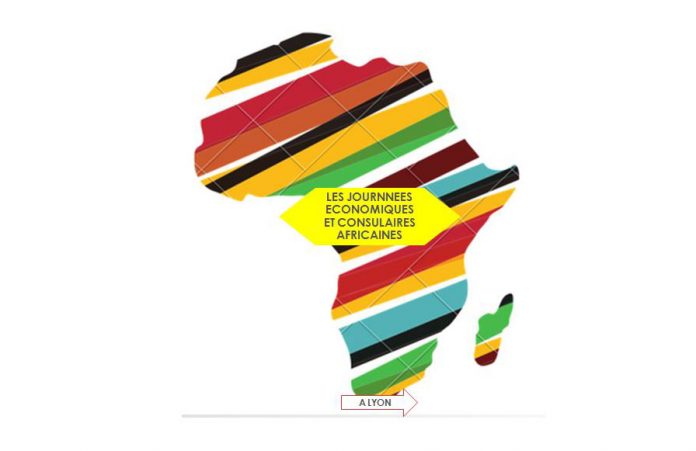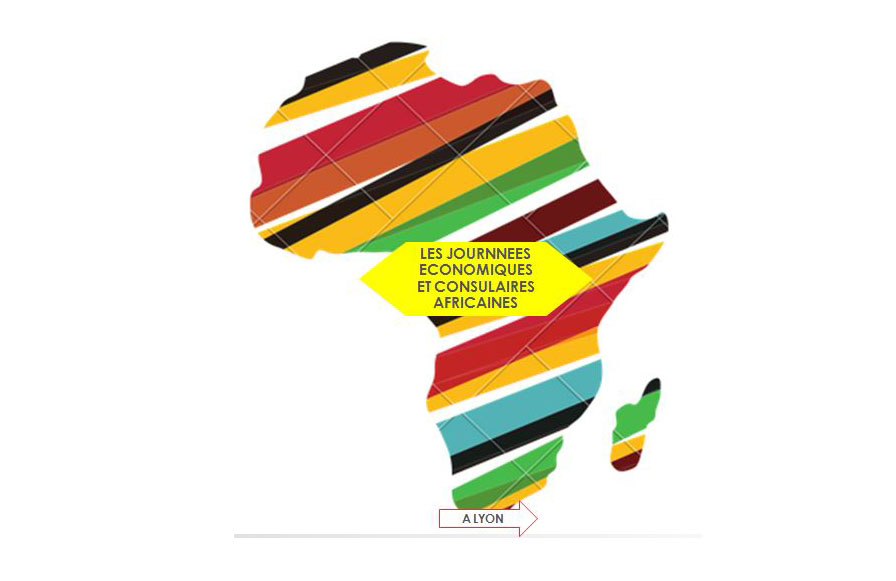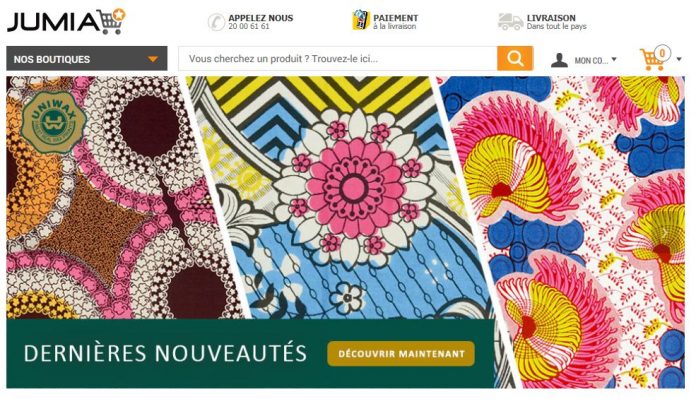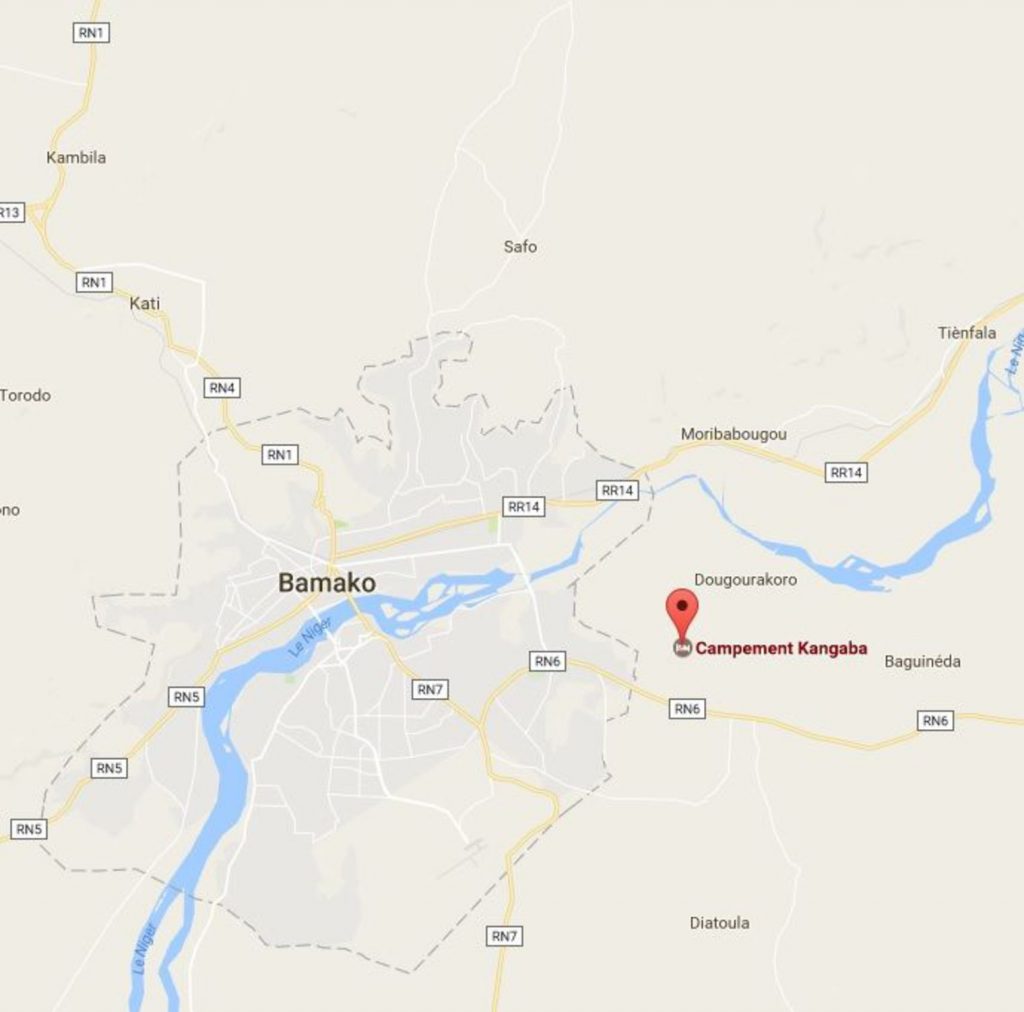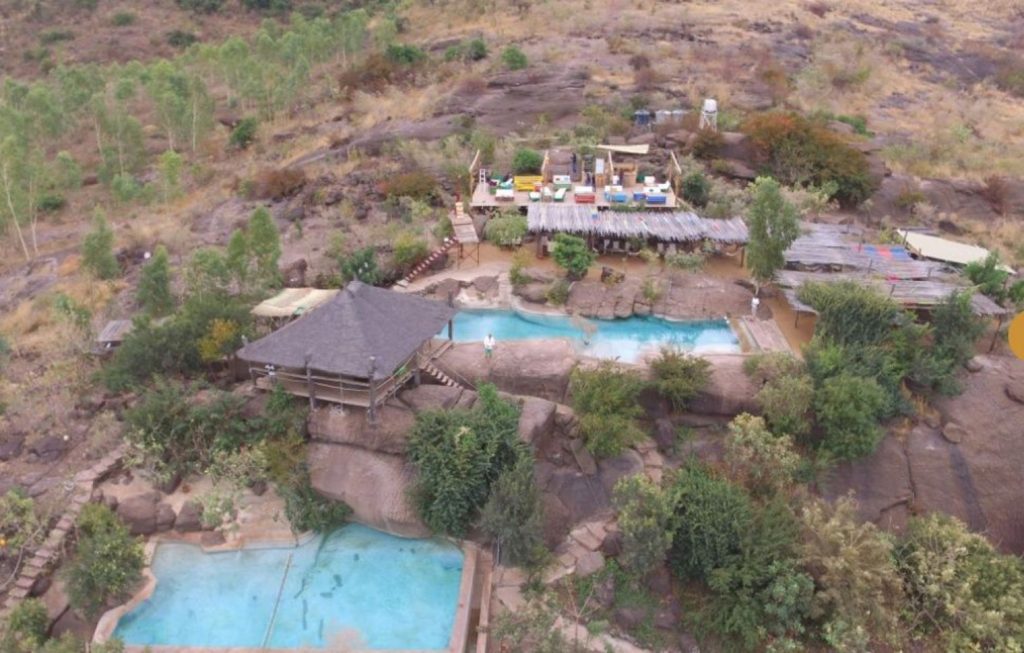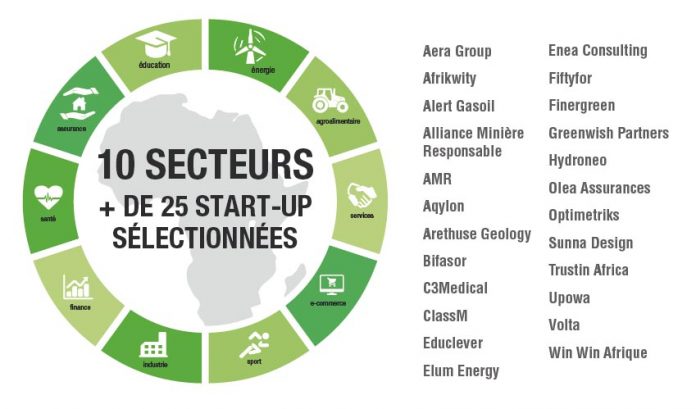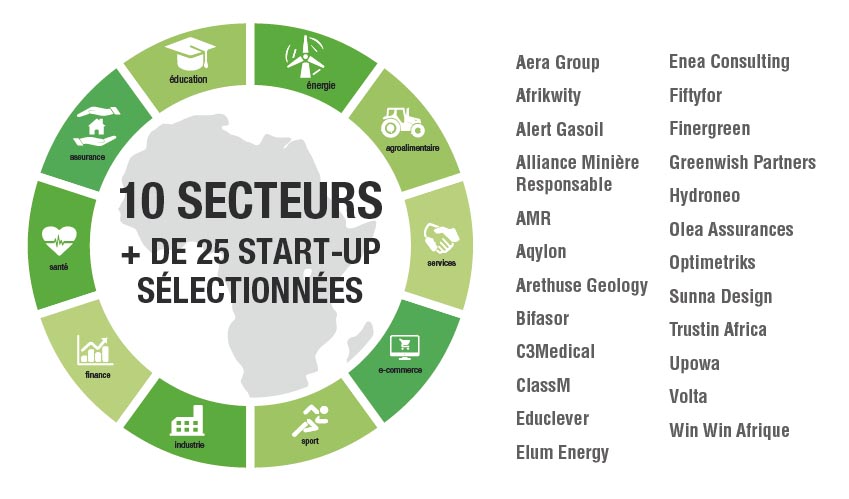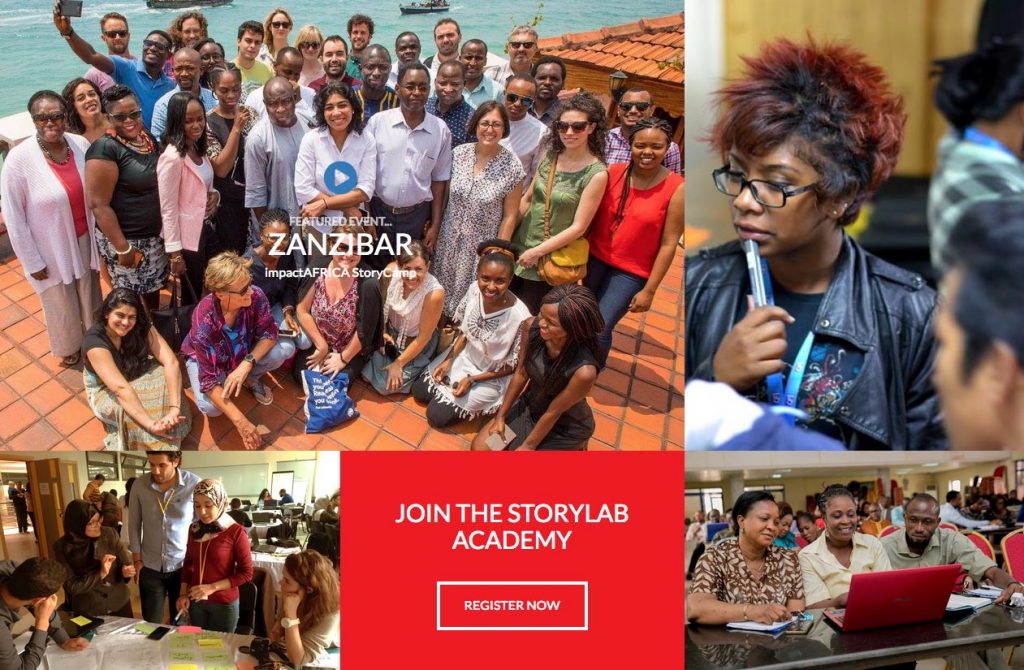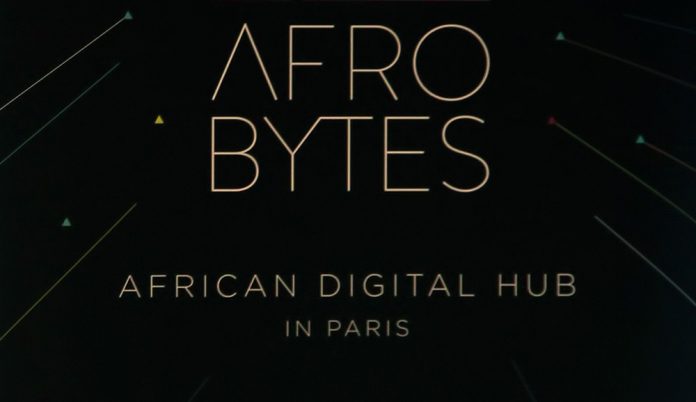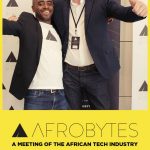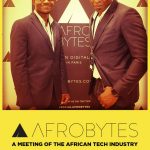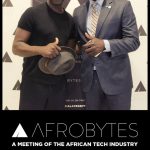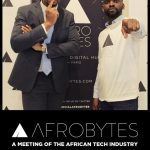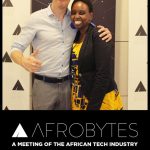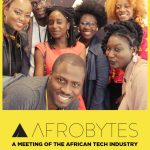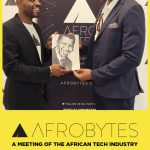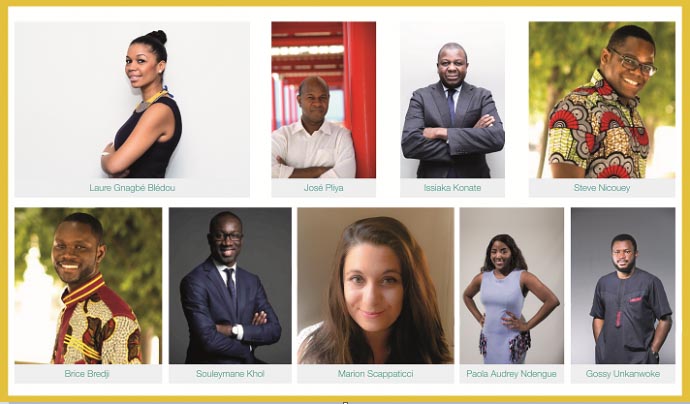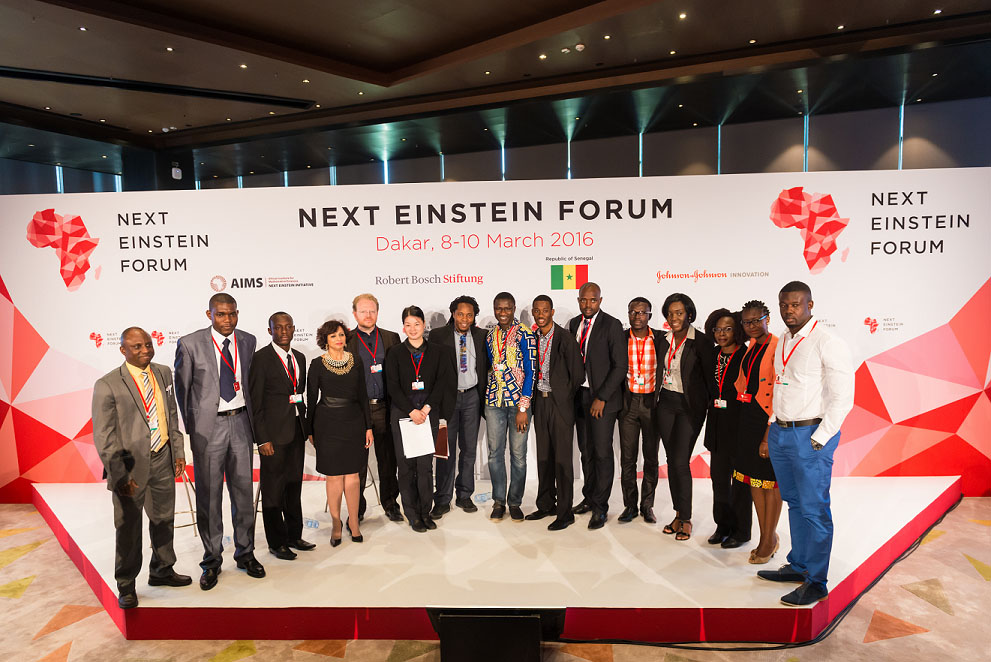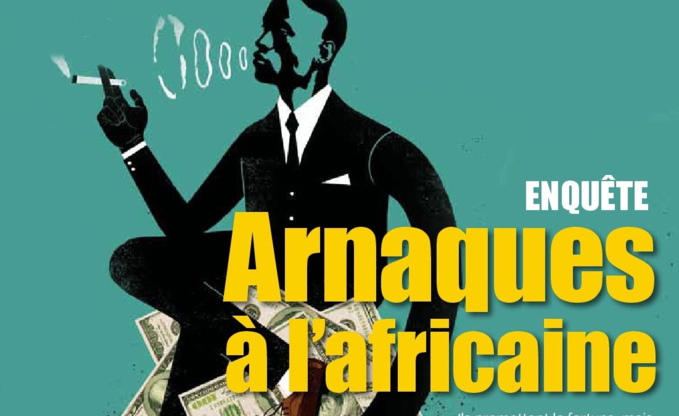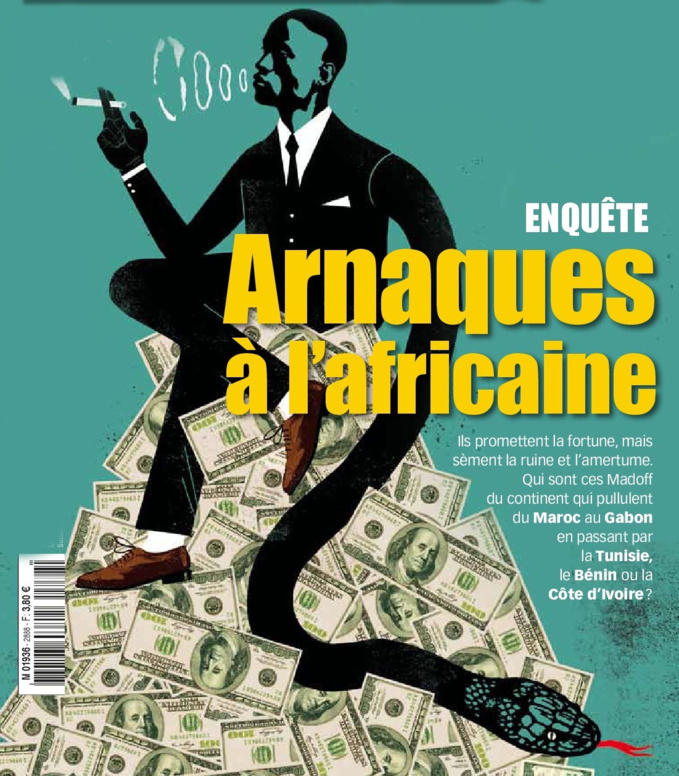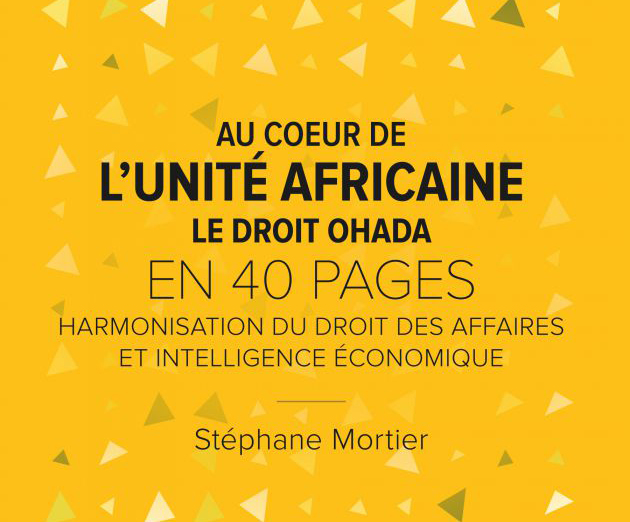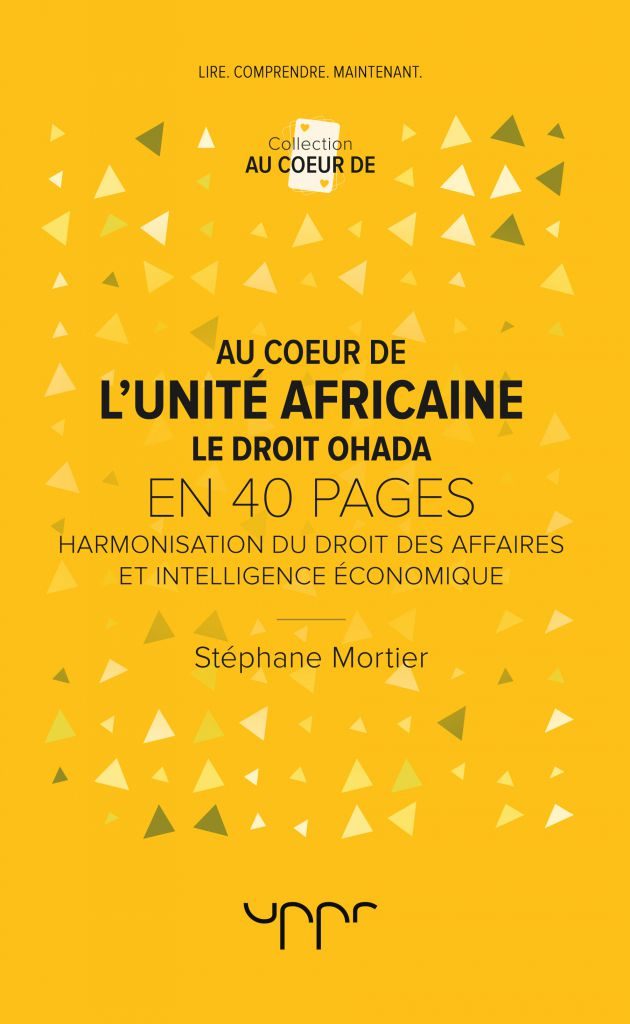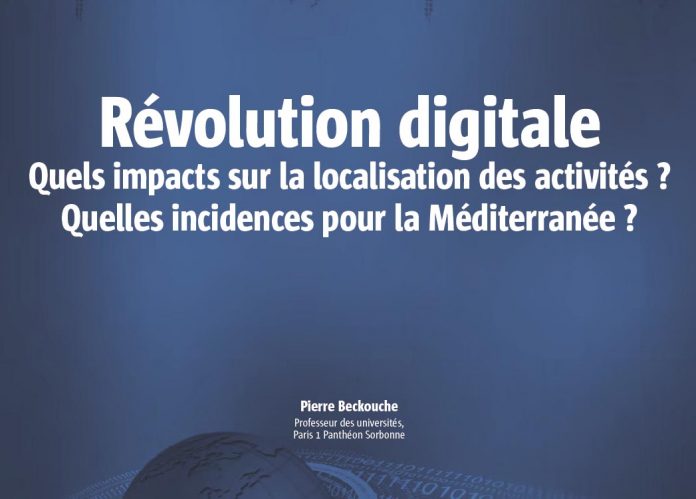Les Services de Conseil Agricole et Rural (SCA) sont un ensemble de dispositifs qui ont pour but de mettre à la disposition des différents acteurs en milieu rural, notamment les paysans démunis, des informations à jour sur l’optimisation de la production, transformation ou distribution de leurs produits en vue d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.
Sur le terrain, on note l’existence d’une distorsion entre les objectifs affichés, les moyens engagés et les résultats obtenus.
Quel problème et que faut-il faire ?
Des intérêts divergents
Le premier problème est celui du foisonnement des acteurs disposant d’intérêts divergents qui proposent aux paysans une diversité de conseils contradictoires. Au niveau gouvernemental, les activités du Programme National de Recherche et de Vulgarisation Agricole évoluait vers une approche centrée sur le développement des filières et des chaines de valeur tandis que celles des partenaires internationaux évoluaient plutôt vers une approche différente centrée sur le développement des spéculations subventionnées par les bailleurs de fonds et/ou pays d’origine (notamment en semences) et ce, en décalage avec les habitudes alimentaires et/culturales locales. On impose aux paysans ce qu’il faut cultiver. C’est le cas des cultures CGM (Coton Génétiquement Modifié) non-reproductibles qui est en décalage avec les habitudes de greniers communautaires des paysans dans les régions septentrionales du Cameroun. En conséquence, ces derniers sont confus devant la diversité des solutions proposées et développent des velléités de résistance au conseil agricole à travers la multiplication des partages officieux d’expériences alternatives. Malheureusement, ces expériences officieuses sont scientifiquement contre-nature avec le protocole d’origine et sont sources de résultats contreproductifs comme la sous-production (appauvrissement continu). Un CGM adéquat pour eux serait conforme à leur besoin d’autonomisation (empowerment) et de libération de la dépendance extérieure à la semence, intenable puisque nécessitant un nouvel achat à chaque saison agricole.
Manque d’approche participative
Le deuxième problème est celui de l’insuffisance de l’approche participative et donc, de la concertation entre les différents acteurs de la production, transformation et distribution. Ce manque de participation conduit à la présentation des produits inadéquats avec les réalités paysannes. C’est le cas de l’usine à tracteurs d’Ebolowa lancée pendant le comice agropastoral en 2011 et abandonnée après l’événement. En effet, offrir un tracteur à un paysan en milieu rural est excellent mais, il faut tenir compte de 3 paramètres majeurs : d’abord, il doit savoir conduire, ce qui n’est pas acquis. Ensuite, il doit pouvoir y mettre suffisamment de carburant, ce qui nécessite un budget supplémentaire. Enfin, il doit pouvoir réparer en cas de pannes, ces machines étant mécaniques. La solution des tracteurs avait été pensée en marge de ces paramètres opérationnels. Par conséquent, la quasi-totalité des 1000 tracteurs à moteur montés en 2011 est aujourd’hui garée et envahie par la broussaille en raison de leur non-fonctionnalité. Cet investissement lourd n’a pas permis d’ajouter une seule tonne supplémentaire à la production nationale. Quel gâchis ! En effet, même la meilleure des technologies serait aussi mal introduite en milieu rural qu’elle serait non-fonctionnelle (problème de méthode) ! Dans la logique d’autonomisation et d’apprentissage, il vaut mieux partir du connu vers l’inconnu. Il vaut mieux procéder par étapes. Il vaut mieux pratiquer la politique de ses moyens. Le gouvernement camerounais ne devait se lancer dans l’achat direct des tracteurs que s’il envisageait parallèlement d’assurer l’alphabétisation et la formation des agriculteurs à leur utilisation et surtout leur approvisionnement en carburant. Sinon, il aurait fallu dans un premier temps renforcer la traction animale déjà connue avant de passer à la mécanisation surtout que le coût d’un tracteur à moteur permet d’acheter un millier de mécanismes de traction animale et donc, d’élargir l’assiette des bénéficiaires et leurs capacités de production en temps réel. Il convient, dans un processus d’autonomisation, de stimuler le besoin de technologies en chaque producteur, quitte à lui de progresser librement vers les technologies de son choix en fonction de ses besoins et de ses moyens. Il est temps d’arrêter la propension à vouloir choisir à la place des paysans qui seraient, d’après les clichés, peu intelligents et incapables de discernement. L’on a longtemps pensé que le simple transfert des technologies en milieu rural sans mesures obligatoires d’accompagnement (incitations financières et non-financières, assistance technique) conduirait inexorablement au développement de l’agriculture et au relèvement substantiel du niveau de vie des paysans.

Des stratégies incomplètes
Troisièmement, les stratégies de recherche et de vulgarisation agricole n’ont pas toujours intégré d’autres composantes pertinentes du développement rural tels que l’accès au marché, la sécurité foncière, la gestion des ressources naturelles. Il existe un décalage entre une démarche standardisée au niveau central et un milieu récepteur marqué par une hétérogénéité à la fois socio-économique et naturelle. Si l’on ne s’intéresse qu’à l’accès au marché, on trouve inadéquat de promouvoir des filières non-demandées sur le marché local et régional. Par exemple, la SOTRAMAS à Sangmélima a englouti 2 milliards de FCFA dans la fabrication de l’amidon du manioc (une capacité de 16 tonnes par jour) moins demandé sur le marché local. Par conséquent, non seulement il n’existe pas suffisamment de matière première pour faire fonctionner l’usine mais, il n’existe surtout pas de marché local pour la rendre viable sans investissements supplémentaires.
Problème du financement
Le dernier problème est l’absence d’une stratégie nationale de financement de l’agriculture. L’Etat, qui ne dispose pas suffisamment des moyens financiers et techniques de coordination, a la propension à investir dans tous les secteurs à la fois. Pis, il ne consacre que 3,5% de son budget au développement rural, ce qui est insignifiant. Il est peut-être temps de spécialiser l’économie nationale en créant une locomotive nécessaire pour tirer les autres secteurs. Cela pourrait passer par l’augmentation substantielle du budget de l’agriculture.
En somme, nous disons que le caractère participatif du développement rural est important bien qu’il ne se décrète pas. Cela nécessite des incitations (financières ou non financières) et des compétences qui passent par une meilleure alphabétisation des paysans. Dans ces conditions, le SCA garantirait le partage et la diffusion de l’information pertinente entre parties prenantes.