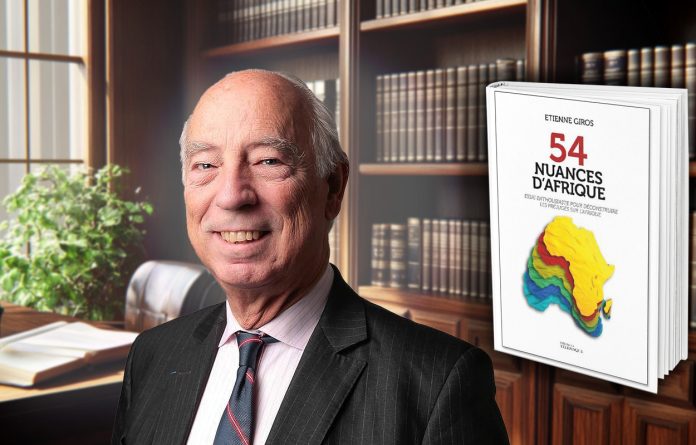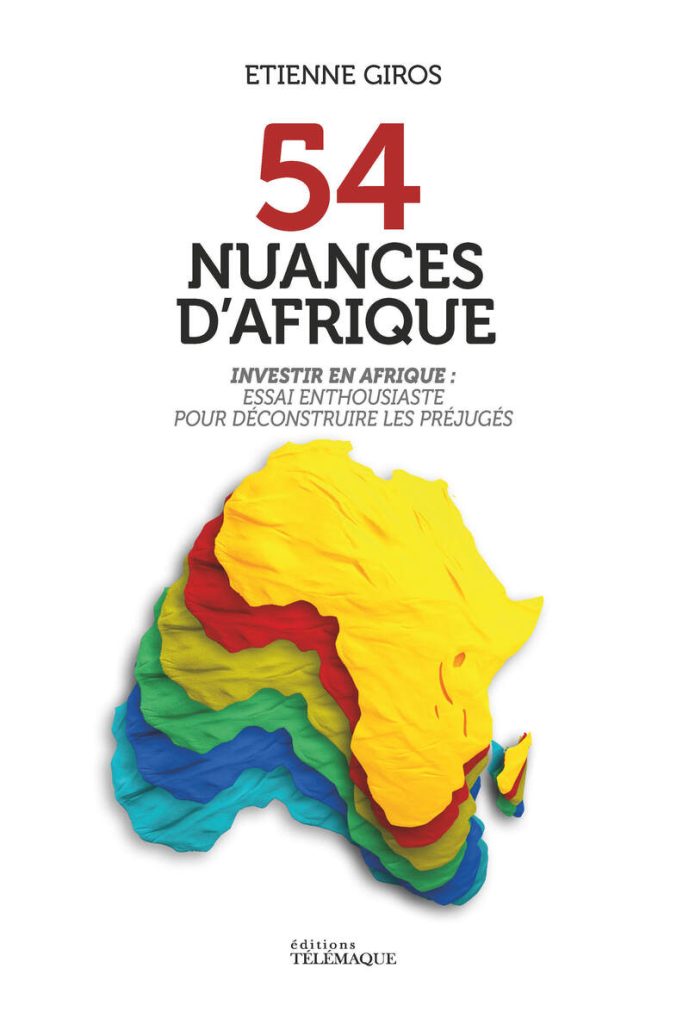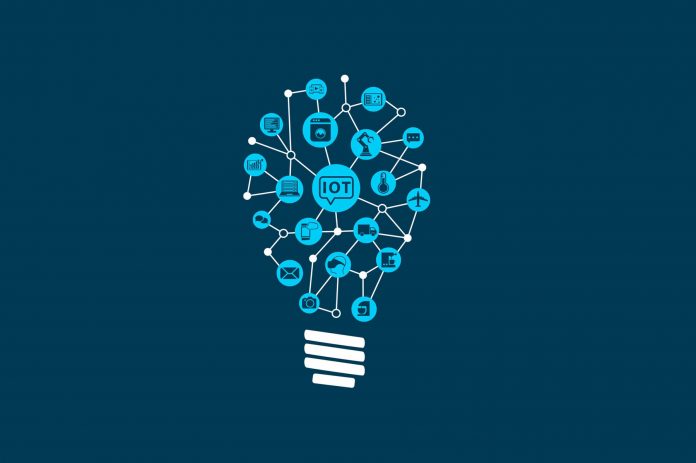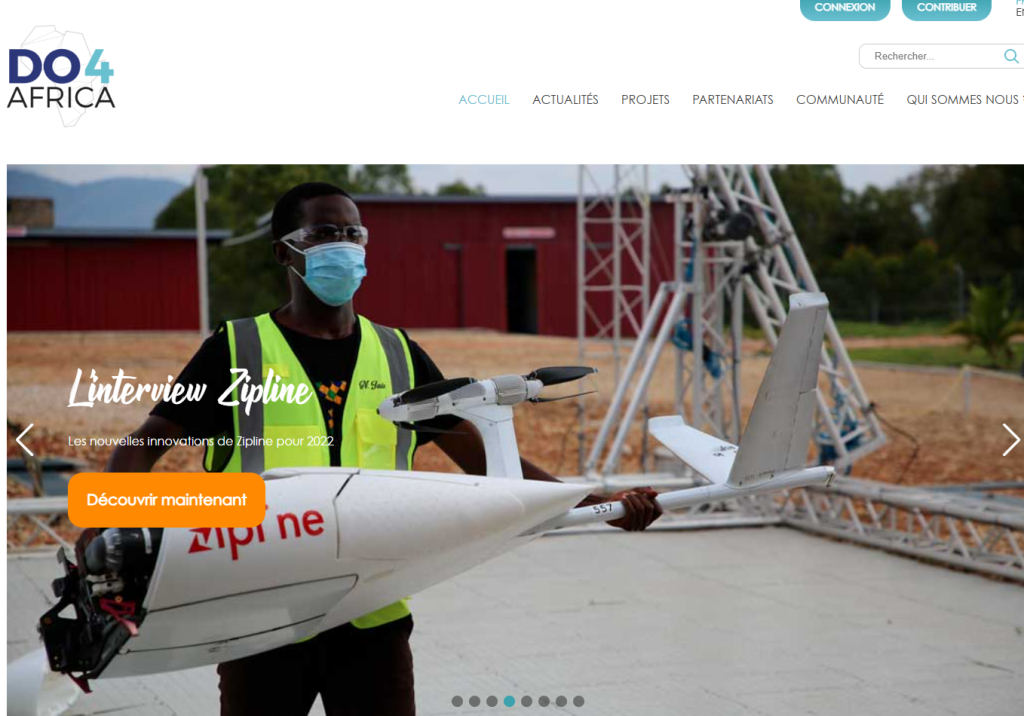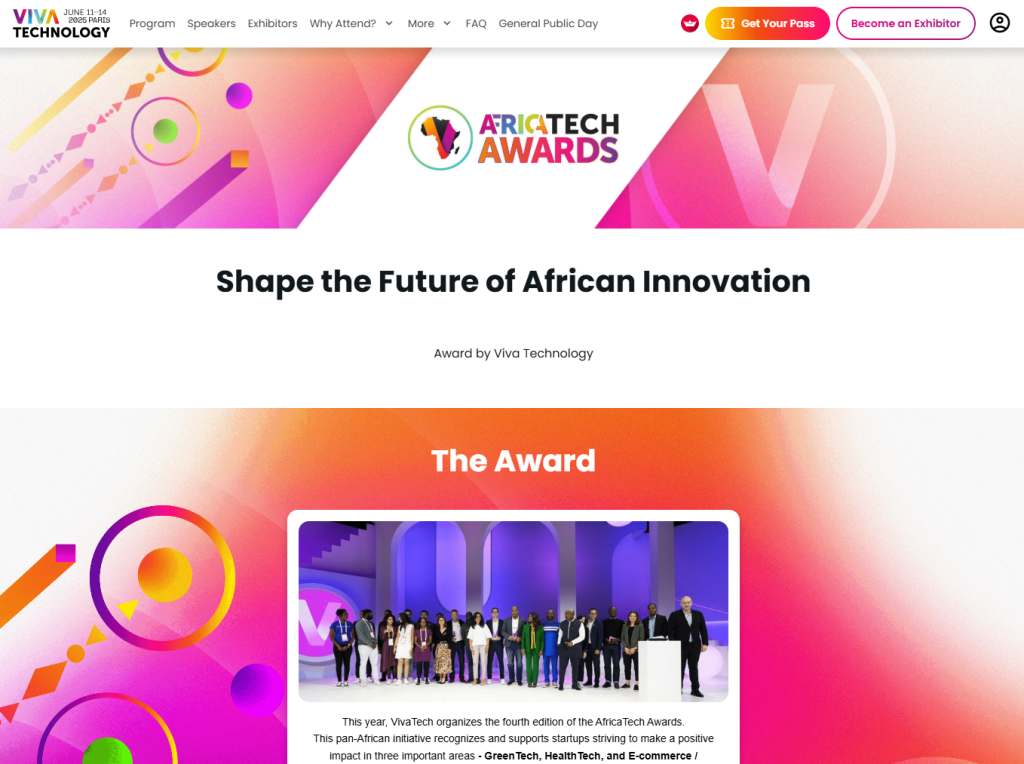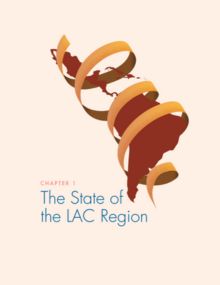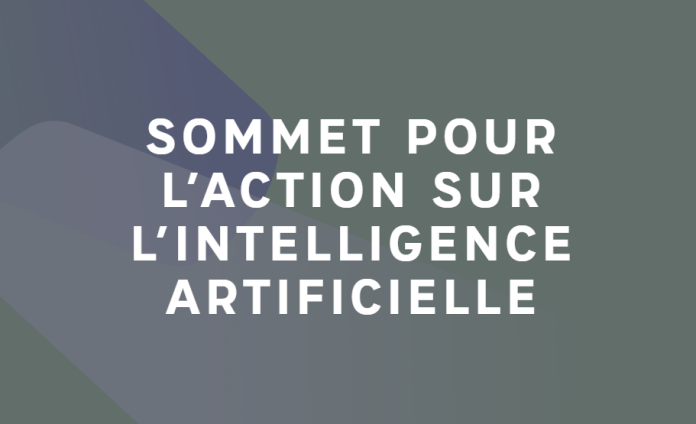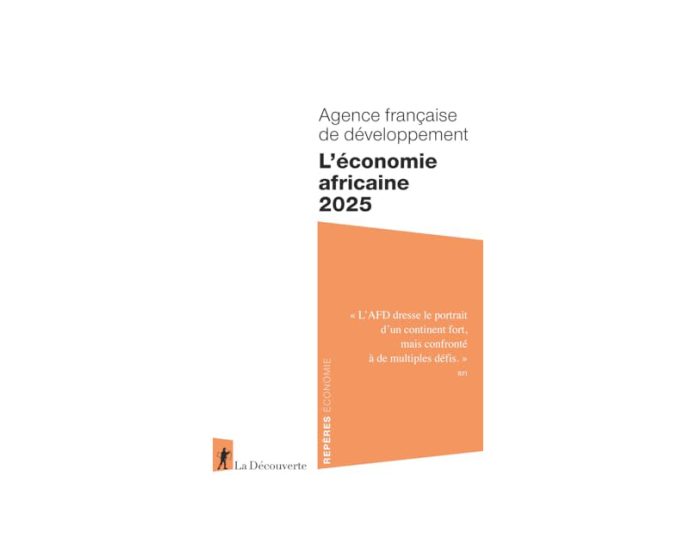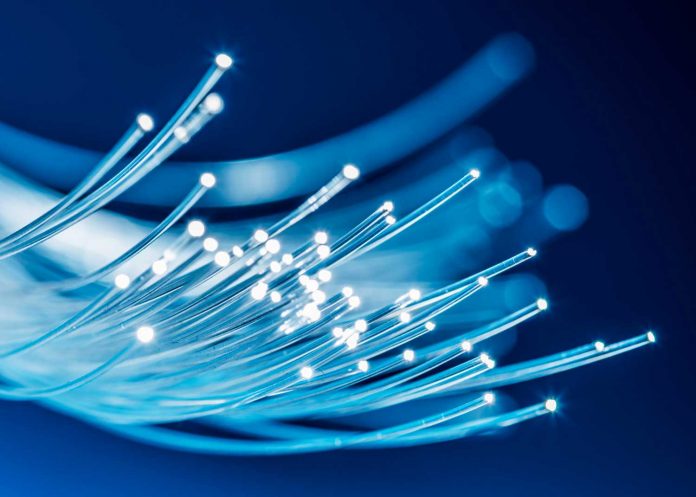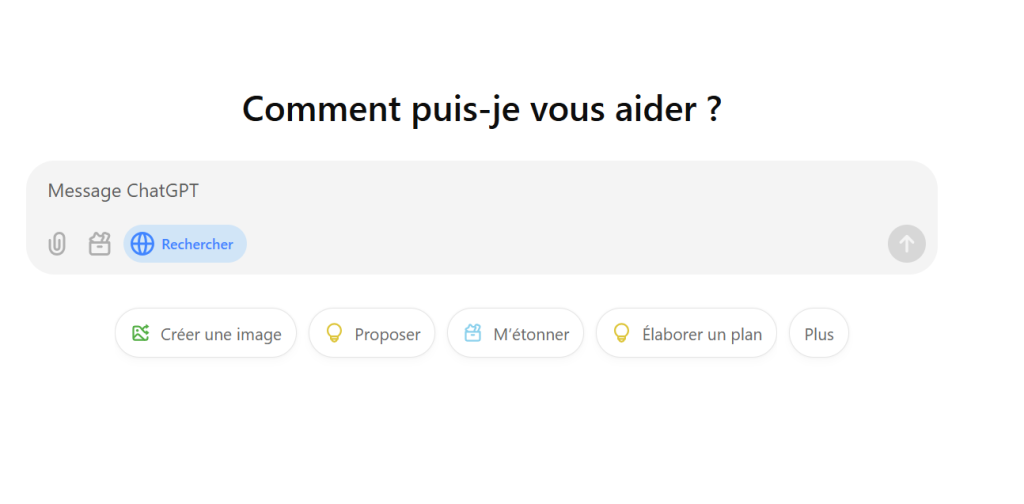Le contexte géopolitique, marqué par le retour de la guerre près de nos frontières et un durcissement des relations internationales, souligne l’importance de partenariats internationaux solides, qui répondent à nos valeurs et à nos intérêts, et contribuent à la stabilité de ce monde. Alors que de grands partenaires se désengagent, la France, avec ses alliés européens, continuera à porter une voix forte sur la scène internationale. Notre agenda est celui de la souveraineté, celle de notre pays et celle de nos partenaires.
La France réaffirme aujourd’hui résolument sa vision progressiste et humaniste, et son ambition de sortir des dépendances de l’aide au développement. Notre nouvel agenda de partenariats internationaux et d’investissement solidaire et durable vise à répondre aux attentes des Français et de nos partenaires, en faveur d’une prospérité mieux partagée et d’un monde plus sûr, plus résilient et mieux armé face au défi écologique, comme la représentation nationale l’avait déjà exprimé à l’unanimité en août 2021.
Nos partenariats internationaux reposent sur des politiques 1/ de solidarité, notamment face aux crises, 2/ d’investissement, face aux grands défis de notre planète et 3/ d’alliances, conjuguant nos intérêts diplomatiques et économiques et ceux de nos partenaires.
Cette politique puise dans l’ensemble des forces de la Nation, nos entreprises, nos collectivités territoriales et la société civile y compris la jeunesse et les diasporas. Elle rayonne depuis notre territoire, déjà riche de la présence de plusieurs organisations internationales et de centres de recherche d’excellence, que nous renforcerons en accueillant, avec nos voisins européens, tous ceux souhaitent investir leur talent dans le progrès permis par la science et nos valeurs humanistes.
Notre politique de partenariats internationaux s’inscrit dans un cadre européen ainsi que dans la démarche structurelle de réforme du système financier international portée par l’alliance des 72 pays qui ont aujourd’hui rejoint le Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P). Celui-ci affirme qu’aucun pays ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète et œuvre à des avancées concrètes pour mobiliser davantage de financements publics et privés face à nos défis communs.
Nos instruments doivent aujourd’hui mieux refléter la nature des partenariats que tisse la France avec ses alliés. Il s’agit notamment de valoriser l’offre française dans toutes ses dimensions – expertise publique et privée, savoir-faire, financements associés – pour répondre à la demande de nos partenaires, notamment en matière d’infrastructures critiques, tout en consolidant nos intérêts stratégiques.
L’impératif national de redressement de nos finances publiques nous rappelle aussi l’importance de recentrer nos efforts là où ces partenariats ont le plus d’impact et d’efficacité, de notre point de vue et de celui de nos alliés.
Nos actions, toujours ouvertes à l’innovation et à l’évaluation, doivent produire des résultats concrets et mesurables, et se concentrer sur les résultats, au‑delà des moyens. Notre politique doit être lisible et plus compréhensible pour tous nos concitoyens.
La refondation de cette politique a été initiée par le Conseil présidentiel du développement de mai 2023. Deux ans plus tard, et face à une nouvelle donne géopolitique, ce Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux a vocation à asseoir de manière durable ce changement de paradigme.
Il fixe les orientations stratégiques suivantes, qui ont fait l’objet d’une consultation de la société civile et des entreprises, et qui seront déclinées d’ici le mois de juin par le comité interministériel compétent, sous l’autorité du Premier ministre, en vue d’être appliquées par tous les opérateurs, instruments et instances dans lesquelles siège la France.
1 – La France affirme sa solidarité face aux crises et investit pour une transition juste
La France décline dans ses partenariats internationaux les objectifs conjoints de lutter contre les inégalités mondiales et l’extrême pauvreté, tout en investissant pour le climat et la biodiversité. La France réaffirme ici sa détermination à travailler avec ses partenaires pour préserver la planète dans le cadre d’une transition écologique juste.
Dans un contexte marqué par une multiplication inédite de crises, et par le retrait de grands partenaires, la France exprime sa solidarité auprès des pays et des populations les plus vulnérables, en concentrant efficacement nos efforts là où les besoins sont les plus importants et les plus urgents pour contribuer à la stabilité du monde :
Parmi l’ensemble des pays où la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète constituent des défis aigus, l’Etat s’engage désormais à consacrer au moins 60% de ses dons aux pays les plus vulnérables, dont les pays les moins avancés et ceux particulièrement vulnérables au changement climatique ou en situation de grande fragilité financière, en s’appuyant notamment sur l’indice de vulnérabilité multidimensionnelle de l’ONU (MVI).
La méthodologie sera régulièrement actualisée par le comité interministériel compétent, et nous la porterons à l’échelon international dans le cadre du 4P.
La France portant une attention particulière aux pays touchés par les crises et les conflits, notamment à travers son action humanitaire et de reconstruction, mais aussi son soutien à la stabilisation macrofinancière, rendra compte annuellement de son action spécifiquement dans les pays en crise et en conflit.
En raison du soutien massif dont elle a besoin et de la menace directe qui pèse sur l’Europe, la France réaffirme que l’Ukraine est considérée comme prioritaire.
Afin de défendre les attentes des Français, les partenariats internationaux de la France répondent à 10 objectifs politiques, définis en 2023 et dont ce Conseil réaffirme l’actualité et la pertinence, d’autant plus dans un contexte de recul marqué de l’engagement de plusieurs partenaires, sur le champ du climat ou des droits des femmes notamment :
1. Accélérer la sortie du charbon et financer les énergies renouvelables dans les pays en développement et émergents pour limiter le réchauffement climatique global à 1.5°C
2. Protéger les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité, dans les forêts et l’Océan, pour préserver la planète
3. Investir dans la jeunesse en soutenant l’éducation et la formation des professeurs dans les pays en développement
4. Renforcer la résilience face aux risques sanitaires, y compris les pandémies, en investissant dans les systèmes de santé primaire et en appuyant la formation des soignants dans les pays fragiles
5. Promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat africain qui participent au destin partagé entre les jeunesses d’Europe et d’Afrique
6. Mobiliser l’expertise et les financements privés et publics pour les infrastructures stratégiques, de qualité et durables dans les pays en développement
7. Renforcer la souveraineté alimentaire, notamment en Afrique
8. Soutenir partout les droits humains, la démocratie et lutter contre la désinformation
9. Promouvoir les droits des femmes et l’égalité femmes – hommes, notamment en soutenant les organisations féministes et les institutions de promotion des droits des femmes
10. Aider nos partenaires à lutter contre l’immigration irrégulière et les filières clandestines.
Ces 10 objectifs prioritaires, formant le cadre d’action et d’impact des partenariats internationaux de la France, doivent être déclinés par l’ensemble de nos instruments :
En 2025, toutes les ambassades dans les pays concernés par la politique de partenariats internationaux, établiront, en accord avec le gouvernement du pays, une stratégie-pays concentrée sur 3 priorités sélectionnées parmi les 10 objectifs, auxquelles pourra toujours être ajoutée la lutte contre l’immigration irrégulière et les filières clandestines.
Les ambassadeurs en pilotent le déploiement et sont les garants de la cohérence des moyens déployés au regard de l’ensemble de ces objectifs.
Ces objectifs devront s’appliquer à tous les opérateurs, instruments et financements de la France et orienteront les positions européennes et multilatérales de la France sur l’ensemble du champ des partenariats internationaux.
La France réévaluera ses engagements multilatéraux au regard de ces 10 objectifs prioritaires, et de son influence dans les instances de gouvernance, pour recentrer son action là où elle est la plus utile et renouveler son soutien aux organisations les plus efficaces au travers d’un financement le moins fléché possible.
Le suivi concret de l’atteinte de chacun des objectifs sera fondé sur un indicateur de résultat (et non de moyens) par objectif, couvrant l’ensemble de nos instruments y compris nos financements européens et multilatéraux et des projets emblématiques seront mis en valeur pour illustrer la mise en œuvre des 10 objectifs prioritaires.
2 – Nos partenariats stratégiques nous permettent de consolider nos alliances et nos intérêts.
La politique de partenariats internationaux de la France vise à conjuguer nos valeurs et nos intérêts avec ceux de nos alliés.
La France réaffirme l’importance particulière de certains partenariats :
La France reconnaît la valeur particulière de ses partenariats avec le continent africain, dans le cadre de l’agenda de transformation de nos relations, ainsi que dans l’Indopacifique, et l’enjeu stratégique que constitue la stabilisation du voisinage européen. Les opérateurs de l’Etat devront tenir compte de ces priorités pour ajuster leur maillage géographique, dans une logique d’optimisation de leurs moyens.
L’Etat et ses opérateurs soutiendront aussi en particulier les projets permettant de mieux intégrer nos départements et territoires d’outre-mer à leur environnement régional, en capitalisant sur leurs atouts.
Le déploiement de nos partenariats, notamment en matière d’infrastructure, concourt au programme européen Global Gateway, en ciblant les secteurs et les corridors les plus stratégiques pour les intérêts des Français.
Nos partenariats internationaux nous permettent de développer et sécuriser nos intérêts économiques et stratégiques à l’étranger. Cet axe prioritaire de notre action concerne tous les acteurs de cette politique, que ce soient les entreprises mais aussi la société civile, dont les organisations impliquées à l’international en appui de notre politique qui représentent aujourd’hui 50 000 emplois qualifiés et autant d’opportunités pour notre jeunesse. Les retombées concrètes se matérialisent pour les Français sous forme d’emploi créé mais aussi d’expertise accumulée, d’exportations, de sécurisation de nos approvisionnements stratégiques.
C’est pourquoi cette action fera aussi l’objet d’un examen par le Conseil présidentiel pour le commerce extérieur (CPCE). Plus largement, ces alliances solides contribuent à notre sécurité collective, en vue d’un monde plus stable où les flux de population sont mieux maîtrisés.
La France intervient en réponse aux demandes de ses partenaires en mobilisant tout l’éventail de l’offre française, de financements et d’expertise publique et privée.
Nos instruments de soutien se concentreront sur les secteurs économiques dans lesquels l’offre française est présente et compétitive, dont les sept filières stratégiques identifiées en 2023 (santé, agriculture, transports, numérique, transition énergétique, ville durable et industries culturelles et créatives) et des secteurs d’avenir (minerais critiques, intelligence artificielle, géospatial notamment), en cohérence avec notre politique économique et industrielle.
Un travail sera mené, notamment dans la perspective du CPCE, pour renforcer la mobilisation conjointe des outils de soutien aux entreprises (comme les prêts du Trésor et l’aide à l’export de Bpifrance) et des outils de financement du Groupe AFD, ciblant les acteurs économiques français (start-up, PME, ETI et grands groupes) susceptibles de se positionner sur des marchés à l’étranger financés par la France et par d’autres bailleurs de fonds. Business France, Bpifrance et les services de la DG Trésor renforceront leur collaboration avec le Groupe AFD pour diffuser aux entreprises françaises, le plus en amont possible, ces opportunités de marchés et les appuyer dans la préparation des réponses aux appels d’offres et la mobilisation de financements.
Seront également développés des instruments de garantie permettant de compléter l’offre de financement française.
Nous continuerons à rester vigilants sur la destination des financements français, y compris via les fonds européens ou multilatéraux, de sorte à ce que ceux-ci ne puissent contribuer à soutenir une offre constituant une concurrence allant à l’encontre de nos intérêts stratégiques ou une concurrence déloyale pour nos entreprises sur les marchés étrangers.
Notre objectif est de pouvoir mieux proposer des offres françaises liées, associant de manière intégrée nos financements, l’expertise de nos opérateurs ainsi que les produits et services de nos entreprises, en particulier dans le secteur des infrastructures durables et autres secteurs stratégiques. Business France facilitera la mise en relation des PME/ETI françaises avec des partenaires locaux (entreprises, institutions, ONG) pour former des consortiums répondant aux projets de l’AFD. La coopération technique internationale via Expertise France sera aussi mobilisée et consolidée dans cet objectif.
Prenant acte de la priorité que constitue pour nombre de nos partenaires l’accès à l’électricité, la France veillera à ce que l’ensemble de ses opérateurs de financement soient en mesure d’intervenir dans ce domaine, y compris lorsqu’il est envisagé de recourir au gaz comme énergie de transition s’inscrivant dans une trajectoire ambitieuse et compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. La France continuera à porter l’objectif d’un meilleur accès au financement pour les projets basés sur l’énergie nucléaire, notamment par les banques régionales ou multilatérales de développement.
3 – Nos partenariats internationaux seront plus lisibles et visibles, intéressant et associant toutes les forces de la Nation
Etant donné l’importance stratégique de nos partenariats internationaux, il est essentiel d’en rendre compte et de mobiliser l’ensemble de nos concitoyens autour de ses objectifs.
Notre politique doit encore gagner en lisibilité et en visibilité, tant auprès de nos concitoyens et de nos parlementaires en France qu’auprès de nos partenaires
Toute référence et dénomination officielle devra privilégier la notion de partenariats internationaux ou renvoyer à l’une de ses composantes (solidarité, investissements solidaires et durables, alliances) plutôt qu’à la terminologie de l’« aide publique au développement ».
En vue du prochain comité interministériel compétent, l’acronyme AFD devra faire l’objet d’une nouvelle explicitation permettant de mieux refléter le mandat de l’opérateur et les objectifs de notre politique de partenariats internationaux, notamment le renforcement de notre offre « France », et des ajustements pourront être faits sur la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration en conséquence.
Le comité interministériel compétent validera un cadre d’indicateurs et de redevabilité simplifié, reprenant l’ensemble des cibles et objectifs politiques définis par ce Conseil, afin que soit finalisé dans le mois qui suivra le contrat d’objectifs et de moyens de l’AFD.
Pour renforcer la visibilité de nos actions sur le terrain, l’ensemble des opérateurs de notre politique veillera à mettre en œuvre à partir d’aujourd’hui la « signature visuelle unique » (logo France) adoptée par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères pour valoriser les projets financés par les Françaises et les Français.
La Commission d’évaluation créée par la loi du 4 août 2021 et qui débutera ses travaux avant l’été, devra apporter un regard objectif sur nos pratiques et nos résultats.
Pour encourager l’innovation au sein de nos partenariats, le Fonds d’Innovation pour le Développement continuera à identifier les solutions les plus efficaces.
Les travaux engagés à l’OCDE seront poursuivis pour renouveler les métriques permettant de suivre l’investissement réellement consenti par une nation dans la solidarité internationale et l’investissement pour les biens publics mondiaux.
Notre politique va également gagner encore en efficacité, pour que chaque euro investi produise un véritable retour sur investissement. A ce titre :
Au niveau national, il conviendra de renforcer l’alignement de nos instruments (experts techniques internationaux, fonds Equipe France, action du groupe AFD) sur les priorités énoncées par ce Conseil – imposant notamment des mesures de rationalisation et de synergies au sein du groupe AFD.
Priorité sera mise sur l’effet de levier sur nos financements, auprès des acteurs publics (européens et multilatéraux) comme privés. Un suivi étroit sera réalisé pour démultiplier l’impact de chaque euro d’argent public investi.
La France portera activement au niveau international la rationalisation des instruments multilatéraux chargés du développement international: agences des Nations Unies, fonds verticaux, contribution de l’Union européenne à ces structures parallèles à celle des Etats-membres, en recherchant, pour nous, la meilleure articulation entre nos contributions internationales et notre action bilatérale.
La pleine appropriation de notre politique suppose aussi d’associer l’ensemble de la Nation à son élaboration et à son suivi.
Les ministres et ministères concernés, avec les opérateurs, multiplieront leurs rencontres avec les Françaises et les Français pour recueillir leurs attentes à l’égard des objectifs de notre politique, par exemple par des consultations citoyennes ou des « tours de France » d’explication de notre politique de partenariats internationaux.
Un dialogue étroit entre le gouvernement et les parlementaires se poursuivra tout au long de l’année et une attention particulière sera portée à la cohérence de l’action internationale menée par les collectivités territoriales avec notre agenda.
Les échanges entre l’Etat et les acteurs de la société civile qui contribuent à orienter et mettre en œuvre notre politique se poursuivront, notamment au sein du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, qui modernisera son fonctionnement à partir des résultats de l’évaluation de ses 10 premières années.
4 – La France se joint à ses partenaires de bonne volonté afin de mobiliser les financements contre la pauvreté et pour la planète, notamment par l’initiative internationale du 4P
La France souhaite continuer à porter, avec ses voisins européens, une voix forte en faveur d’un agenda de progrès et de solidarité.
Elle le fera en accueillant tous les professionnels, chercheurs et experts, qui, dans ces temps troublés, souhaitent investir leur talent dans notre écosystème riche de centres de recherche et d’organisations internationales. Elle continuera également à porter l’agenda de réforme du système financier international incarné par l’initiative du 4P, qu’elle proposera à ses partenaires de faire évoluer en Pacte pour la prospérité des peuples et de la planète afin de mieux refléter le caractère international de l’initiative.
La France investit pour rassembler autour de la place de Paris toutes les forces de progrès :
Une initiative prise conjointement avec nos partenaires européens visera à attirer sur notre territoire tous ceux qui souhaitent contribuer à notre agenda de progrès, fondé sur la science et nos valeurs humanistes, et qui contribue à une planète plus sûre.
L’agenda du 4P, scellé en juin 2023, est désormais porté par 72 pays partenaires et son secrétariat assuré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris. L’initiative rendra compte de ses progrès lors de la Conférence sur le financement du développement de Séville en juin prochain.
Le Forum de Paris sur la paix, plateforme qui se donne pour mission de réinventer la diplomatie dans un monde en mutation, assure chaque année la rencontre de tous les acteurs engagés pour la paix et la prospérité mondiales.
Le Dialogue de Paris, qui réunit des organisations internationales présentes dans la capitale, engagées pour le développement durable (UNESCO, OCDE, AIE, CEB, CCI, OIF, AFD), avec les autres acteurs parisiens, s’emploie à soutenir des solutions de développement durable croisant les regards publics et privés
La présidence française du G7 en 2026 offrira l’occasion de mobiliser nos plus grands partenaires autour de cet agenda.
La France continue à être pleinement engagée pour la réforme de l’architecture financière internationale, afin de :
Rendre notre système plus simple et plus représentatif, en confiant aux pays émergents une plus grande place reflétant leur poids dans l’économie mondiale, sous réserves qu’ils assument plus de responsabilités, au regard des enjeux globaux auxquels nous sommes confrontés.
Aborder de front la question de la souveraineté budgétaire des Etats, y compris en appuyant les pays dans la gestion de leurs finances publiques, de la lutte contre la corruption et du climat des affaires, afin de sortir des dépendances d’un autre temps notamment sur les politiques publiques essentielles (comme la santé ou l’éducation).
Démultiplier les financements en faisant mieux levier sur le bilan des banques multilatérales de développement et des fonds verticaux, ainsi que sur les marchés carbone permis par l’Accord de Paris et les crédits biodiversité, et en coordonnant mieux les institutions de financement, multilatérales, régionales et nationales, à travers le réseau Finance en Commun.
La France portera dans les prochains mois avec ses partenaires du 4P des propositions ambitieuses et concrètes en écho aux décisions prises par ce Conseil, dont :
La prise en compte de la vulnérabilité multidimensionnelle, notamment climatique dans l’allocation des ressources des différents bailleurs sera promue à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les Océans de Nice (9-13 juin), en ligne avec l’approche innovante proposée par ce Conseil concernant les financements français. La promotion des clauses de dette résiliente au climat, telles que pratiquées par la France depuis 2023, s’inscrit également dans ce cadre.
La promotion de contributions mondiales de solidarité, dans la perspective de la COP30 de Belém (10-21 novembre), en écho à l’approche de taxation innovante promue par la France depuis les années 2000, notamment avec la taxe de solidarité sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières. La réaffectation d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avion à notre politique de solidarité internationale, jusqu’ici assurée par le Fonds de solidarité pour le développement, pourra être expertisée à l’occasion du comité interministériel compétent en vue du projet de loi de finances pour 2026.
La mobilisation de financements privés, en travaillant précisément à en lever les freins, notamment de nature prudentielle, en lien étroit avec la présidence sud-africaine du G20 qui porte ces travaux en vue du Sommet de Johannesburg (22-23 novembre).
Source : Elysée, présidence de la République.